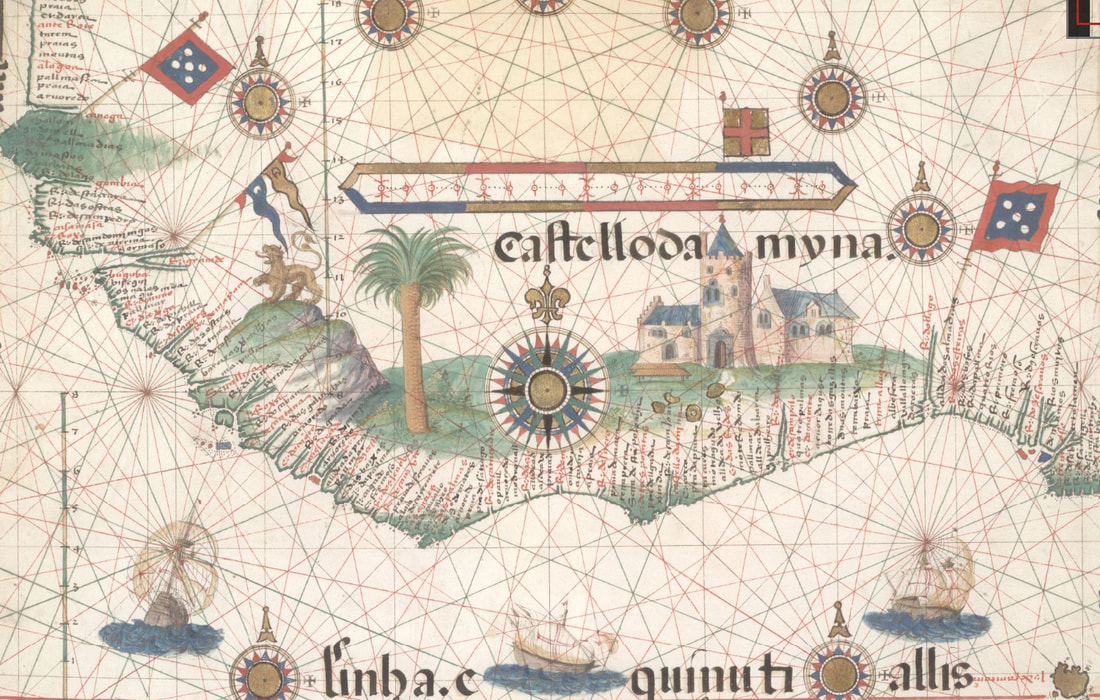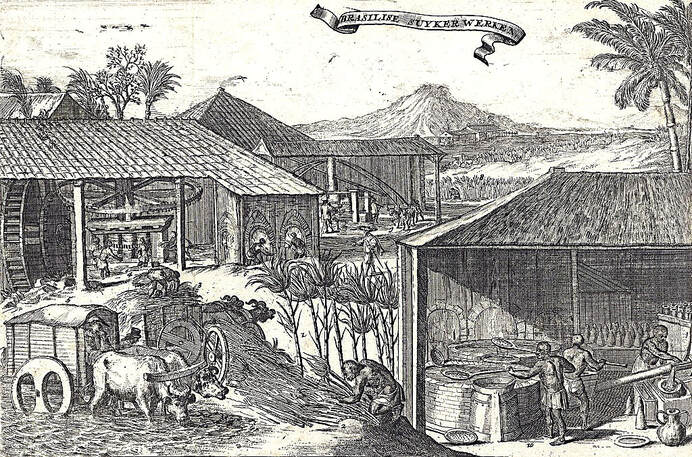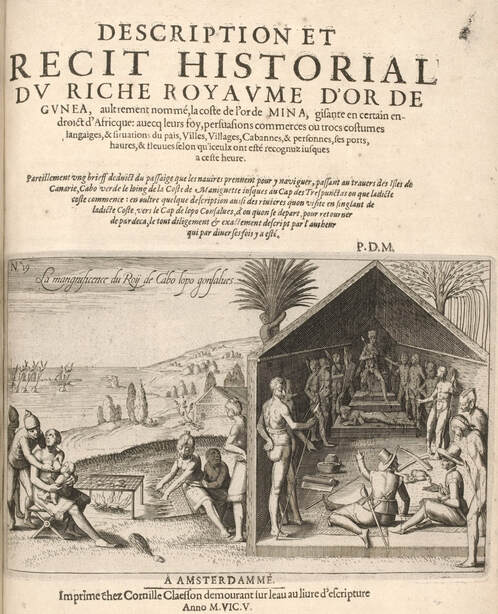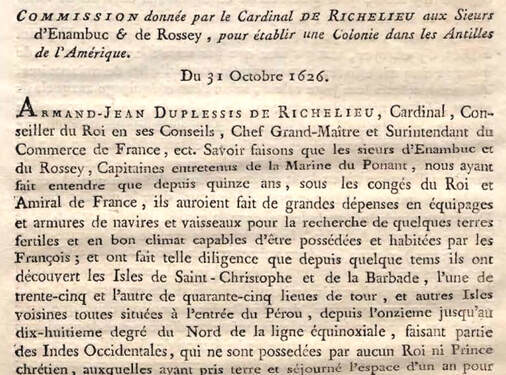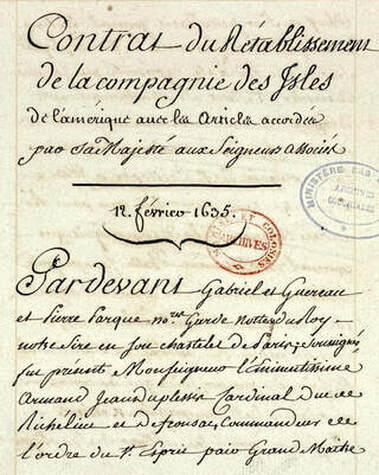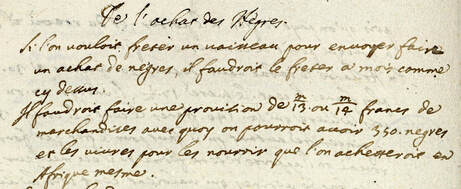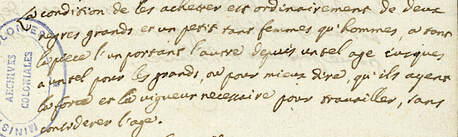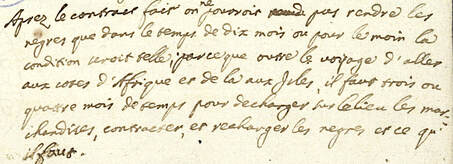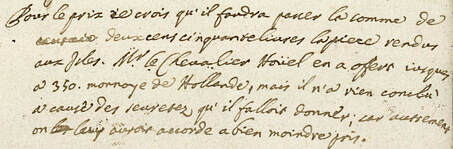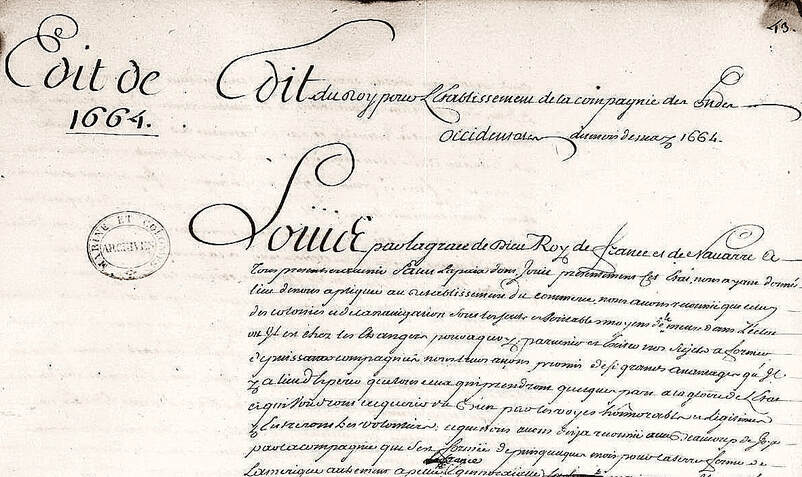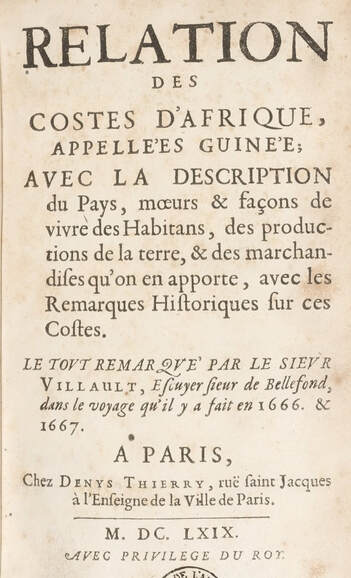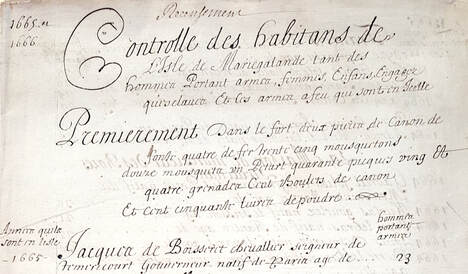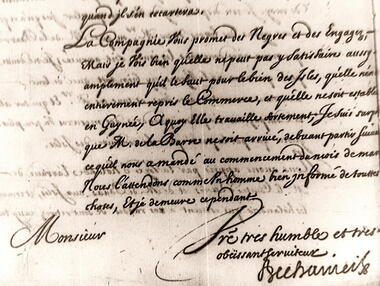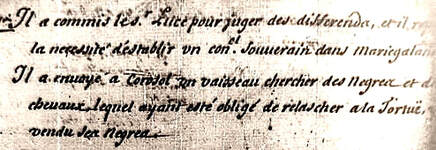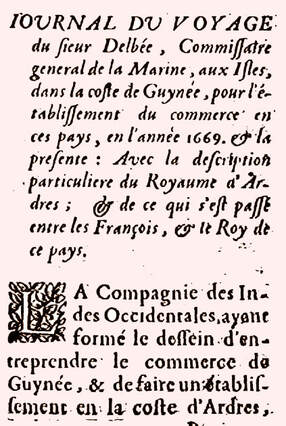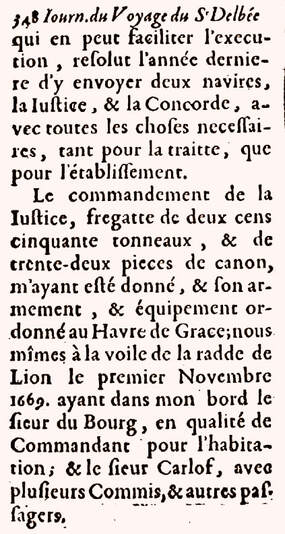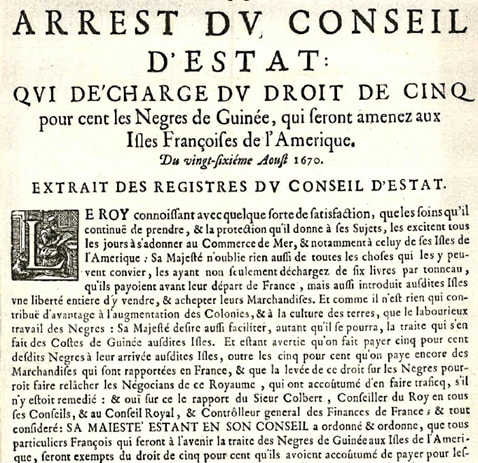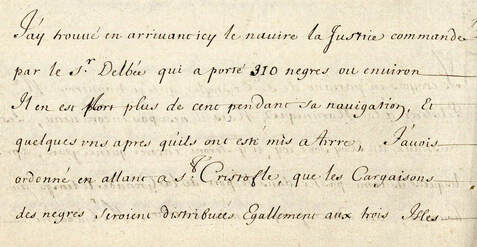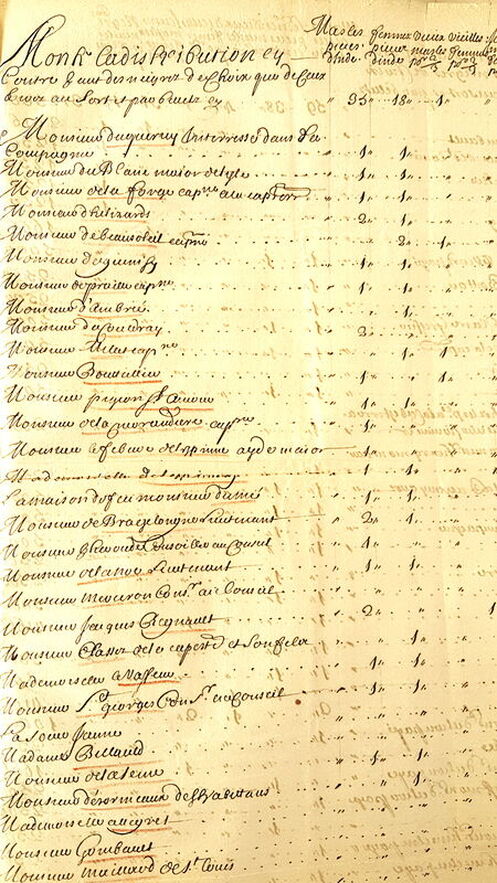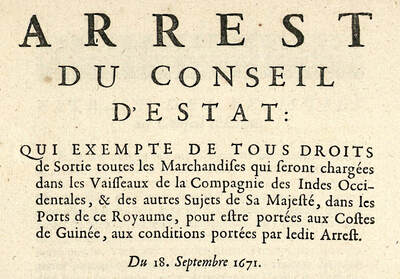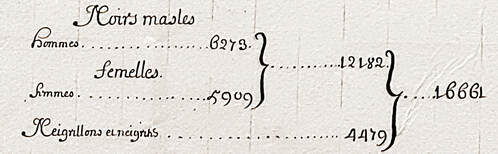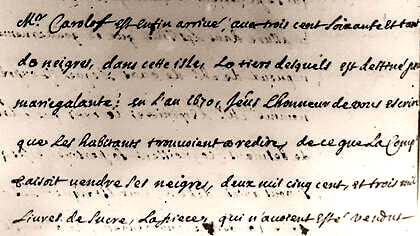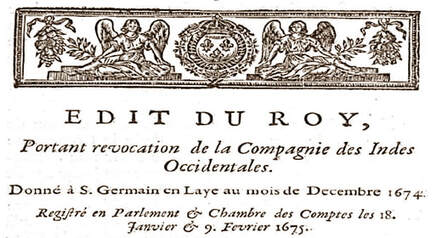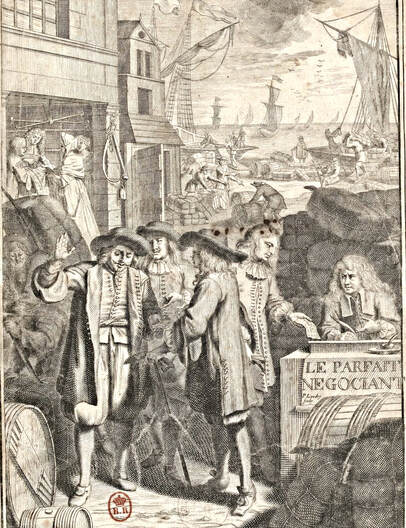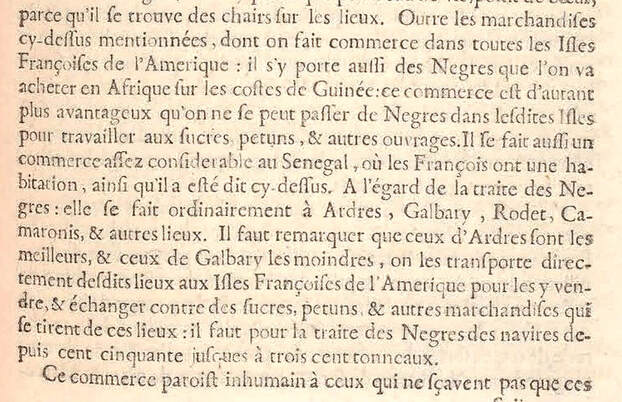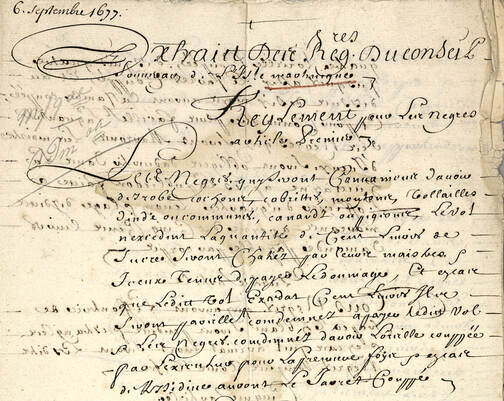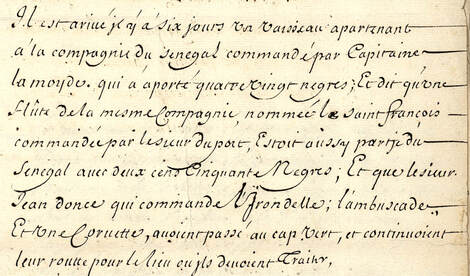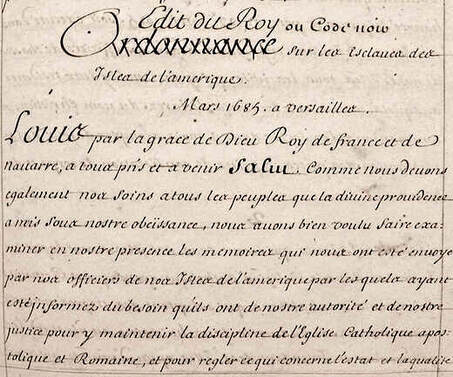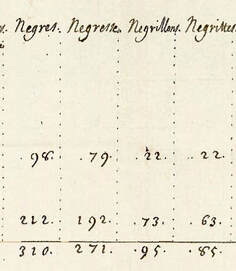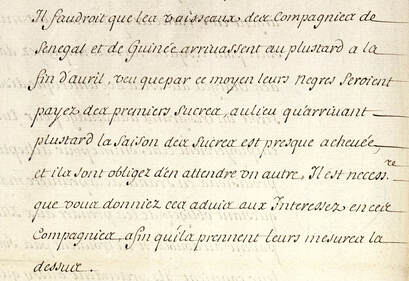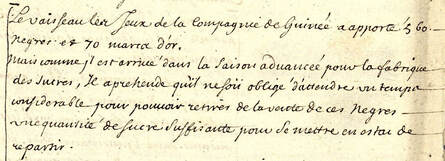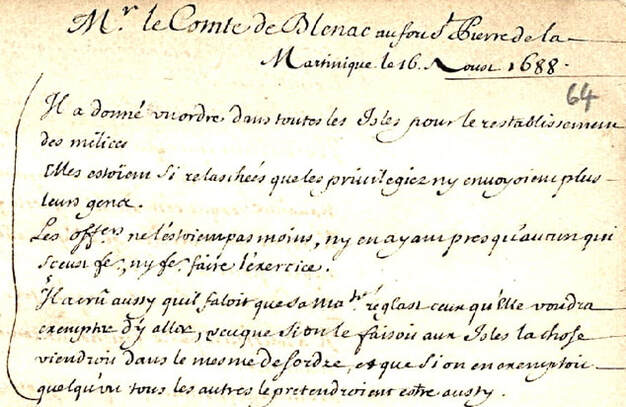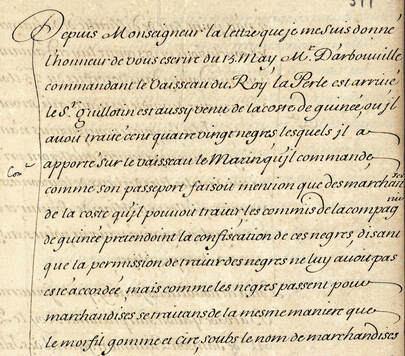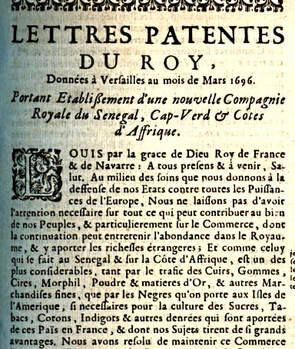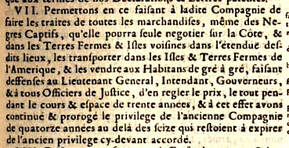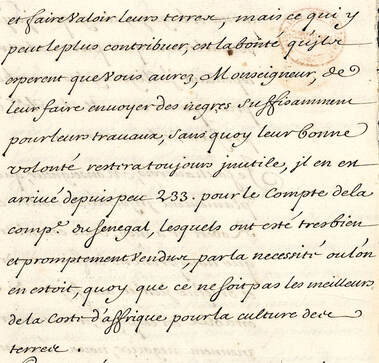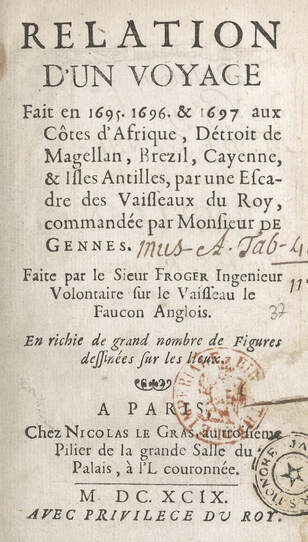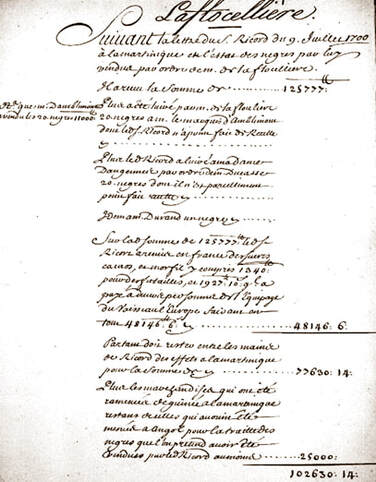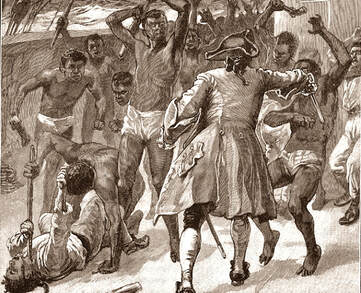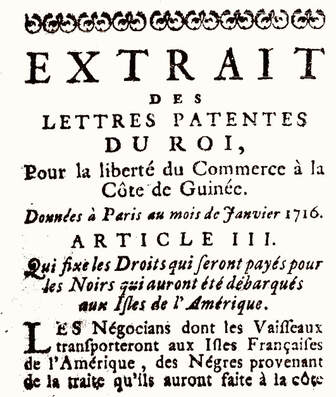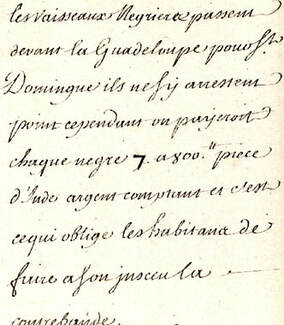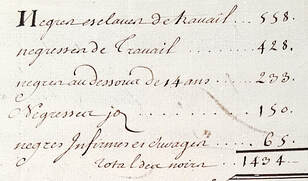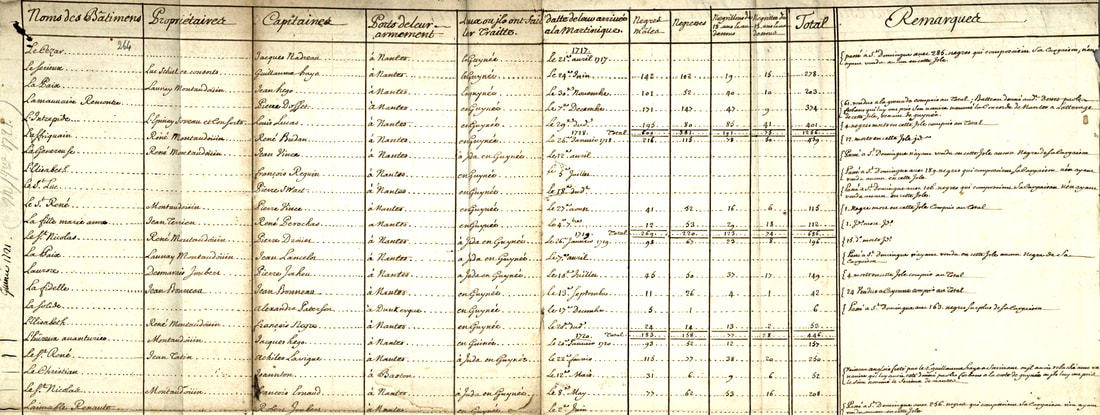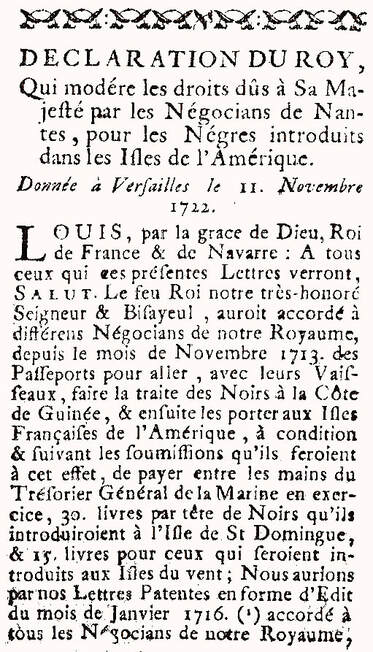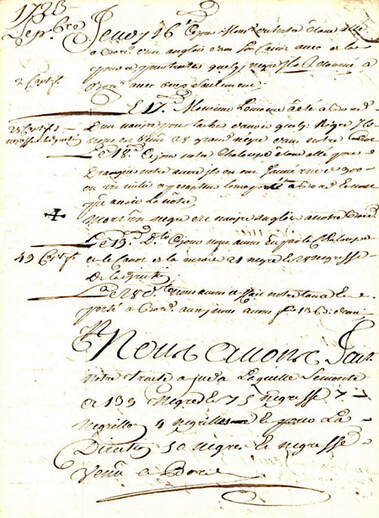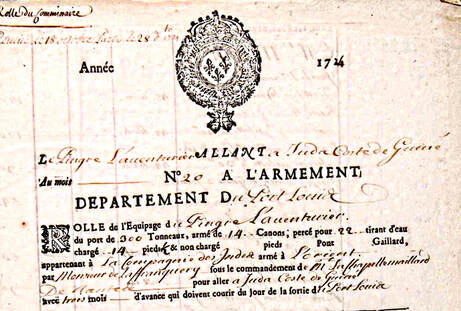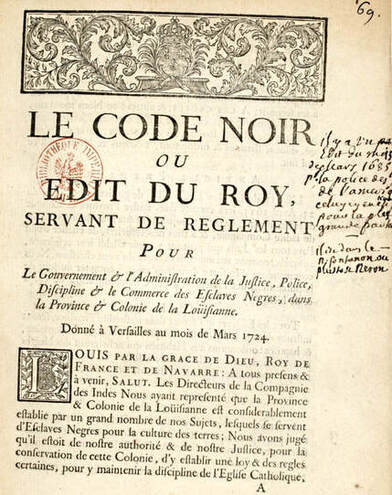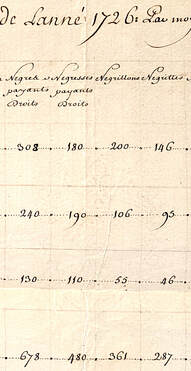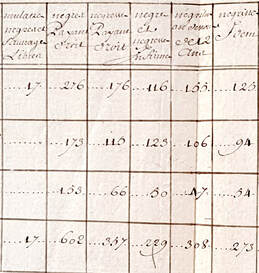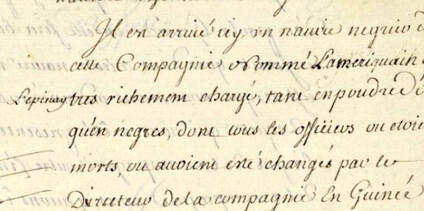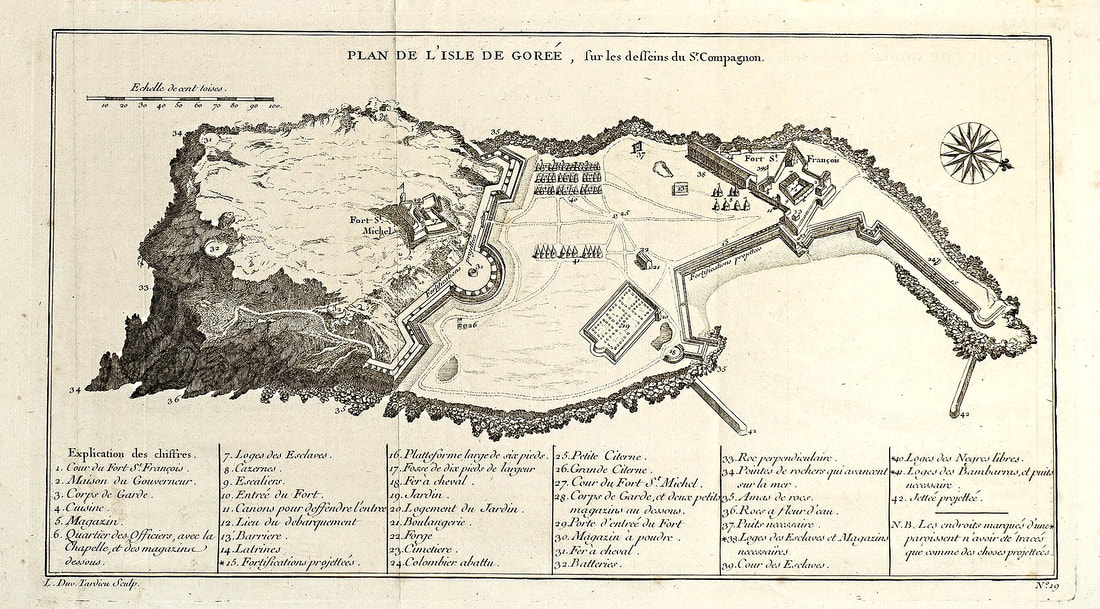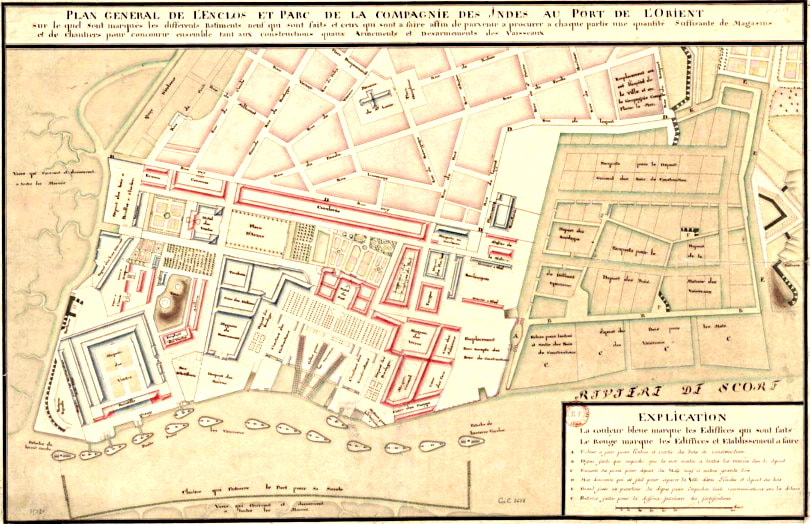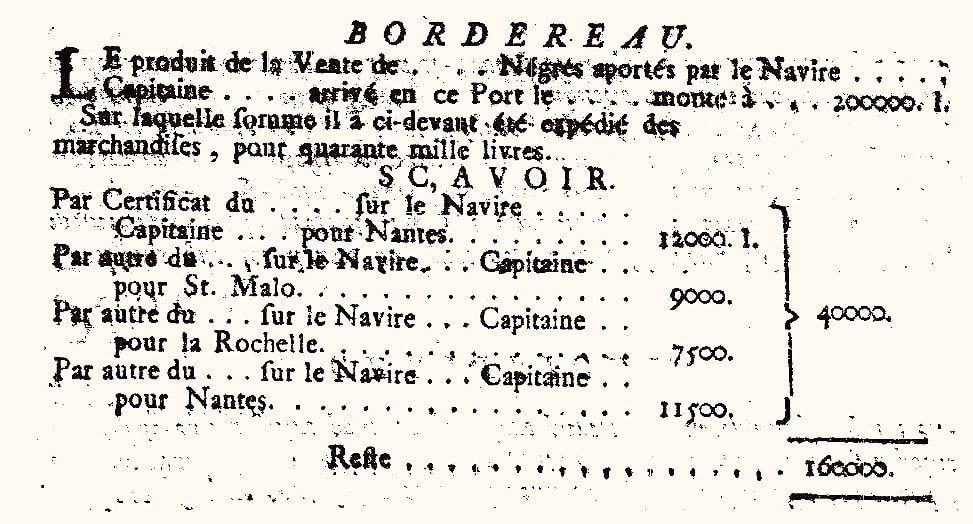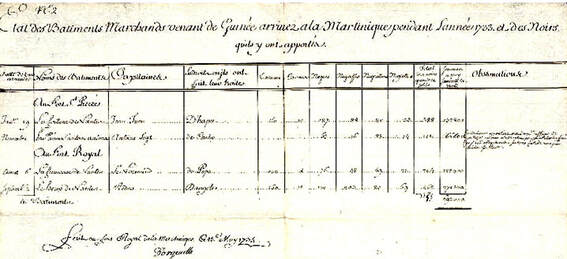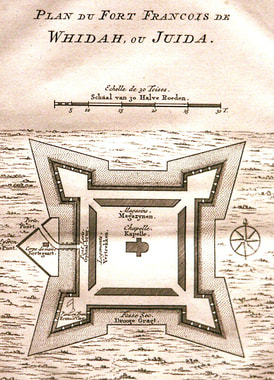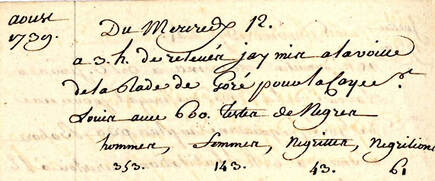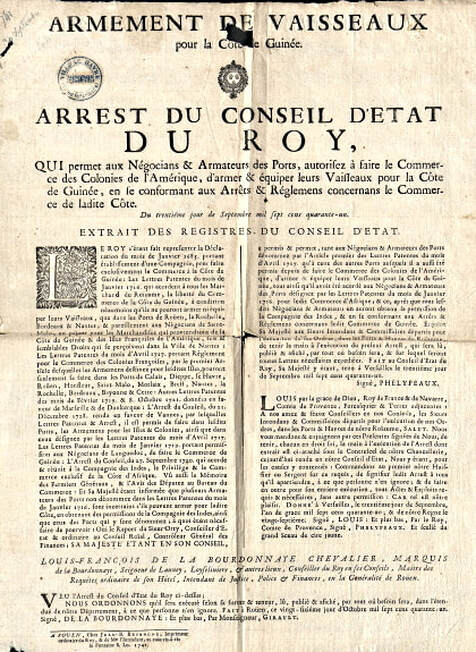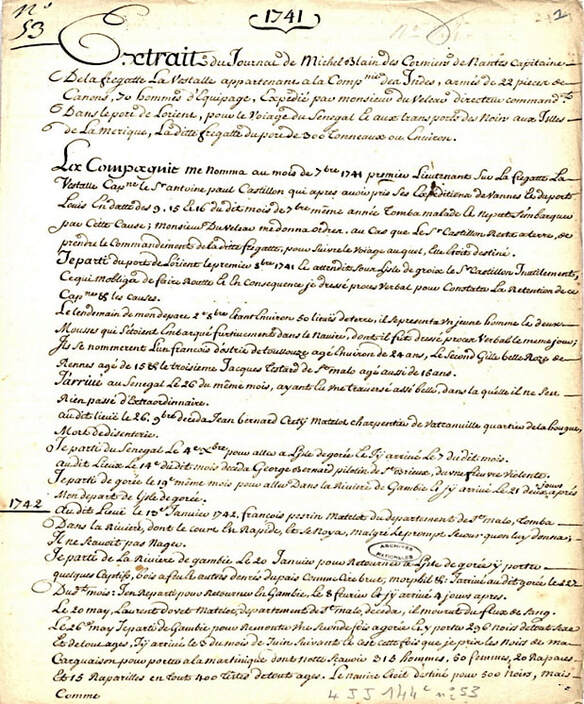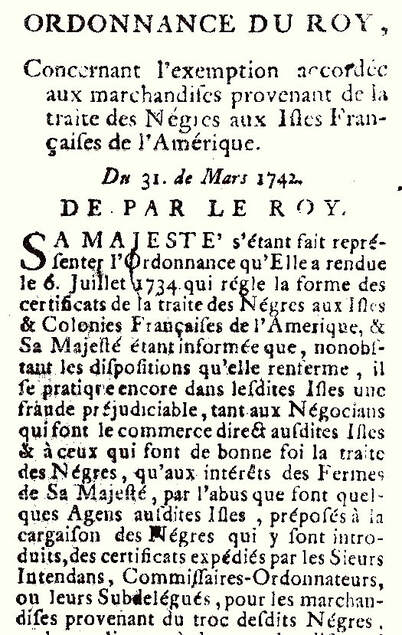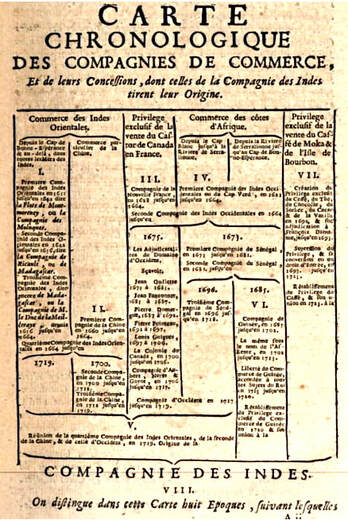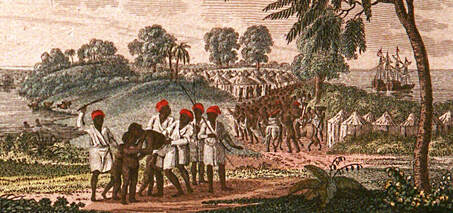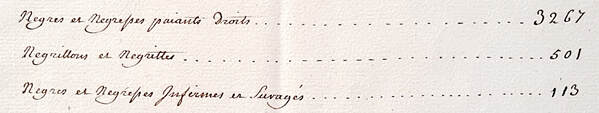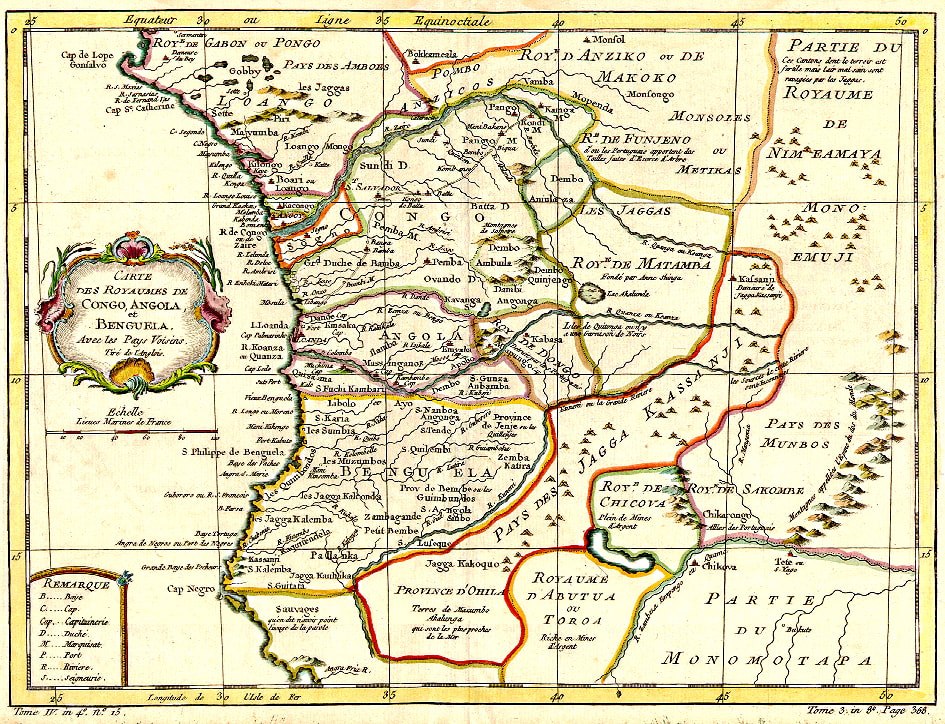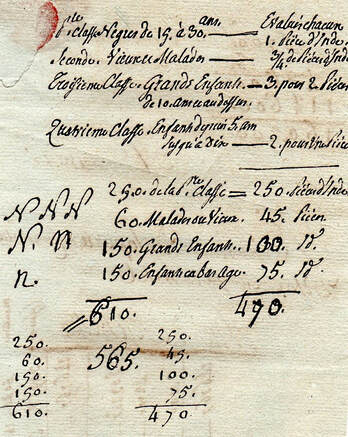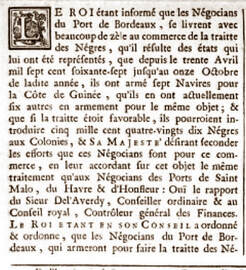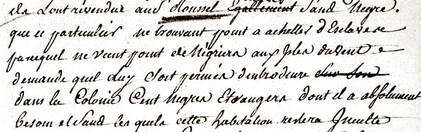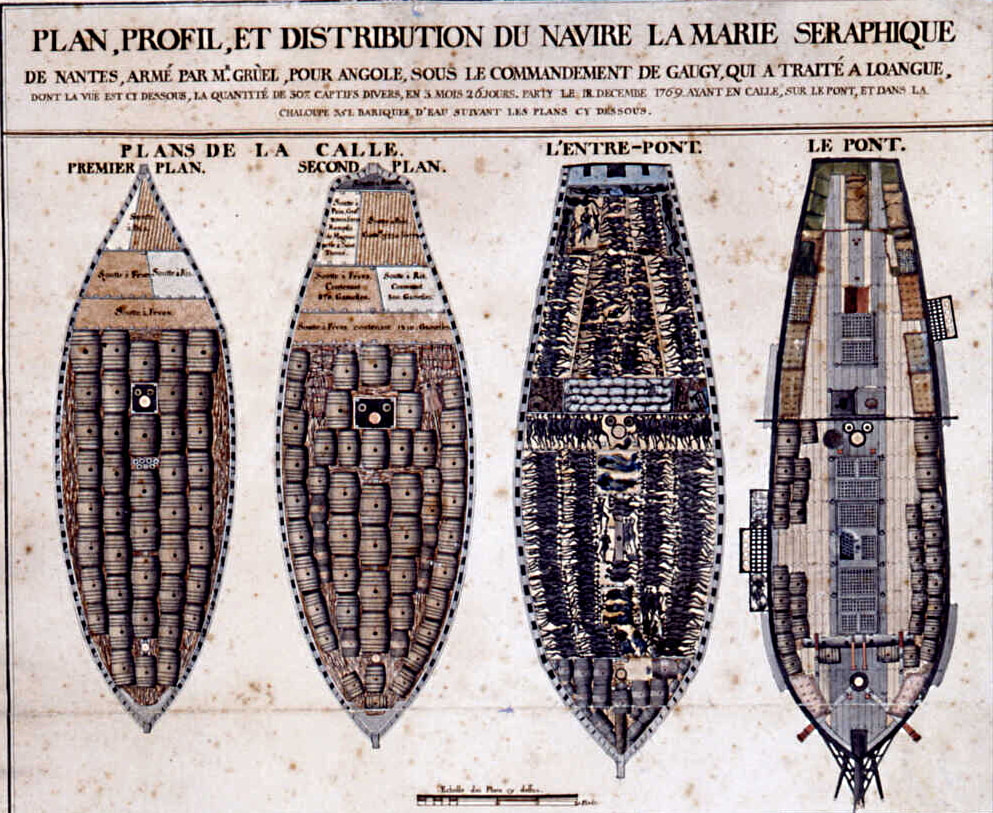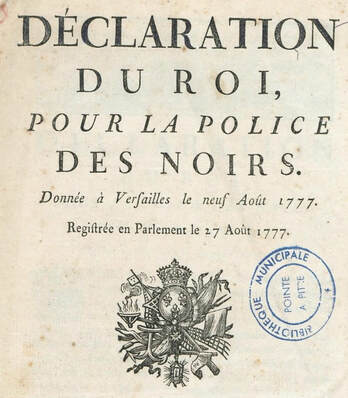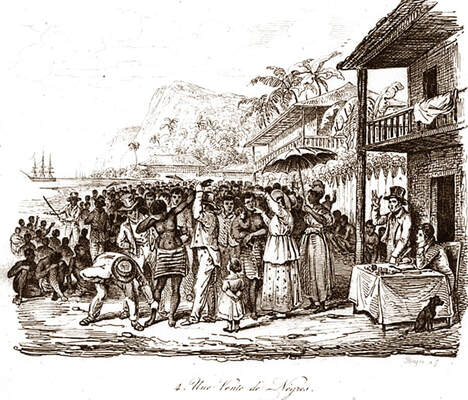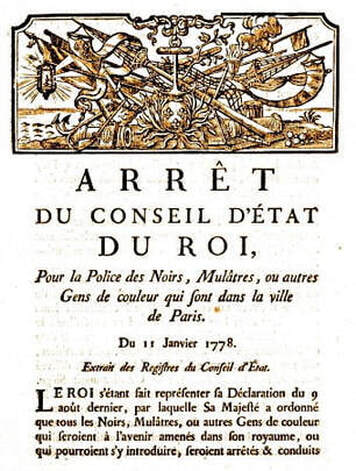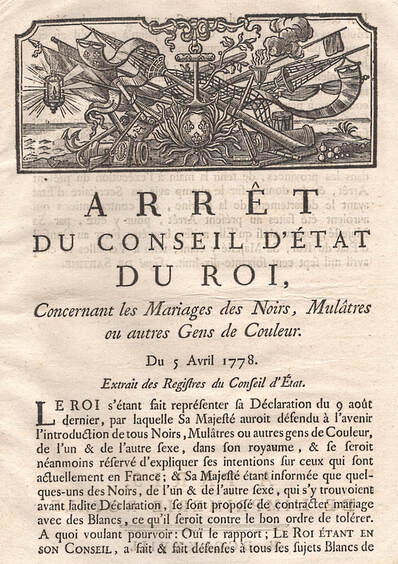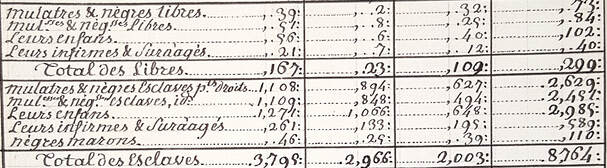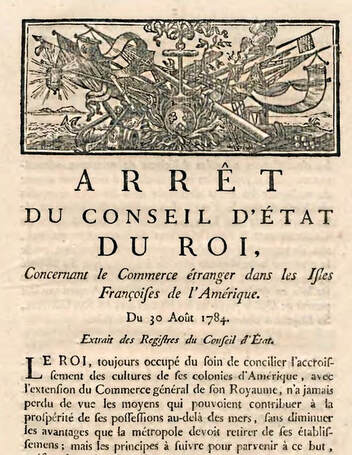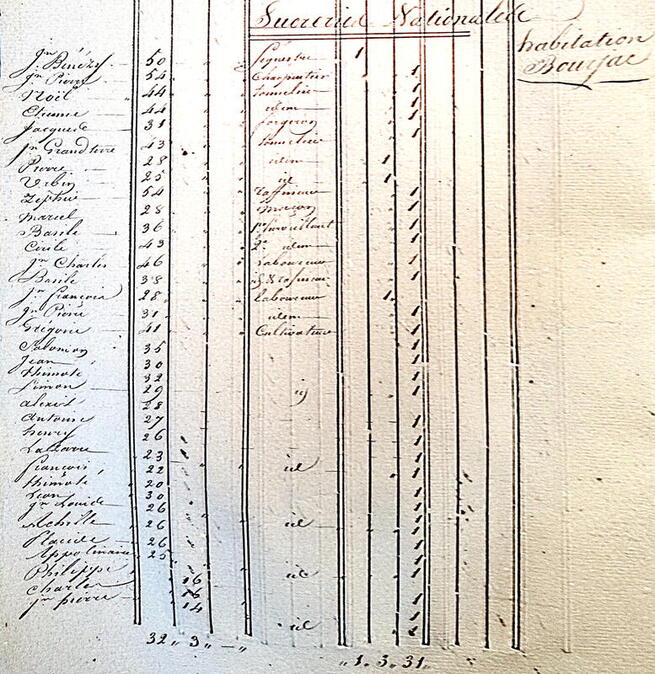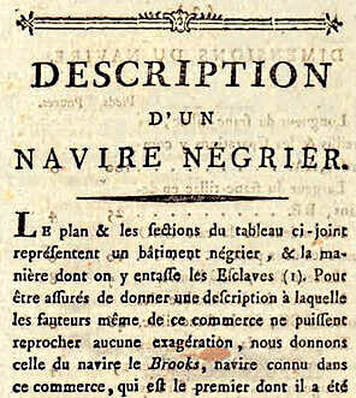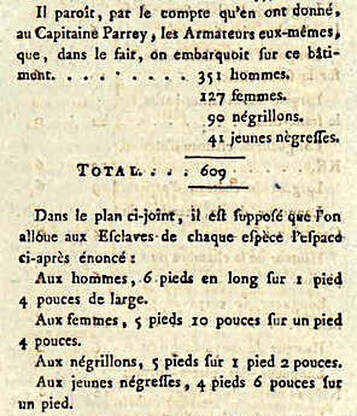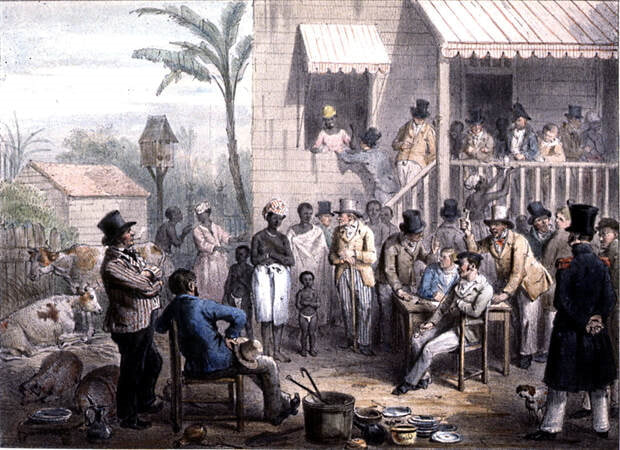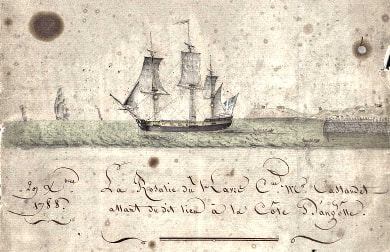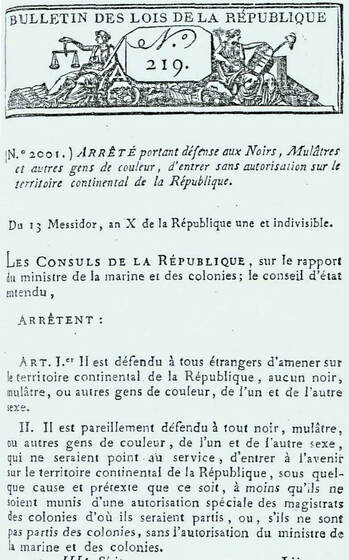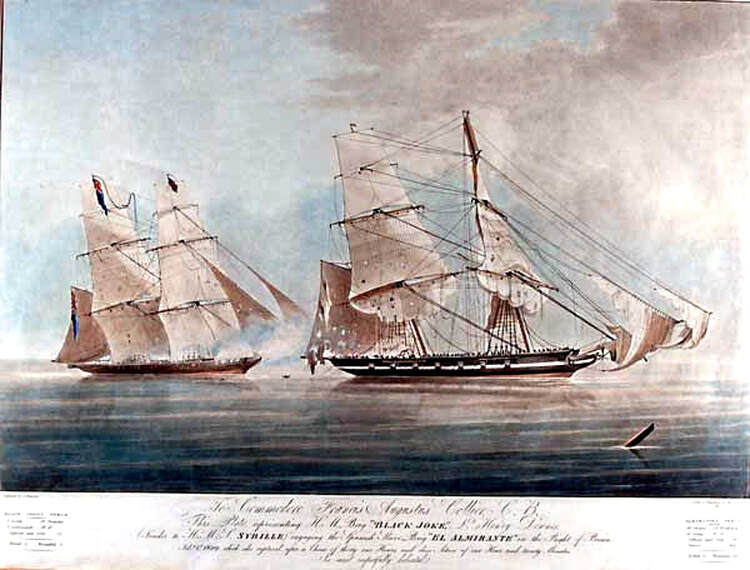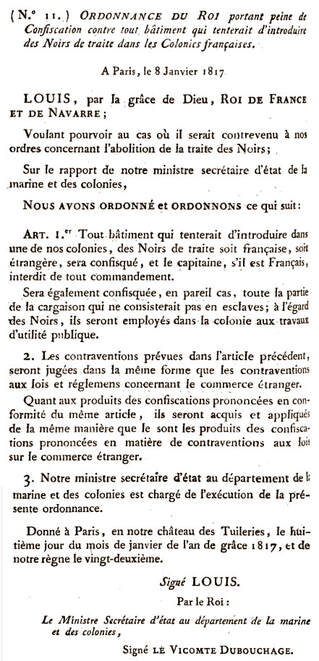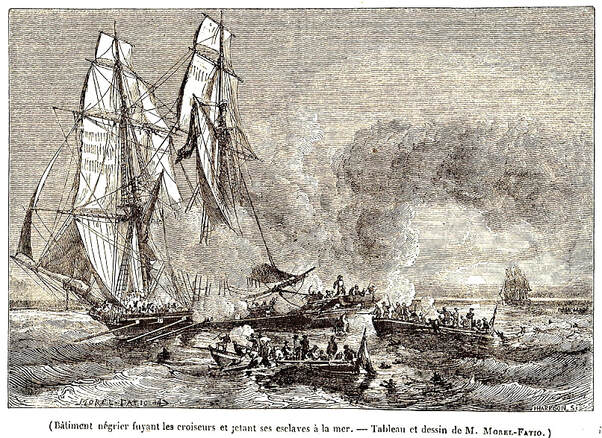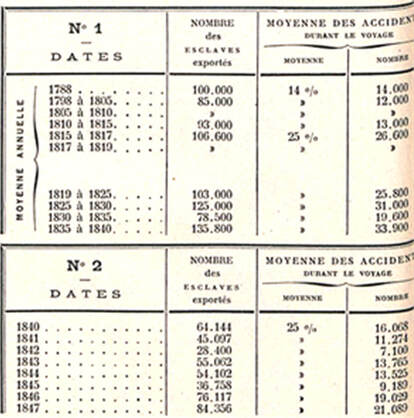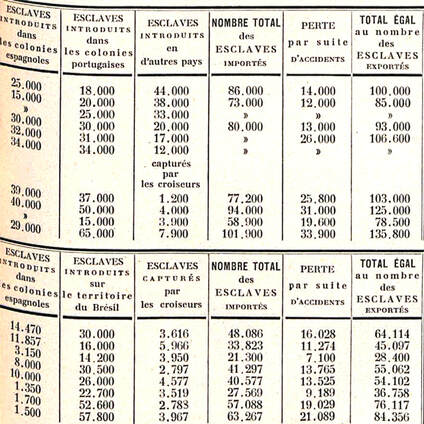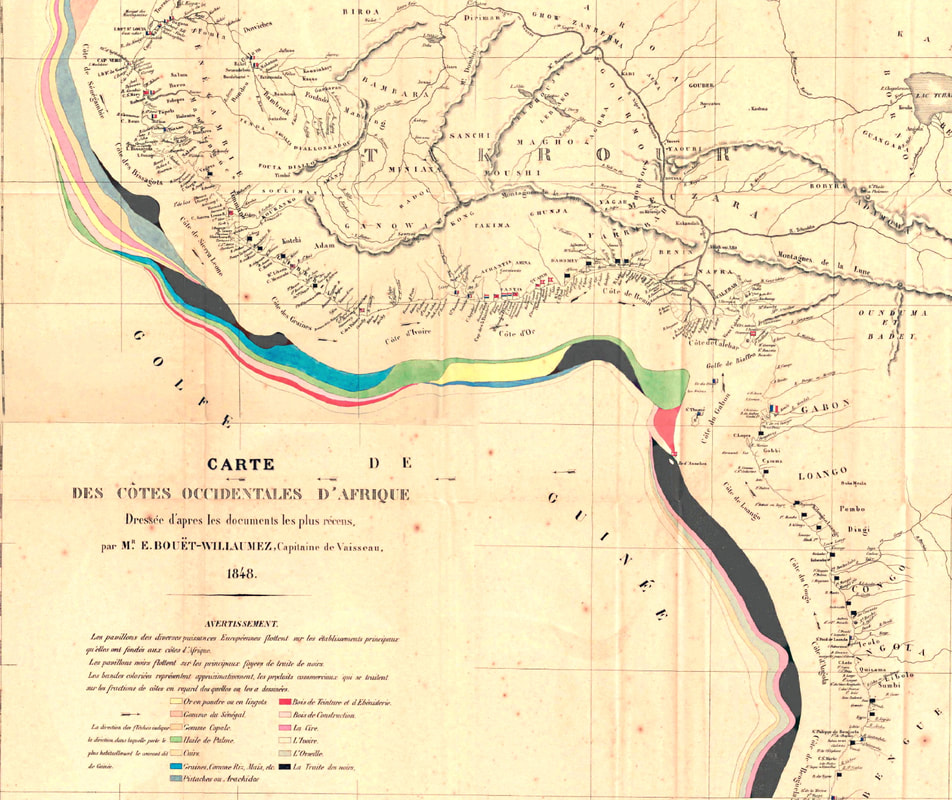652 : Début de la traite africaine par arabo-musulmane en Nubie, 20 ans après la mort de Mahomet : un traité entre l’Émir Abdallah ben Sayd et le Roi de Nubie Khalidurat impose aux chrétiens de Nubie (vallée supérieure du Nil) la livraison de 360 esclaves par an.
1194 : L'Ordre de la Très Sainte Trinité et de la Rédemption des Captifs, dit Ordre des Trinitaires, est fondé pour racheter les chrétiens captifs des musulmans
Le père Dan, un Trinitaire qui se dévoua au sort des captifs, en dénombrera 30.000 à Alger en 1634.
Mais nous ne nous intéresserons içi qu’à la traite dite Atlantique, que vont pratiquer les Européens 800 ans plus tard et qui va rapidement concerner les Antilles…
1364 : Des marins dieppois fondent la première colonie européenne en Afrique, appelée le Petit Dieppe à l’embouchure de la rivière Cestos (actuel Liberia) : il s'agit essentiellement de trafic d'ivoire et de gomme arabique, la traite n'a pas débuté.
1380 : Les Dieppois poussent encore plus loin et fonde un comptoir La Mine sur la Côte d’Or (actuel Ghana). La guerre de Cent ans met un terme à leurs expéditions...
1419 : Les navigateurs Portugais découvrent Madère.
1427 : Les Portugais découvrent les Açores.
1433 : Les Portugais profitent de la fin de la Guerre de Cent Ans pour s’emparer du Castel de La Mine, alors abandonné, rebaptisant le fort São Jorge da Mina, qui deviendra plus tard El Mina, le centre de la traite Portugaise.
1441 : Arrivée des premiers esclaves noirs à Lisbonne, comme manutentionnaires ou domestiques.
" Cette traite initiale s’enracine dans les formes médiévales de l’esclavage méditerranéen, dépendante des traites interafricaine et transsaharienne, telles que les pratiquaient les Arabes ou Barbaresques depuis 800 ans"
1449 : Le Génois Antonio di Noli découvre les îles du Cap Vert au nom de l'Infant Henri du Portugal.
1460 : Le génois Antonio di Noli obtient du roi du Portugal l’autorisation d’importer à son compte des esclaves de Guinée vers le Cap-Vert, afin d’introduire la culture de la canne à sucre sur l’île.
1448 : Les Portugais édifient à Arguin, au large du littoral de l’actuelle Mauritanie, le premier entrepôt négrier permanent de la côte africaine.
1452 : Le pape Nicolas V donne la permission au roi du Portugal Alphonse V, dit l'Africain " d’envahir, de rechercher, capturer, conquérir et assujettir tous les Sarrasins et autres païens et tous les ennemis du Christ où qu’ils soient, avec leurs royaumes… et de réduire leurs personnes à l’esclavage perpétuel "…
1466 : Second comptoir de traite portugaise à Santiago du Cap-Vert.
1482 : Les Abravanel, séfarades "conversos" réfugiés au Portugal et proches du roi Henri Le Navigateur, obtiennent le monopole du commerce des esclaves de Guinée.
1492 : La colonisation portugaise des Canaries, son économie sucrière démarre grâce aux esclaves.
1501 : Les Portugais ont embarqué depuis mai 1499 au départ de leur comptoir d'Arguin 668 esclaves à destination du Portugal.
1505 : Début officielle de la traite vers les Amériques, le roi Ferdinand le Catholique autorise l’envoi depuis Séville de deux lots de 17 et de 100 pièces d’esclaves pour les mines d’or d’Hispaniola "puisqu’un nègre travaille plus que 4 indiens"…
1510 : Les Portugais possèdent 2 autres îles à sucre, en pleine expansion grâce à l’esclavage : Madère et Sao Tomé.
1.540 esclaves ont été embarqués en 2 ans depuis l'entrepôt d'Arguin à destination du Portugal.
1905 esclaves ont déja été envoyés aux Amériques espagnoles depuis 1501.
1516 : 4307 esclaves sont enregistrés dans l'entrepôt de Sao Tomé.
1517 : Pour Hispaniola, Bartolomeo de Las Casas, défenseur des Indiens, prône la traite de Noirs : il propose "de donner la permission aux colons d’amener des nègres pour soulager les naturels"...
1520 : 3.792 esclaves ont été embarqués en 3 ans depuis l'entrepôt négrier d'Arguin à destination du Portugal.
3.000 esclaves arrivent par an à Sao Tomé, venant directement du Bénin et du Congo.
8.810 esclaves ont été envoyés aux Amériques espagnoles depuis 1511.
1534 : En 2 ans, 6 navires portugais ont débarqué à Hispaniola et à San Juan de Porto Rico 1.102 esclaves sur les 1.343 embarqués à Sao Tomé.
1537 : Charles Quint signe un premier grand contrat avec Gaspar de Torres portant sur l’introduction de 4.000 Noirs aux Amériques.
1539 : Les 50 premiers esclaves noirs arrivent sur le continent américain en Floride, alors espagnole, amenés par le conquistador Hernando de Soto.
1540 : 5.000 à 6.000 esclaves africains transitent annuellement par le port de Lisbonne.
L’Almoxarife (percepteur) des esclaves de la "Casa da Mina e da India" inspecte chaque esclave, identifié par son sexe, son âge et son port d’embarquement, et enregistre les taxes.
Dans le même temps, les colonies d'Amérique reçoivent environ 1.500 esclaves par an, dont beaucoup sont nés au Portugal ou en Espagne.
1548 : Un contrat est signé à Anvers entre João Rebelo, représentant du Portugal, et Christophe Wolf, facteur de la maison Anton Fugger : " Ceux-ci s’engagèrent à convoyer pour les nègres de la Guinée : 6 750 quintaux d’anneaux en laiton pour le commerce à S. Jorge da Mina; 750 quintaux d’anneaux pour le commerce de Guinée; 24 000 bassines à urine et 1 800 bassinets à bord large; 4 500 bassins pour barbiers; 10 500 chaudrons en laiton. Le tout à délivrer dans les 3 ans à la Casa da India e Mina"
La traite demandait des accessoires de transport !
1550 : Depuis 1544, 71 navires négriers ont quitté les ports de Cadix et de Séville à destination de l’entrepôt portugais de Santiago au Cap-Vert. De là, 12.800 esclaves ont traversé l’Atlantique vers Hispaniola, San Juan de Porto Rico et les ports de la Nouvelle-Espagne.
1556 : La carte du portugais Joao Freire nous montre l'importance du commerce européen en Afrique et en particulier de la traite.
Le fort portugais de Sao Jorge da Mina "Castelloda myna", l'un des principaux comptoirs de traite portugais, est mis à l'honneur...
1570: 37.497 esclaves ont été importés aux Amériques espagnoles depuis 1561. Ils viennent majoritairement de Sénégambie et secondairement de Sao Tomé.
1590 : Au Brésil, les Portugais ont conquis petit à petit toute la côte aux dépens des comptoirs normands, ils importent des esclaves en pratiquant eux-même leur traite en Afrique.
Tous les ingrédients de la première grande expansion sucrière sont déja réunis : 60 sucreries appelées "Engenho"...r un élément..
1590 : Au Brésil, les Portugais ont conquis petit à petit toute la côte aux dépens des comptoirs normands, ils importent des esclaves en pratiquant eux-même leur traite en Afrique.
Tous les ingrédients de la première grande expansion sucrière sont déja réunis : 60 sucreries appelées "Engenho"...r un élément..
Une "Engenho" au Brésil...
1594 : Première expédition négrière française présumée au départ de La Rochelle : L'Espérance va au Gabon puis au Brésil, probablement pour le compte des Portugais.
1595 : Les Portugais vont obtenir le monopole de la fourniture des esclaves pour les colonies espagnoles "asiento" jusqu'en 1640 :
Le premier asiento est signé avec le "converso" Pedro Gomes Reinel, qui reçoit l’autorisation d’introduire 4 250 Noirs aux Amériques en échange du paiement de 100 000 ducats.
L'une des centres de la traite portugaise est Cacheu en Sénégambie où les portugais construisent un fort; la communauté marrane est au centre de ce commerce.
1600 : Sur les 11.900 esclaves introduits aux Amériques espagnoles depuis 1576, 10.300 viennent de l'Angola et du Congo.
1603 : Dans une lettre patente à l'explorateur Pierre du Gua de Monts, Henri IV justifie les débuts de la colonisation françoise de l'Amérique : " D’une dévote et ferme résolution que nous avons prise avec l’aide de Dieu auteur, distributeur et protecteur des tous roiaumes et estats de faire convertir, amener et instruire les peuples qui habitent en cette contrée de présent gens barbares athës sans foy ni religion au christianisme et en la creance et profession de notre foy et les retirer de l’ignorance et infidelité ou ils sont "...
1605 : Le hollandais Pieter de Marees publie à Amsterdam la version française de son " Description et historial du riche royaume d'Or de Gynea, austrement nommé la coste de l'Or de Mina"
1594 : Première expédition négrière française présumée au départ de La Rochelle : L'Espérance va au Gabon puis au Brésil, probablement pour le compte des Portugais.
1595 : Les Portugais vont obtenir le monopole de la fourniture des esclaves pour les colonies espagnoles "asiento" jusqu'en 1640 :
Le premier asiento est signé avec le "converso" Pedro Gomes Reinel, qui reçoit l’autorisation d’introduire 4 250 Noirs aux Amériques en échange du paiement de 100 000 ducats.
L'une des centres de la traite portugaise est Cacheu en Sénégambie où les portugais construisent un fort; la communauté marrane est au centre de ce commerce.
1600 : Sur les 11.900 esclaves introduits aux Amériques espagnoles depuis 1576, 10.300 viennent de l'Angola et du Congo.
1603 : Dans une lettre patente à l'explorateur Pierre du Gua de Monts, Henri IV justifie les débuts de la colonisation françoise de l'Amérique : " D’une dévote et ferme résolution que nous avons prise avec l’aide de Dieu auteur, distributeur et protecteur des tous roiaumes et estats de faire convertir, amener et instruire les peuples qui habitent en cette contrée de présent gens barbares athës sans foy ni religion au christianisme et en la creance et profession de notre foy et les retirer de l’ignorance et infidelité ou ils sont "...
1605 : Le hollandais Pieter de Marees publie à Amsterdam la version française de son " Description et historial du riche royaume d'Or de Gynea, austrement nommé la coste de l'Or de Mina"
1608 : Samuel de Champlain fonde la ville de Québec.
1619 : Arrivée des 20 ou 30 premiers esclaves en Virginie, colonie anglaise de l'Amérique, capturés par un corsaire hollandais sur un négrier portugais qui revenait d'Angola.
1620 : Les Hollandais possèdent 2 forts sur l'île de Gorée et organisent leur traite.
Depuis 1611, 61.957 esclaves ont été introduits aux Amériques espagnoles, la grande majorité vient de l'Angola et du Congo, secondairement de Sénégambie. Le lieu de débarquement est essentiellement en Amérique à Vera Cruz au Mexique et Carthagène en Colombie, Hispaniola en reçoit 20 fois moins.
1621 : Des négociants Hollandais créent la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales (en néerlandais : Geoctroyeerde Westindische Compagnie, GWC) pour la colonisation.
Les navires de la GWC vont transporter une moyenne de 3.200 esclaves par an entre l’Afrique et les Amériques.
1626 : Richelieu crée la Compagnie dite de St Christophe et donne une " Commission aux sieurs d’Enambuc et de Rossey établir une Colonie dans les Antilles de l'Amérique", ci-dessous copie de Moreau de St Mery.
1619 : Arrivée des 20 ou 30 premiers esclaves en Virginie, colonie anglaise de l'Amérique, capturés par un corsaire hollandais sur un négrier portugais qui revenait d'Angola.
1620 : Les Hollandais possèdent 2 forts sur l'île de Gorée et organisent leur traite.
Depuis 1611, 61.957 esclaves ont été introduits aux Amériques espagnoles, la grande majorité vient de l'Angola et du Congo, secondairement de Sénégambie. Le lieu de débarquement est essentiellement en Amérique à Vera Cruz au Mexique et Carthagène en Colombie, Hispaniola en reçoit 20 fois moins.
1621 : Des négociants Hollandais créent la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales (en néerlandais : Geoctroyeerde Westindische Compagnie, GWC) pour la colonisation.
Les navires de la GWC vont transporter une moyenne de 3.200 esclaves par an entre l’Afrique et les Amériques.
1626 : Richelieu crée la Compagnie dite de St Christophe et donne une " Commission aux sieurs d’Enambuc et de Rossey établir une Colonie dans les Antilles de l'Amérique", ci-dessous copie de Moreau de St Mery.
La nouvelle Compagnie dispose seulement de 3 navires : 1 vaisseau de 250 tonneaux, la Victoire, 1 patache de 120 tonneaux, la Catholique, armée de 10 canons et 8 pierriers - qui lui vient de Richelieu et représente une partie de son investissement dans la Compagnie - et 1 patache de 60 tonneaux, la Cardinale
1627 : Autorisation de déporter 40 esclaves Noirs à St Christophe : ce sont les premiers esclaves Français "officiels"…
Jean Rozée (père), armateur dieppois, est nommé, pour 2 ans renouvelables, directeur de la Compagnie Rozée avec 16/64e parts de la compagnie. Le second actionnaire est Jacques Bulteau. Ils possédaient déjà une compagnie qui commerçait entre le Maroc et l'Espagne.
En parallèle, Richelieu crée de la Compagnie des Cent Associés en fusionnant la Compagnie de Rouen et la Compagnie de Montmorency constituées pour coloniser le Québec ou Nouvelle France. La direction est donnée à Samuel de Champlain.
1628 : La Compagnie de St Christophe a perdu la Victoire, elle investit dans 2 nouveaux navires : 1 flibot de 90 tonneaux, les Trois Rois, et 1 autre flibot, le Beaurepaire de 60 tonneaux. On est loin d'une flotte importante...
1633 : La Compagnie Rozée reçoit de Richelieu l'exclusivité du commerce au Sénégal et en Gambie pour 10 ans.
Elle possède 3 navires pour commercer avec le Sénégal : Le Saint Jean, Le Saint Louis et Le Florissant.
1634 : La Compagnie Rozée recoit en plus le privilège du commerce pour la Guinée, soit Elmina.
Une Compagnie à charte de St Malo, est créée par un négociant Briant Larcy, elle ne durera que quelques années et fera faillite après la perte de navires.
1635 : La Compagnie de St Christophe devient la Compagnie des Isles de l’Amérique.
1627 : Autorisation de déporter 40 esclaves Noirs à St Christophe : ce sont les premiers esclaves Français "officiels"…
Jean Rozée (père), armateur dieppois, est nommé, pour 2 ans renouvelables, directeur de la Compagnie Rozée avec 16/64e parts de la compagnie. Le second actionnaire est Jacques Bulteau. Ils possédaient déjà une compagnie qui commerçait entre le Maroc et l'Espagne.
En parallèle, Richelieu crée de la Compagnie des Cent Associés en fusionnant la Compagnie de Rouen et la Compagnie de Montmorency constituées pour coloniser le Québec ou Nouvelle France. La direction est donnée à Samuel de Champlain.
1628 : La Compagnie de St Christophe a perdu la Victoire, elle investit dans 2 nouveaux navires : 1 flibot de 90 tonneaux, les Trois Rois, et 1 autre flibot, le Beaurepaire de 60 tonneaux. On est loin d'une flotte importante...
1633 : La Compagnie Rozée reçoit de Richelieu l'exclusivité du commerce au Sénégal et en Gambie pour 10 ans.
Elle possède 3 navires pour commercer avec le Sénégal : Le Saint Jean, Le Saint Louis et Le Florissant.
1634 : La Compagnie Rozée recoit en plus le privilège du commerce pour la Guinée, soit Elmina.
Une Compagnie à charte de St Malo, est créée par un négociant Briant Larcy, elle ne durera que quelques années et fera faillite après la perte de navires.
1635 : La Compagnie de St Christophe devient la Compagnie des Isles de l’Amérique.
1637 : Les Hollandais prennent Sao Jorge da Mina, El Mina, principal site de traite des Portugais.
Jean Rozée a rachété une part des actions de Fouquet (père) dans la Compagnie des Isles de l'Amérique.
Avec sa Compagnie, il fonde à St Louis du Sénégal une implantation permanente avec une habitation sous le contrôle du capitaine Thomas Lambert.
1640 : Début de la Guerre de Restauration : les Portugais veulent obtenir leur indépendance vis à vis de la monarchie Habsbourg qui gouverne l'Espagne. Elle va durer jusqu'en 1668, l'Espagne va être expulsée des côtes africaines, les communautés marranes d'Afrique qui était liées à la traite vont majoritairement émigrer au Brésil.
1643 : La Compagnie des Isles de l’Amérique a chargé la Compagnie de Jean Rozée, également actionnaire, de fournir des nègres pour son projet sucrier en Guadeloupe, 60 ont été livrés par le capitaine Drouault peu après la Pentecôte, à 200 livres pièce.
A la réunion des associés du 6 octobre, le règlement semble poser problème : " Ledit sieur Berruyer nous a représenté une lettre du sieur Rozée du VIe de ce mois par laquelle il donne avis de l’arrivée et retour du capitaine de Drouault avec lequel la Compagnie avait traité pour livrer par lui en l’isle de la Guadeloupe soixante Nègres et Nègresses moyennant douze mille livres, à raison de 200 livres chacun Nègre, surquoi lui aurait été avancé 4000 livres dont ledit sieur Rozée avertit la Compagnie pour donner ordre que les 8000 livres restantes soient payées audit sieur Drouault ensemble deux Nègres qu’il a délivrés de plus que lesdits soixante à monsieur de Leumont à Saint-Christophe et neuf barils de farine d’orge pour nourrir lesdits Nègres à terre, et que ledit sieur Rozée remontre à la Compagnie qu’il a entrepris la dépense de la cargaison pour l’achat et livraison desdits Nègres principalement pour rendre service à la Compagnie afin qu’elle sache à l’avenir les moyens d’envoyer plus grand nombre de Nègres ès isles de l’Amérique, en quoi ledit sieur Rozée aurait été circonvenu, les Nègres ayant coûté beaucoup plus cher que ledit sieur Rozée ne croyait en partie parce que les Flamands en avaient enlevé grande quantité, partant, demandait à la Compagnie de ne pas rabattre sur ce qui était dû audit Drouault l’intérêt stipulé pour lesdits 4000 livres avancées, et que ce que ledit sieur Rozée a déclaré qu’il n’y avait aucun fonds pour satisfaire au payement de dudit capitaine Drouault."
L’activité sucrière va amplifier le besoin de main d'œuvre et donc la traite qui vient de débuter.
La condition des esclaves des français semble raisonnable pour l’époque : ils sont " honnestement traictez, ne différans en rien des serviteurs françois, sinon qu'ils sont serviteurs et servantes perpétuels à leurs maistres..."
1647 : Le R.P. Breton publie ses "Relations de l'île de Guadeloupe", il écrit :
" Aujourd'hui dans l'isle de la Guadeloupe…on y compte plus de 12.000 franscois catholicques. Il y a des noirs originaires d'Affrique vendus par leurs roys comme esclaves ou plutost comme betail pour les travaux serviles. Ilz sont a peu pres trois mille de l'ung et l'autre sexe. "
Laurens de Geers crée avec Henrik Caerloff la Compagnie Suédoise d'Afrique pour organiser la traite.
1649 : La Compagnie des Isles d’Amérique fait faillite, les îles vont être vendues successivement à leurs Seigneurs propriétaires.
Dans ces ventes était inclus maisons, forts, canons, munitions, marchandises et bien sûr esclaves appartenant à la Compagnie, ainsi que le passif.
Jean Rozée a rachété une part des actions de Fouquet (père) dans la Compagnie des Isles de l'Amérique.
Avec sa Compagnie, il fonde à St Louis du Sénégal une implantation permanente avec une habitation sous le contrôle du capitaine Thomas Lambert.
1640 : Début de la Guerre de Restauration : les Portugais veulent obtenir leur indépendance vis à vis de la monarchie Habsbourg qui gouverne l'Espagne. Elle va durer jusqu'en 1668, l'Espagne va être expulsée des côtes africaines, les communautés marranes d'Afrique qui était liées à la traite vont majoritairement émigrer au Brésil.
1643 : La Compagnie des Isles de l’Amérique a chargé la Compagnie de Jean Rozée, également actionnaire, de fournir des nègres pour son projet sucrier en Guadeloupe, 60 ont été livrés par le capitaine Drouault peu après la Pentecôte, à 200 livres pièce.
A la réunion des associés du 6 octobre, le règlement semble poser problème : " Ledit sieur Berruyer nous a représenté une lettre du sieur Rozée du VIe de ce mois par laquelle il donne avis de l’arrivée et retour du capitaine de Drouault avec lequel la Compagnie avait traité pour livrer par lui en l’isle de la Guadeloupe soixante Nègres et Nègresses moyennant douze mille livres, à raison de 200 livres chacun Nègre, surquoi lui aurait été avancé 4000 livres dont ledit sieur Rozée avertit la Compagnie pour donner ordre que les 8000 livres restantes soient payées audit sieur Drouault ensemble deux Nègres qu’il a délivrés de plus que lesdits soixante à monsieur de Leumont à Saint-Christophe et neuf barils de farine d’orge pour nourrir lesdits Nègres à terre, et que ledit sieur Rozée remontre à la Compagnie qu’il a entrepris la dépense de la cargaison pour l’achat et livraison desdits Nègres principalement pour rendre service à la Compagnie afin qu’elle sache à l’avenir les moyens d’envoyer plus grand nombre de Nègres ès isles de l’Amérique, en quoi ledit sieur Rozée aurait été circonvenu, les Nègres ayant coûté beaucoup plus cher que ledit sieur Rozée ne croyait en partie parce que les Flamands en avaient enlevé grande quantité, partant, demandait à la Compagnie de ne pas rabattre sur ce qui était dû audit Drouault l’intérêt stipulé pour lesdits 4000 livres avancées, et que ce que ledit sieur Rozée a déclaré qu’il n’y avait aucun fonds pour satisfaire au payement de dudit capitaine Drouault."
L’activité sucrière va amplifier le besoin de main d'œuvre et donc la traite qui vient de débuter.
La condition des esclaves des français semble raisonnable pour l’époque : ils sont " honnestement traictez, ne différans en rien des serviteurs françois, sinon qu'ils sont serviteurs et servantes perpétuels à leurs maistres..."
1647 : Le R.P. Breton publie ses "Relations de l'île de Guadeloupe", il écrit :
" Aujourd'hui dans l'isle de la Guadeloupe…on y compte plus de 12.000 franscois catholicques. Il y a des noirs originaires d'Affrique vendus par leurs roys comme esclaves ou plutost comme betail pour les travaux serviles. Ilz sont a peu pres trois mille de l'ung et l'autre sexe. "
Laurens de Geers crée avec Henrik Caerloff la Compagnie Suédoise d'Afrique pour organiser la traite.
1649 : La Compagnie des Isles d’Amérique fait faillite, les îles vont être vendues successivement à leurs Seigneurs propriétaires.
Dans ces ventes était inclus maisons, forts, canons, munitions, marchandises et bien sûr esclaves appartenant à la Compagnie, ainsi que le passif.
1650 : L'aventurier et négrier Henri Carolof (Henrik Caerloff pour les Hollandais) crée un fort, Carolusborg, pour la Compagnie Suédoise sur le comptoir portugais Cabo Corto.
1652 : Carolof crée, toujours pour la Compagnie Suédoise, le fort Christianborg à Accra pour la traite (actuel Ghana) sur l'emplacement du comptoir Crévecoeur crée par les Hollandais en 1642.
Ces 2 comptoirs seront repris par la Compagnie néerlandaise des Indes Occidentales en 1660.
1654 : Au Brésil, les Portugais ont repris Pernambuco, province que la Compagnie Hollandaise des Indes Occidentales avait conquise en 1630 et nommée Nouvelle Hollande…
La traite reste assurée essentiellement par les Hollandais.
1658 : La Compagnie Rozée devient Compagnie du Sénégal et du Cap Vert, toujours contrôlée par les négociants de Rouen, mais dont Jean Rozée père est exclut suite à des problèmes judiciaires, Jacques Bulteau père devient le plus important affréteur des navires, possédant alors 24/64e des parts.
1659 : La Compagnie du Sénégal et du Cap Vert fait construire à St Louis du Sénégal le fort St Louis pour sécuriser le commerce avec la France : la traite française s'organise...
On retrouve la trace d'un négrier français, le capitaine Gelée, parti de Dieppe pour prendre sa cargaison au Liberia actuel avec une destination finale non retrouvée...
1661 : Colbert prend la charge de Secrétaire d’Etat à la Marine, aux colonies et au commerce maritime : son intérêt pour le commerce sur la côte africaine va rapidement prendre corps...
Le dernier chapitre d'un " Mémoire contenant les avis et sentiments de differens capitaines de navires, voyageurs et autres sur les moyens de former des Establissements à l'Amérique " parle "De l'achat des Nègres":
" Si l'on vouloit freter un vaisseau pour envoyer faire un achat de nègres, il faudroit le freter a mois comme cy dessus. Il faudroit faire une provision de 13 ou 14 mille francs de marchandises avec quoy on pourroit avoir 350 negres et les vivres pour les nourrir que l'on acheteroit en Afrique mesme.."
1652 : Carolof crée, toujours pour la Compagnie Suédoise, le fort Christianborg à Accra pour la traite (actuel Ghana) sur l'emplacement du comptoir Crévecoeur crée par les Hollandais en 1642.
Ces 2 comptoirs seront repris par la Compagnie néerlandaise des Indes Occidentales en 1660.
1654 : Au Brésil, les Portugais ont repris Pernambuco, province que la Compagnie Hollandaise des Indes Occidentales avait conquise en 1630 et nommée Nouvelle Hollande…
La traite reste assurée essentiellement par les Hollandais.
1658 : La Compagnie Rozée devient Compagnie du Sénégal et du Cap Vert, toujours contrôlée par les négociants de Rouen, mais dont Jean Rozée père est exclut suite à des problèmes judiciaires, Jacques Bulteau père devient le plus important affréteur des navires, possédant alors 24/64e des parts.
1659 : La Compagnie du Sénégal et du Cap Vert fait construire à St Louis du Sénégal le fort St Louis pour sécuriser le commerce avec la France : la traite française s'organise...
On retrouve la trace d'un négrier français, le capitaine Gelée, parti de Dieppe pour prendre sa cargaison au Liberia actuel avec une destination finale non retrouvée...
1661 : Colbert prend la charge de Secrétaire d’Etat à la Marine, aux colonies et au commerce maritime : son intérêt pour le commerce sur la côte africaine va rapidement prendre corps...
Le dernier chapitre d'un " Mémoire contenant les avis et sentiments de differens capitaines de navires, voyageurs et autres sur les moyens de former des Establissements à l'Amérique " parle "De l'achat des Nègres":
" Si l'on vouloit freter un vaisseau pour envoyer faire un achat de nègres, il faudroit le freter a mois comme cy dessus. Il faudroit faire une provision de 13 ou 14 mille francs de marchandises avec quoy on pourroit avoir 350 negres et les vivres pour les nourrir que l'on acheteroit en Afrique mesme.."
" La condition de les acheter est ordinairement de deux negres grands et un petit tant femmes qu'hommes...ou pour mieux dire qu'ils ayent la force et la vigueur necessaire pour travailler sans considerer l'age "
" Aprez le contract on ne pourroit pas rendre les negres dans la temps de dix mois...parceque outre le voyage d'aller aux costes d'Affrique et de la aux Isles, il faut trois ou qutre mois de temps pour decharger sur le lieu les marcahndises, contracter et recharger les negres et ce qu'il faut "
" Pour le prix je crois qu'il faudra penser la comme deux cent cinquante livres la piece vendus aux Isles. Mr le Chevalier Houel en a offert jusque 350 monnoye de Hollande, mais il n'a rein conclu a cause des... qu'il falloit donner, car autrement on leur auroit accorder a bien moindre prix "
1663 : Un anonyme de Dieppe écrit : " il suffirait ... de 2 frégattes et 18 navires pour assurer le trafic sans oublier 2 grands navires basés à Dieppe pour aller à Angole et Guinée quérir des esclaves portant 500 esclaves chacun dont l’achat revient à 60 L. pièce "
1664 : Sur la demande de Colbert, le Roy crée par son Edit du 30 mai la Compagnie des Indes Occidentales.
1664 : Sur la demande de Colbert, le Roy crée par son Edit du 30 mai la Compagnie des Indes Occidentales.
Le Conseil du Roy lui donne le monopole des échanges commerciaux entre la France et "… toutes terres de notre obédience en Amérique du Nord et du Sud et aux îles d’Amérique " ainsi que dans les postes de la côte d’Afrique depuis le Cap-Vert jusqu’au Cap de Bonne-Espérance.
L’Édit confère aussi à la Compagnie tous droits seigneuriaux, avec pouvoir d'inféoder les terres des dites îles, et lui donne pour armoiries : d'azur, semé de fleurs de lys d'or; deux sauvages pour supports et une couronne ducale.
Le régime féodal reste donc en pleine vigueur dans nos colonies des Indes occidentales.
Les actionnaires ont 4 mois pour prendre des actions, le minimum étant de 3.000 livres. Les actionnaires entre 10 et 20.000 livres ont voix délibérative dans les assemblées, à partir de 20.000, ils peuvent être élus directeur, et, s’ils sont étranger, ils sont considérés comme français pendant l’association et peuvent obtenir des lettres de naturalisation au-delà de 20 ans.
Un des directeurs de la nouvelle Compagnie n’est autre que le chevalier Robert Houël, son frère Charles est aussi actionnaire...
Enfin, le Roy consent à avancer pendant 4 ans et sans intérêts 10% des actions.
Par le même Edit, la Compagnie est exemptée de la moitié des droits au départ et de 40 livres par tonneau à l'arrivée.
Colbert crée le lendemain 31 mai la Compagnie des Indes Orientales, qui ne nous concerne pas...
Pour encourager la colonisation par les nobles, un Edit au mois d’août, déclare qu'on peut entrer dans la Compagnie des Indes ou y participer sans déroger à sa noblesse.
La Compagnie de la France Equinoxiale a été absorbée.
La Compagnie des Indes rachète également la concession de la Compagnie du Sénégal et du Cap Vert à St Louis comme base de départ de sa traite: " Sa Majesté ne voulut pas toucher au commerce dudit Sénégal n’y faire aucun préjudice à ceux à qui il appartenait. Et c’est par cette raison que ledit édit ne donna à ladite Compagnie d’Occident que le commerce depuis le voyant bien que ce commerce d’Afrique étant en différentes mains se détruisait acquit le 28 novembre 1664 desdits marchands de Rouen, l’habitation du Sénégal, moyennant cent cinquante mil livres. "
A noter que les Dieppois Jean Rozée fils et Jacques Bulteau fils font aussi partie des actionnaires de la nouvelle Compagnie.
Les armateurs Dieppois disposent de 3 navires pour l'Afrique dont 2 de plus de 200 tonneaux et de 8 pour St Domingue, tous de moins de 200 tonneaux.
Henri Caroloff est engagé par Colbert comme conseiller pour le compte de la Compagnie des Indes Occidentales, il est plus simple de commencer avec des négriers qui travaillent déja pour la traite avec les Hollandais, et donc bénéficient déja des contacts avec les marchands et les rois locaux...
En juillet, la Compagnie des Indes Occidentales rachète les isles à leurs seigneurs...
2.700 esclaves en Martinique, 6.323 en Guadeloupe.
1665 : Le négrier Hollandais Caroloff a signé à Amsterdam un contrat avec la Compagnie des Indes Occidentales, dans lequel il s'engage à livrer des esclaves pendant 6 ans, payables en sucre.
Tous les vaisseaux de la nouvelle Compagnie française sont alors équipés à Amsterdam…
1666 : Négrier l’Europe, armé à Amsterdam, de Villaut de Bellefond : il écrira en 1670 sa " Relation des Costes d'Afrique appelées Guinée " avec une dédicace à Colbert...
L’Édit confère aussi à la Compagnie tous droits seigneuriaux, avec pouvoir d'inféoder les terres des dites îles, et lui donne pour armoiries : d'azur, semé de fleurs de lys d'or; deux sauvages pour supports et une couronne ducale.
Le régime féodal reste donc en pleine vigueur dans nos colonies des Indes occidentales.
Les actionnaires ont 4 mois pour prendre des actions, le minimum étant de 3.000 livres. Les actionnaires entre 10 et 20.000 livres ont voix délibérative dans les assemblées, à partir de 20.000, ils peuvent être élus directeur, et, s’ils sont étranger, ils sont considérés comme français pendant l’association et peuvent obtenir des lettres de naturalisation au-delà de 20 ans.
Un des directeurs de la nouvelle Compagnie n’est autre que le chevalier Robert Houël, son frère Charles est aussi actionnaire...
Enfin, le Roy consent à avancer pendant 4 ans et sans intérêts 10% des actions.
Par le même Edit, la Compagnie est exemptée de la moitié des droits au départ et de 40 livres par tonneau à l'arrivée.
Colbert crée le lendemain 31 mai la Compagnie des Indes Orientales, qui ne nous concerne pas...
Pour encourager la colonisation par les nobles, un Edit au mois d’août, déclare qu'on peut entrer dans la Compagnie des Indes ou y participer sans déroger à sa noblesse.
La Compagnie de la France Equinoxiale a été absorbée.
La Compagnie des Indes rachète également la concession de la Compagnie du Sénégal et du Cap Vert à St Louis comme base de départ de sa traite: " Sa Majesté ne voulut pas toucher au commerce dudit Sénégal n’y faire aucun préjudice à ceux à qui il appartenait. Et c’est par cette raison que ledit édit ne donna à ladite Compagnie d’Occident que le commerce depuis le voyant bien que ce commerce d’Afrique étant en différentes mains se détruisait acquit le 28 novembre 1664 desdits marchands de Rouen, l’habitation du Sénégal, moyennant cent cinquante mil livres. "
A noter que les Dieppois Jean Rozée fils et Jacques Bulteau fils font aussi partie des actionnaires de la nouvelle Compagnie.
Les armateurs Dieppois disposent de 3 navires pour l'Afrique dont 2 de plus de 200 tonneaux et de 8 pour St Domingue, tous de moins de 200 tonneaux.
Henri Caroloff est engagé par Colbert comme conseiller pour le compte de la Compagnie des Indes Occidentales, il est plus simple de commencer avec des négriers qui travaillent déja pour la traite avec les Hollandais, et donc bénéficient déja des contacts avec les marchands et les rois locaux...
En juillet, la Compagnie des Indes Occidentales rachète les isles à leurs seigneurs...
2.700 esclaves en Martinique, 6.323 en Guadeloupe.
1665 : Le négrier Hollandais Caroloff a signé à Amsterdam un contrat avec la Compagnie des Indes Occidentales, dans lequel il s'engage à livrer des esclaves pendant 6 ans, payables en sucre.
Tous les vaisseaux de la nouvelle Compagnie française sont alors équipés à Amsterdam…
1666 : Négrier l’Europe, armé à Amsterdam, de Villaut de Bellefond : il écrira en 1670 sa " Relation des Costes d'Afrique appelées Guinée " avec une dédicace à Colbert...
Il parle des comptoirs ou forts des Européens déja en place, de la concurrence entre Français, Hollandais, Portugais, Anglais, etc...des relations avec les rois nègres et des commerces en place, dont la traite.
A Marie Galante, le 1er recensement retrouve 490 habitants dont 209 esclaves..
A Marie Galante, le 1er recensement retrouve 490 habitants dont 209 esclaves..
1667 : Les armateurs de La Rochelle envoient un négrier, le Saint-Louis, capitaine Bocquet, qui va charger sa cargaison à St Louis du Sénégal pour une destination finale non retrouvée...
1669 : La Compagnie des Indes a repris 3 navires de la Compagnie dieppoise Rozée, le Florissant, le St Louis et le St Jean pour ses activités de traite.
Le surintendant Louis de Béchameil, actionnaire de la Compagnie, écrit au gouverneur de la Guadeloupe Du Lion :
"La Compagnie vous promet l’envoi des Negres et des Engagez mais je vois bien qu’elle ne peut y satisfaire aussy amplement qu’il le faut pour le bien des Isles"...
1669 : La Compagnie des Indes a repris 3 navires de la Compagnie dieppoise Rozée, le Florissant, le St Louis et le St Jean pour ses activités de traite.
Le surintendant Louis de Béchameil, actionnaire de la Compagnie, écrit au gouverneur de la Guadeloupe Du Lion :
"La Compagnie vous promet l’envoi des Negres et des Engagez mais je vois bien qu’elle ne peut y satisfaire aussy amplement qu’il le faut pour le bien des Isles"...
Compte-tenu du manque d'esclaves, le gouverneur de Marie Galante, le marquis de Téméricourt "a envoyé a Corosol (Curacao, déja hollandais) un vaisseau chercher des nègres"...
Le capitaine Louis Delbée, commissaire de la Marine, est envoyé en octobre 1669 par la Compagnie des Indes pour "entreprendre le commerce de Guynée et faire un establissement en la Coste d'Ardres", accompagné du négrier Carolof qui pratique la traite depuis longtemps, connait les comptoirs hollandais ou anglais ainsi que les rois locaux...
Il en fera un livre publié en 1671 : "Journal du voyage du Sr Delbée aux isles , dans la coste de Guinée"
Il en fera un livre publié en 1671 : "Journal du voyage du Sr Delbée aux isles , dans la coste de Guinée"
Le négrier Carolof pratique la traite entre le Havre, la côte de Guinée et les Antilles pour le compte de la Compagnie des Indes, il va livrer en 2 ans plus de 1000 esclaves dont 750 pour la Martinique.
1670 : Colbert souhaite reprendre des comptoirs en Afrique, en particulier aux Hollandais : il fait envoyer par le vice amiral Jean D'Estrées les capitaines de vaisseau Louis Ancelin de Gémozac et Louis de Hally en mission de reconnaissance sur les côtes de Guinée, à bord de la frégate Le Tourbillon. Ils doivent prendre contact avec les marchands et rois locaux dans le but de contracter des alliances sur place, avant une éventuelle tentative de reprise militaire...
Un " Arrest du Conseil d'Estat " concerne " les nègres de Guinée qui seront amenez aux Isles Françoises de l'Amérique" : il vise à favoriser la traite en supprimant le droit de 5% alors en cours :
1670 : Colbert souhaite reprendre des comptoirs en Afrique, en particulier aux Hollandais : il fait envoyer par le vice amiral Jean D'Estrées les capitaines de vaisseau Louis Ancelin de Gémozac et Louis de Hally en mission de reconnaissance sur les côtes de Guinée, à bord de la frégate Le Tourbillon. Ils doivent prendre contact avec les marchands et rois locaux dans le but de contracter des alliances sur place, avant une éventuelle tentative de reprise militaire...
Un " Arrest du Conseil d'Estat " concerne " les nègres de Guinée qui seront amenez aux Isles Françoises de l'Amérique" : il vise à favoriser la traite en supprimant le droit de 5% alors en cours :
2 navires négriers du capitaine Delbée, armés au Havre de Grâce, la Concorde et la Justice, ont pris leur cargaison à Ardres (Bénin) après avoir "traité et payé droit au Roy d'Ardres" et ont livré leurs nègres en Martinique, respectivement 433 et 323.
Le gouverneur général De Baas confirme l'arrivée de 310 nègres en Martinique sur le navire La Justice :
" Il en est mort plus de cent pendant sa navigation et quelques uns apres qu'ils ont este mis a terre "
Il rappelle qu'il " avois ordonné ...que les cargaisons des negres seroient distribuées egallement aux trois Isles " : St Christophe, Martinique et Guadeloupe.
Le gouverneur général De Baas confirme l'arrivée de 310 nègres en Martinique sur le navire La Justice :
" Il en est mort plus de cent pendant sa navigation et quelques uns apres qu'ils ont este mis a terre "
Il rappelle qu'il " avois ordonné ...que les cargaisons des negres seroient distribuées egallement aux trois Isles " : St Christophe, Martinique et Guadeloupe.
Le capitaine Joseph Gosselin de Dieppe part pour les Isles sur le navire L'Estoile : négrier ?
Le "Procès verbal de distribution des neigres entre certains habitants de la Guadeloupe" est probablement consécutif à l'une de ces livraisons, il nous donne le nom des acquéreurs, le nombre d'esclaves vendus ou attribués " pièces d’Inde mâles, femelles, vieux, vieilles, jeunes, négrillons " et le montant de la vente :
Le "Procès verbal de distribution des neigres entre certains habitants de la Guadeloupe" est probablement consécutif à l'une de ces livraisons, il nous donne le nom des acquéreurs, le nombre d'esclaves vendus ou attribués " pièces d’Inde mâles, femelles, vieux, vieilles, jeunes, négrillons " et le montant de la vente :
Les premiers servis ont droit à des " neigres de choix ou de préférence " : la Compagnie en a acheté 7 pour 10.000 livres, De Baas 2 pour 5.000 livres, Du Lion 8 pour 20.000, De Saint Laurens 6 pour 15.000, Hinselin 4 pour 10.000, etc…
Le prix moyen de ces esclaves de choix est donc de 2.500 livres.
Les autres habitants ont droit à une " distribution au sort ou par billet "
Sont concernés : Houël avec 4 esclaves pour 7.099 livres, Téméricourt avec 4 pour 7.916 livres, les religieux ne sont pas de reste : les Carmes en ont acheté 4, les Jacobins 4 et les Jésuites 2. Suivent 125 habitants…
Le prix moyen de ces esclaves tirés au sort est donc de moins de 2.000 livres. Le total de la vente des 332 esclaves a rapporté 718.750 livres.
On sait de plus que sur ces 332 esclaves, il y avait 124 hommes, 101 femmes, 29 vieux et 78 enfants et que 3 sont " morts à terre et à bord " et 3 sont malades et n’ont pu être vendus…
61 de ces esclaves étaient destinés à Marie Galante, 20 hommes, 20 femmes, 15 enfants et 6 suragés, pour un montant total de 132.916 livres.
Peu d’esclaves sont arrivés dans les îles, mais les mauvais traitements de certains colons sont déjà flagrants : une Ordonnance du Roy du 20 octobre précise que " nul n’a le droit de mutiler la chair et de répandre le sang des esclaves "...
1671 : Début de la Guerre de Hollande, qui va donner lieu à des affrontements également aux Antilles ou sur la côte africaine...
Le 18 septembre, nouvel " Arrest du Conseil d'Estat " pour favoriser la traite : suppression des droits de sortie sur les marchandises " portées aux Costes de Guinée", qui servent essentiellement à financer la traite sur place...
Le prix moyen de ces esclaves de choix est donc de 2.500 livres.
Les autres habitants ont droit à une " distribution au sort ou par billet "
Sont concernés : Houël avec 4 esclaves pour 7.099 livres, Téméricourt avec 4 pour 7.916 livres, les religieux ne sont pas de reste : les Carmes en ont acheté 4, les Jacobins 4 et les Jésuites 2. Suivent 125 habitants…
Le prix moyen de ces esclaves tirés au sort est donc de moins de 2.000 livres. Le total de la vente des 332 esclaves a rapporté 718.750 livres.
On sait de plus que sur ces 332 esclaves, il y avait 124 hommes, 101 femmes, 29 vieux et 78 enfants et que 3 sont " morts à terre et à bord " et 3 sont malades et n’ont pu être vendus…
61 de ces esclaves étaient destinés à Marie Galante, 20 hommes, 20 femmes, 15 enfants et 6 suragés, pour un montant total de 132.916 livres.
Peu d’esclaves sont arrivés dans les îles, mais les mauvais traitements de certains colons sont déjà flagrants : une Ordonnance du Roy du 20 octobre précise que " nul n’a le droit de mutiler la chair et de répandre le sang des esclaves "...
1671 : Début de la Guerre de Hollande, qui va donner lieu à des affrontements également aux Antilles ou sur la côte africaine...
Le 18 septembre, nouvel " Arrest du Conseil d'Estat " pour favoriser la traite : suppression des droits de sortie sur les marchandises " portées aux Costes de Guinée", qui servent essentiellement à financer la traite sur place...
Recensement des Isles d’Amérique, au total 16.661 neigres dans nos 8 Isles françoises.
Plus que 4.627 esclaves en Guadeloupe, 1700 de moins qu’en 1664.
Pour Mariegalande 704 "neigres" (57%), dont 176 "neigrillons et neigrites" et 6 "mulastres".
Navire négrier français, mais armé à Amsterdam, l'Espérance, qui apporte 44 esclaves en Martinique.
Autre négrier, armé à La Rochelle, l'Hirondelle, capitaine Le Jey, qui chargera en Côte d'Or pour une destination finale non précisée...
1672 : En Angleterre, le Duc d’York crée la Royal African Company pour approvisionner en esclaves la très rentable culture du sucre dans les West Indies.
Elle fait construire des dizaines de forts en Afrique pour ses comptoirs de traite.
Le roi Guillaume III autorise tous ses sujets à pratiquer la traite.
Premier navire négrier "officiel" au départ de Bordeaux, armé par la Compagnie des Indes : le Saint Étienne de Paris, 180 tonneaux, 14 canons, capitaine Jean Le Cordier : Il part faire sa traite en Guinée à destination de St Domingue et la Tortue.
Autre négrier de Dieppe, le St François, capitaine Mallet, qui a chargé au Cap Vert et amené 210 esclaves en Guadeloupe.
Négrier de La Rochelle, le Saint-François, qui charge en Guinée et vend 171 esclaves en Martinique.
Le gouverneur Du Lion écrit le 15 mars : " Mr Carolof (négrier hollandais propriétaire d'une habitation en Guadeloupe) est enfin arrivé avec 361 neigres dans cette isle, le tiers desquels est destiné pour Mariegalante "
Carolof commandait un navire de la Compagnie des Indes et avait chargé ses esclaves à Ouidah (actuel Ghana)
Pour Mariegalande 704 "neigres" (57%), dont 176 "neigrillons et neigrites" et 6 "mulastres".
Navire négrier français, mais armé à Amsterdam, l'Espérance, qui apporte 44 esclaves en Martinique.
Autre négrier, armé à La Rochelle, l'Hirondelle, capitaine Le Jey, qui chargera en Côte d'Or pour une destination finale non précisée...
1672 : En Angleterre, le Duc d’York crée la Royal African Company pour approvisionner en esclaves la très rentable culture du sucre dans les West Indies.
Elle fait construire des dizaines de forts en Afrique pour ses comptoirs de traite.
Le roi Guillaume III autorise tous ses sujets à pratiquer la traite.
Premier navire négrier "officiel" au départ de Bordeaux, armé par la Compagnie des Indes : le Saint Étienne de Paris, 180 tonneaux, 14 canons, capitaine Jean Le Cordier : Il part faire sa traite en Guinée à destination de St Domingue et la Tortue.
Autre négrier de Dieppe, le St François, capitaine Mallet, qui a chargé au Cap Vert et amené 210 esclaves en Guadeloupe.
Négrier de La Rochelle, le Saint-François, qui charge en Guinée et vend 171 esclaves en Martinique.
Le gouverneur Du Lion écrit le 15 mars : " Mr Carolof (négrier hollandais propriétaire d'une habitation en Guadeloupe) est enfin arrivé avec 361 neigres dans cette isle, le tiers desquels est destiné pour Mariegalante "
Carolof commandait un navire de la Compagnie des Indes et avait chargé ses esclaves à Ouidah (actuel Ghana)
" En l'an 1670, j'eus l'honneur de vous escrire que les habitans trouvoient a redire de ce que la Compagnie faisoit vendre les neigres 2500 et 3000 livres de sucre la pièce, qui n'auroient esté vendus jusque là que 2000 livres les meilleurs; et que je prévoyois que le dessein de la dite Comp. estois de faire monter encor le prix plus haut. Cela est arrivé cette fois, Monseigneur, puisque Mr Pelissier a donné ordre au Sr Poluche de vendre les bons neigres 4000 livres la pièce, lequel execute cet ordre avec tant de rigueur qu'il fait passer parmy les bons un grand nombre de médiocres...les habitans sont peu empressés pour en acheter et s'ils demeurent à ce prix là, on n'entendra plus parler d'augmentation de culture et de défrichements"
"Les habitans sont a plaindre par cette cherté et les marchands aussy...Je plains par cette considération les Nantois dés a présent qu'ils ont mandé qu'ils esquipoient 17 vaisseaux pour les Isles depuis qu'ils avoient obtenu permission d'y venir et de faire leur retours dans les ports de Bretagne"
Première révolte d’esclaves en Jamaïque, avec les premières bandes de "maroons"...
1673 : Suite à un Arrest du Roy et devant une quasi faillite, la concession en Afrique de la Compagnie des Indes héritée de la première Compagnie du Sénégal est vendue le 8 novembre à un groupe de financiers parisiens, composé principalement de Maurice Egrot, secrétaire du roi, François François, bourgeois et de François Raguenet, marchand, constituant la nouvelle Compagnie Royale du Sénégal : " consistant en plusieurs batiments, tourelles, forts et enclos, appartenances et dépendances tant en l'islette appelée Saint-Louis qu'ailleurs appartenante à ladite Compagnie au moyen de l'acquisition qu'elle en a faite des Sieurs Fernand Rosée, Quenet et autres marchands de Rouen par contrat passé par-devant Le Bœuf et Baudry le 28 novembre 1664 avec tout droit de traite, faculté et privilège de commerce dans l'étendue du pays de Sénégal, du Cap Vert et lieux circumvoisins jusques et y compris la Rivière de Gambie et autres rivières, costes, ports et havres dont la compagnie a la concession "
La vente se fait pour 75.000 livres, la moitié de sa valeur en 1664...
La nouvelle Compagnie reçoit le monopole de la traite sur " les costes d'Afrique depuis le Cap Vert jusqu'au cap de Bonne-Espérance...tant et si avant qu'elle pourra s'estendre dans les terres, soit que les dits pays nous appartiennent, soit que la Compagnie s'y establisse en chassant les sauvages et naturels du pays, ou les autres nations qui ne sont pas de notre alliance..."
1674 : Colbert avait fait envoyer en 1670 par le vice-amiral d'Estrées les capitaines de vaisseau Louis de Hally et Louis Ancelin de Gémozac en mission de reconnaissance sur les côtes d'Afrique, avant une éventuelle reprise de comptoirs hollandais par les armes...
Louis de Hally en avait fait une version manuscrite en 1671, Louis de Gémozac publie anonymement un livre :
" Relation du voyage fait sur les costes d'Afrique aux mois de Novembre & Decembre de l'année 1670. Janvier & Février 1671. commençant au Cap Verd "
En décembre, " Édit portant révocation de la Compagnie des Indes occidentales et union au Domaine de la Couronne, des terres, isles, pays et droits de ladite Compagnie, avec permission à tous les sujets de Sa Majesté d’y trafiquer " qui sera enregistré en février suivant : " Nous avons unis & incorporé, unissons & incorporons au Domaine de notre Couronne toutes les Terres & Païs (y la part restante audit Sieur Houel en la proprieté & Seigneurie de ladite Isle de la Guadeloupe) qui appartenoient à ladite Compagnie, tant au moyen des Concessions que Nous lui avons faites par l'Edit de son établissement, qu'en vertu des Contrats d'acquisition..."
"Les habitans sont a plaindre par cette cherté et les marchands aussy...Je plains par cette considération les Nantois dés a présent qu'ils ont mandé qu'ils esquipoient 17 vaisseaux pour les Isles depuis qu'ils avoient obtenu permission d'y venir et de faire leur retours dans les ports de Bretagne"
Première révolte d’esclaves en Jamaïque, avec les premières bandes de "maroons"...
1673 : Suite à un Arrest du Roy et devant une quasi faillite, la concession en Afrique de la Compagnie des Indes héritée de la première Compagnie du Sénégal est vendue le 8 novembre à un groupe de financiers parisiens, composé principalement de Maurice Egrot, secrétaire du roi, François François, bourgeois et de François Raguenet, marchand, constituant la nouvelle Compagnie Royale du Sénégal : " consistant en plusieurs batiments, tourelles, forts et enclos, appartenances et dépendances tant en l'islette appelée Saint-Louis qu'ailleurs appartenante à ladite Compagnie au moyen de l'acquisition qu'elle en a faite des Sieurs Fernand Rosée, Quenet et autres marchands de Rouen par contrat passé par-devant Le Bœuf et Baudry le 28 novembre 1664 avec tout droit de traite, faculté et privilège de commerce dans l'étendue du pays de Sénégal, du Cap Vert et lieux circumvoisins jusques et y compris la Rivière de Gambie et autres rivières, costes, ports et havres dont la compagnie a la concession "
La vente se fait pour 75.000 livres, la moitié de sa valeur en 1664...
La nouvelle Compagnie reçoit le monopole de la traite sur " les costes d'Afrique depuis le Cap Vert jusqu'au cap de Bonne-Espérance...tant et si avant qu'elle pourra s'estendre dans les terres, soit que les dits pays nous appartiennent, soit que la Compagnie s'y establisse en chassant les sauvages et naturels du pays, ou les autres nations qui ne sont pas de notre alliance..."
1674 : Colbert avait fait envoyer en 1670 par le vice-amiral d'Estrées les capitaines de vaisseau Louis de Hally et Louis Ancelin de Gémozac en mission de reconnaissance sur les côtes d'Afrique, avant une éventuelle reprise de comptoirs hollandais par les armes...
Louis de Hally en avait fait une version manuscrite en 1671, Louis de Gémozac publie anonymement un livre :
" Relation du voyage fait sur les costes d'Afrique aux mois de Novembre & Decembre de l'année 1670. Janvier & Février 1671. commençant au Cap Verd "
En décembre, " Édit portant révocation de la Compagnie des Indes occidentales et union au Domaine de la Couronne, des terres, isles, pays et droits de ladite Compagnie, avec permission à tous les sujets de Sa Majesté d’y trafiquer " qui sera enregistré en février suivant : " Nous avons unis & incorporé, unissons & incorporons au Domaine de notre Couronne toutes les Terres & Païs (y la part restante audit Sieur Houel en la proprieté & Seigneurie de ladite Isle de la Guadeloupe) qui appartenoient à ladite Compagnie, tant au moyen des Concessions que Nous lui avons faites par l'Edit de son établissement, qu'en vertu des Contrats d'acquisition..."
La Compagnie est dissoute après avoir accusé un passif de 3.523.000 livres-tournois. Le Roi se charge d’éteindre sa dette et lui rembourse son capital de 1.297.185 livres.
1675 : Un Arrêt du Conseil d’Etat du 26 octobre nomme Jean Oudiette " Fermier général du Domaine Royal d'Occident ... dans les Isles et Terre Ferme de l'Amérique " : Il est chargé de percevoir les droits de poids et de capitation dans les îles, il s’engage à introduire 800 nègres par an pendant 4 ans, moyennant une prime de 13 livres par tête.
1675 : Un Arrêt du Conseil d’Etat du 26 octobre nomme Jean Oudiette " Fermier général du Domaine Royal d'Occident ... dans les Isles et Terre Ferme de l'Amérique " : Il est chargé de percevoir les droits de poids et de capitation dans les îles, il s’engage à introduire 800 nègres par an pendant 4 ans, moyennant une prime de 13 livres par tête.
Jacques Savary publie à Paris "Le parfait Négociant ou instruction générale pour ce qui concerne le commerce de toute sorte de Marchandises, tant de France que des Pays Estrangers", avec une dédicace à Colbert. Il justifie la traite :
" Ce commerce paraît inhumain à ceux qui ne savent pas que ces pauvres gens sont idolâtres ou mahométans, et que les marchands chrétiens en les achetant de leurs ennemis, les tirent d’un cruel esclavage et leur font trouver dans les îles où ils sont portés, non seulement une servitude plus douce, mais même la connaissance du vrai Dieu et la voie du salut par les bonnes instructions que leur donnent les Prêtres et Religieux qui prennent le soin de les faire Chrétiens..."
1676 : Le négrier Carolof ne travaille plus pour la France: il a négocié avec la couronne hollandaise l'implantation de nouveaux colons à Tobago, avec l'accord du roi Guillaume III d'Orange-Nassau.
A Marie-Galante, le 31 mai, attaque des Hollandais, avec une escadre commandée par l'amiral Jacob Benckes, accompagné des Carolof, père et fils...
Ils repartent le 12 juin, après 11 jours d'un pillage minutieux et en emportant la quasi-totalité des esclaves et une partie des colons à destination de Tobago…
Cf Histoire sucrière
1677 : Le Conseil Souverain de la Martinique prend un "Reglement pour les Negres" en 7 articles :
- Le vol de cochons, cabrittes, moutons, vollailles est puni par une oreille coupée et en cas de récidive le jarret tranché.
- Le vol de chevaux, boeufs, vaches et bourriques est puni par un jarret tranché la première fois, par l'étranglement en cas de récidive.
- Le marronage est puni selon sa durée par le fouet, puis l'oreille tranchée, puis le jarret.
- Tout nègre qui aura frappé un blanc sera étranglé.
Etc...
1676 : Le négrier Carolof ne travaille plus pour la France: il a négocié avec la couronne hollandaise l'implantation de nouveaux colons à Tobago, avec l'accord du roi Guillaume III d'Orange-Nassau.
A Marie-Galante, le 31 mai, attaque des Hollandais, avec une escadre commandée par l'amiral Jacob Benckes, accompagné des Carolof, père et fils...
Ils repartent le 12 juin, après 11 jours d'un pillage minutieux et en emportant la quasi-totalité des esclaves et une partie des colons à destination de Tobago…
Cf Histoire sucrière
1677 : Le Conseil Souverain de la Martinique prend un "Reglement pour les Negres" en 7 articles :
- Le vol de cochons, cabrittes, moutons, vollailles est puni par une oreille coupée et en cas de récidive le jarret tranché.
- Le vol de chevaux, boeufs, vaches et bourriques est puni par un jarret tranché la première fois, par l'étranglement en cas de récidive.
- Le marronage est puni selon sa durée par le fouet, puis l'oreille tranchée, puis le jarret.
- Tout nègre qui aura frappé un blanc sera étranglé.
Etc...
L’escadre de l’Amiral d’Estrées prend possession le 1er novembre de l’île de Gorée, qui va devenir notre principal comptoir de traite.
Il prend aussi aux Hollandais leurs comptoirs de Rufisque, Joal et Portudal sur la Petite Côte du Sénégal.
Gorée nous sera cédée officiellement par le Traité de Nimègue l'année suivante.
L'intendant général nous précise l'arrivée en Martinique d'un négrier de la Compagnie du Sénégal, capitaine Le Moyde, avec 80 nègres. Est attendue aussi une flûte de la même Compagnie armé à La Rochelle, Le St François, capitaine Duport, avec 250 nègres.
Il prend aussi aux Hollandais leurs comptoirs de Rufisque, Joal et Portudal sur la Petite Côte du Sénégal.
Gorée nous sera cédée officiellement par le Traité de Nimègue l'année suivante.
L'intendant général nous précise l'arrivée en Martinique d'un négrier de la Compagnie du Sénégal, capitaine Le Moyde, avec 80 nègres. Est attendue aussi une flûte de la même Compagnie armé à La Rochelle, Le St François, capitaine Duport, avec 250 nègres.
2 autres navires de la même Compagnie sont partis faire leur traite : L'Arondelle, l'Ambuscade et une corvette.
1678 : Le négrier de La Rochelle Soleil d'Affrique, capitaine Barbot, part charger à Ardres, actuel Dahomey, et vendra sa traite en Martinique.
1679 : L’Arrêt de Jean Oudiette de 1675 est cassé par le Roy le 21 mars, remplacé par un " Traité fait entre les sieurs directeurs généraux du Domaine royal d’Occident et la Compagnie du Sénégal pour faire par elle seule le commerce de la Côte d’Afrique, tant marchandises, que Nègres, à l’exclusion de tous autres François " signé par les sieurs François Bellinzany et Guillaume Menager d'une part, directeurs généraux du Domaine, et les sieurs François François et René Bains, directeurs généraux de la Compagnie du Sénégal.
Lui succède le 25 mars un "Arrest du Conseil d'Etat, qui approuve le Commerce de la Compagnie du Sénégal en la Côte d'Afrique, tant en Marchandises qu'en Négres , à l'exclusion de tous autres"
Cette nouvelle Compagnie du Sénégal arrive ainsi au 1er plan de la traite française, elle s'engage à transporter 2000 esclaves chaque année pour une durée de 8 ans de l’Afrique aux îles de l’Amérique (Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, Grenade, Marie-Galante, Sainte-Croix, Saint-Martin, la Tortue, Saint-Domingue) et à Cayenne à raison de treize livres par tête.
Le 10 juillet, des " Lettres Patentes du Roy , portant confirmation de la Compagnie du Sénégal & de ses Privileges " maintiennent les avantages du Domaine d'Occident à la nouvelle Compagnie...
Plus de 8.000 esclaves ont déjà été déportés pour les "Isles Françoises"…
Ces nouvelles compagnies anglaises et françaises font baisser le coût de la traversée, entrant en concurrence avec les Hollandais, dont le système de traite était déjà bien en place.
Leur arrivée sur les côtes d'Afrique fait augmenter le prix des esclaves, majorant la traite intra-africaine en stimulant les guerres tribales…
1680 : Le recensement de Mariegalante, 4 ans après l'attaque hollandaise, ne retrouve plus que 277 blancs et 163 noirs...
En Guadeloupe, la population d’esclaves a encore baissé : 2.950, alors qu’elle a presque doublé en Martinique : 4.900.
On recense 314 mulâtres en Martinique, 170 en Guadeloupe et seulement 350 à la Barbade, où la population d'esclaves est pourtant 8 fois plus nombreuse, mais où ont été votées dans les années 1660 des lois très sévères en la matière.
D'où le 1er juin, un " Arrêt du Conseil supérieur de la Guadeloupe qui ordonne que tout enfant né de négresses esclaves procréées de blancs ou d'indiens seront et resteront esclaves, excepté ceux qui jouissent à présent de leur liberté "...
La nouvelle Compagnie du Sénégal ne va pas bien : " Arrest qui ordonne que les interessez et associez en la Compagnie du Sénégal et Coste de Guinée continuieront comme cy devant leur commerce dans tous les lieux de leur concession, et cependant sa Majesté leur accordé un delay de deux ans pour satisfaire leurs créanciers "
1681 : Louis XIV décide la création d'un statut pour les noirs des Îles d'Amériques et charge Colbert de s'en occuper.
Colbert donne alors mission à l'intendant Patoulet et au gouverneur général des Antilles Charles de Courbon.
La première lettre de Colbert à l'intendant est rédigée ainsi :
" Sa Majesté estime nécessaire de régler par une déclaration tout ce qui concerne les nègres dans les isles, tant pour la punition de leurs crimes que pour tout ce qui peut regarder la justice qui leur doit être rendue, et c'est pour cela qu'il faut que vous fassiez un mémoire le plus exact et le plus étendu qu'il sera possible, qui comprenne tous les cas qui peuvent avoir rapport aux dits nègres en quelque manière que ce puisse être qui mériteraient d'être réglés par un ordre et vous devez bien connaître l'usage observé jusqu'à présent dans les isles et votre avis sur ce qui devrait être observé à l'avenir. "
Il faudra quatre ans, avec brouillon, rapport préliminaire, avant-projet de 52 articles, ainsi que les instructions du roi pour aboutir aux 60 articles du " Code Noir "…
La Compagnie du Sénégal est revendue à un nouveau groupe d’investisseurs réunis autour des " directeur et intéressez en la Compagnie du Sénégal et Coste d'Afrique ", le nouveau directeur est l’ancien corsaire Jean-Baptiste du Casse, aussi propriétaire d’une grande habitation à St Domingue.
Cette Nouvelle Compagnie du Sénégal et Coste d'Afrique est établie par Lettres patentes le 2 juillet : elle reçoit la capacité de traiter du Cap Vert au Cap de Bonne Esperance, de conclure des traités avec " les Roys noirs " ainsi que le monopole de traite négrière dans l’Atlantique. L’écusson de la Compagnie est donné dans l’article XI, " en champ d’Azur semé de Fleurs de Lys d’Or sans nombre, deux Nègres pour support et une Couronne tréflée ". Elle sera enregistrée en janvier suivant.
Elle rencontre rapidement quelques difficultés, la dette héritée de l’ancienne compagnie se montait à environ 1.000.000 de livres…
Le capitaine rochelais Barbot commande un autre navire de traite, le Joly qui va va charger en Guinée et vend ses esclaves aux Antilles, destination non précisée.
1682 : La Rochelle arme un négrier qui prendra sa cargaison à Ouidah et livrera ses nègres en Martinique.
Autre négrier de La Rochelle, le Soleil d'Affrique, capitaine la Ramée, qui lui chargera à St Louis du Sénégal.
1683 : Mort de Colbert.
Les armateurs de La Rochelle envoie le négrier Le Conquis, capitaine La Guyolle, qui prendra sa cargaison à St Louis du Sénégal et vendra ses nègres dans une de nos isles non précisée...
Recensement de Mariegalante : 1.029 âmes dont 598 esclaves (58%), 498 nègres et nègresses "travaillans", 100 negrillons et négrites.
1684 : 2ème négrier bordelais, armé par la Compagnie, capitaine Joseph Trébuchet, qui part faire sa traite en Guinée et livrera ses nègres en Martinique.
Le négrier l'Etoile d'Or, capitaine Chaboisseau, armé à La Rochelle, a embarqué sa cargaison à Gorée au Sénégal et livré ses nègres à St Domingue.
Les armateurs de Brest envoient le négrier La Sirène, capitaine Duvigneau, charger également à Gorée pour une destination finale non retrouvée.
Le nouveau secrétaire d’Etat, le marquis de Seignelay, fils de Colbert, demande au Roy de créer une nouvelle compagnie, la Compagnie de Guinée, pour diversifier la traite et améliorer l’approvisionnement en nègres des Antilles et de la Guyane : il réduit la concession territoriale de la Compagnie du Sénégal pour établir cette nouvelle Compagnie, ce qui sera source de contestations jusqu'à l'année suivante...
Les 9 associés, Messieurs Mathé de Vitry la Ville , du Ruau-Palu , de Lagny , Carrel , Parent , Dumas , Gayardon, Rolland et Ceberer s'engagent à faire pendant 20 ans " le commerce des nègres, de la poudre d’or et de toutes les autres marchandises " aux rivières de Casamance, Cacheu, Rio Grande et Niger incluant l’établissement à Ouidah"
1685 : En janvier, " Déclaration du Roy pour l'establissement d'une Compagnie sous le titre de la Compagnie de Guinée, qui fera seule, à l'exclusion des autres, le commerce de nègres, de la poudre d'or et de toutes autres marcahndises qu'elleporra traister aux Costes d'Afrique depuis la rivière de Serre-Lyonne inclusivement jusques au Cap de Bonne Espérance"
En mars, " Edit du Roy ou Code Noir sur les esclaves des Isles de l’Amérique " :
1678 : Le négrier de La Rochelle Soleil d'Affrique, capitaine Barbot, part charger à Ardres, actuel Dahomey, et vendra sa traite en Martinique.
1679 : L’Arrêt de Jean Oudiette de 1675 est cassé par le Roy le 21 mars, remplacé par un " Traité fait entre les sieurs directeurs généraux du Domaine royal d’Occident et la Compagnie du Sénégal pour faire par elle seule le commerce de la Côte d’Afrique, tant marchandises, que Nègres, à l’exclusion de tous autres François " signé par les sieurs François Bellinzany et Guillaume Menager d'une part, directeurs généraux du Domaine, et les sieurs François François et René Bains, directeurs généraux de la Compagnie du Sénégal.
Lui succède le 25 mars un "Arrest du Conseil d'Etat, qui approuve le Commerce de la Compagnie du Sénégal en la Côte d'Afrique, tant en Marchandises qu'en Négres , à l'exclusion de tous autres"
Cette nouvelle Compagnie du Sénégal arrive ainsi au 1er plan de la traite française, elle s'engage à transporter 2000 esclaves chaque année pour une durée de 8 ans de l’Afrique aux îles de l’Amérique (Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, Grenade, Marie-Galante, Sainte-Croix, Saint-Martin, la Tortue, Saint-Domingue) et à Cayenne à raison de treize livres par tête.
Le 10 juillet, des " Lettres Patentes du Roy , portant confirmation de la Compagnie du Sénégal & de ses Privileges " maintiennent les avantages du Domaine d'Occident à la nouvelle Compagnie...
Plus de 8.000 esclaves ont déjà été déportés pour les "Isles Françoises"…
Ces nouvelles compagnies anglaises et françaises font baisser le coût de la traversée, entrant en concurrence avec les Hollandais, dont le système de traite était déjà bien en place.
Leur arrivée sur les côtes d'Afrique fait augmenter le prix des esclaves, majorant la traite intra-africaine en stimulant les guerres tribales…
1680 : Le recensement de Mariegalante, 4 ans après l'attaque hollandaise, ne retrouve plus que 277 blancs et 163 noirs...
En Guadeloupe, la population d’esclaves a encore baissé : 2.950, alors qu’elle a presque doublé en Martinique : 4.900.
On recense 314 mulâtres en Martinique, 170 en Guadeloupe et seulement 350 à la Barbade, où la population d'esclaves est pourtant 8 fois plus nombreuse, mais où ont été votées dans les années 1660 des lois très sévères en la matière.
D'où le 1er juin, un " Arrêt du Conseil supérieur de la Guadeloupe qui ordonne que tout enfant né de négresses esclaves procréées de blancs ou d'indiens seront et resteront esclaves, excepté ceux qui jouissent à présent de leur liberté "...
La nouvelle Compagnie du Sénégal ne va pas bien : " Arrest qui ordonne que les interessez et associez en la Compagnie du Sénégal et Coste de Guinée continuieront comme cy devant leur commerce dans tous les lieux de leur concession, et cependant sa Majesté leur accordé un delay de deux ans pour satisfaire leurs créanciers "
1681 : Louis XIV décide la création d'un statut pour les noirs des Îles d'Amériques et charge Colbert de s'en occuper.
Colbert donne alors mission à l'intendant Patoulet et au gouverneur général des Antilles Charles de Courbon.
La première lettre de Colbert à l'intendant est rédigée ainsi :
" Sa Majesté estime nécessaire de régler par une déclaration tout ce qui concerne les nègres dans les isles, tant pour la punition de leurs crimes que pour tout ce qui peut regarder la justice qui leur doit être rendue, et c'est pour cela qu'il faut que vous fassiez un mémoire le plus exact et le plus étendu qu'il sera possible, qui comprenne tous les cas qui peuvent avoir rapport aux dits nègres en quelque manière que ce puisse être qui mériteraient d'être réglés par un ordre et vous devez bien connaître l'usage observé jusqu'à présent dans les isles et votre avis sur ce qui devrait être observé à l'avenir. "
Il faudra quatre ans, avec brouillon, rapport préliminaire, avant-projet de 52 articles, ainsi que les instructions du roi pour aboutir aux 60 articles du " Code Noir "…
La Compagnie du Sénégal est revendue à un nouveau groupe d’investisseurs réunis autour des " directeur et intéressez en la Compagnie du Sénégal et Coste d'Afrique ", le nouveau directeur est l’ancien corsaire Jean-Baptiste du Casse, aussi propriétaire d’une grande habitation à St Domingue.
Cette Nouvelle Compagnie du Sénégal et Coste d'Afrique est établie par Lettres patentes le 2 juillet : elle reçoit la capacité de traiter du Cap Vert au Cap de Bonne Esperance, de conclure des traités avec " les Roys noirs " ainsi que le monopole de traite négrière dans l’Atlantique. L’écusson de la Compagnie est donné dans l’article XI, " en champ d’Azur semé de Fleurs de Lys d’Or sans nombre, deux Nègres pour support et une Couronne tréflée ". Elle sera enregistrée en janvier suivant.
Elle rencontre rapidement quelques difficultés, la dette héritée de l’ancienne compagnie se montait à environ 1.000.000 de livres…
Le capitaine rochelais Barbot commande un autre navire de traite, le Joly qui va va charger en Guinée et vend ses esclaves aux Antilles, destination non précisée.
1682 : La Rochelle arme un négrier qui prendra sa cargaison à Ouidah et livrera ses nègres en Martinique.
Autre négrier de La Rochelle, le Soleil d'Affrique, capitaine la Ramée, qui lui chargera à St Louis du Sénégal.
1683 : Mort de Colbert.
Les armateurs de La Rochelle envoie le négrier Le Conquis, capitaine La Guyolle, qui prendra sa cargaison à St Louis du Sénégal et vendra ses nègres dans une de nos isles non précisée...
Recensement de Mariegalante : 1.029 âmes dont 598 esclaves (58%), 498 nègres et nègresses "travaillans", 100 negrillons et négrites.
1684 : 2ème négrier bordelais, armé par la Compagnie, capitaine Joseph Trébuchet, qui part faire sa traite en Guinée et livrera ses nègres en Martinique.
Le négrier l'Etoile d'Or, capitaine Chaboisseau, armé à La Rochelle, a embarqué sa cargaison à Gorée au Sénégal et livré ses nègres à St Domingue.
Les armateurs de Brest envoient le négrier La Sirène, capitaine Duvigneau, charger également à Gorée pour une destination finale non retrouvée.
Le nouveau secrétaire d’Etat, le marquis de Seignelay, fils de Colbert, demande au Roy de créer une nouvelle compagnie, la Compagnie de Guinée, pour diversifier la traite et améliorer l’approvisionnement en nègres des Antilles et de la Guyane : il réduit la concession territoriale de la Compagnie du Sénégal pour établir cette nouvelle Compagnie, ce qui sera source de contestations jusqu'à l'année suivante...
Les 9 associés, Messieurs Mathé de Vitry la Ville , du Ruau-Palu , de Lagny , Carrel , Parent , Dumas , Gayardon, Rolland et Ceberer s'engagent à faire pendant 20 ans " le commerce des nègres, de la poudre d’or et de toutes les autres marchandises " aux rivières de Casamance, Cacheu, Rio Grande et Niger incluant l’établissement à Ouidah"
1685 : En janvier, " Déclaration du Roy pour l'establissement d'une Compagnie sous le titre de la Compagnie de Guinée, qui fera seule, à l'exclusion des autres, le commerce de nègres, de la poudre d'or et de toutes autres marcahndises qu'elleporra traister aux Costes d'Afrique depuis la rivière de Serre-Lyonne inclusivement jusques au Cap de Bonne Espérance"
En mars, " Edit du Roy ou Code Noir sur les esclaves des Isles de l’Amérique " :
Lors de son impression, il deviendra " Recueil d’Edits, Déclarations et Arrêts concernant les Esclaves Nègres des Isles de l’Amérique Françoise ", en 60 articles. Ci-après, le texte avec orthographe modernisée, sa lecture intégrale est souhaitable :
Article 1er
Voulons que l'édit du feu Roi de Glorieuse Mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nosdites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.
Article 2
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneur et intendant desdites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.
Article 3
Interdisons tout exercice public d'autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements.
Article 4
Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.
Article 5
Défendons à nos sujets de la religion protestante d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.
Article 6
Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.
Article 7
Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands.
Article 8
Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine incapables de contracter à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.
Article 9
Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.
Article 10
Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la Déclaration de 1639 pour les mariages seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.
Article 11
Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Article 12
Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.
Article 13
Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Article 14
Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.
Article 15
Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.
Article 16
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys; et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret.
Article 17
Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion desdites assemblées et en 10 écus d'amende pour la première fois et au double en cas de récidive.
Article 18
Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet contre les esclaves, de 10 livres tournois contre le maître qui l'aura permis et de pareille amende contre l'acheteur.
Article 19
Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans des maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues; à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution de prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs.
Article 20
Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers dans chaque marché pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres dont ils seront porteurs.
Article 21
Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où leurs esclaves auront été surpris en délit: sinon elles seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis.
Article 22
Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de boeuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion: et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
Article 23
Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ou guildive, pour tenir lieu de subsistance mentionnée en l'article précédent.
Article 24
Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
Article 25
Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres.
Article 26
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
Article 27
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu'ils eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave.
Article 28
Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres; et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.
Article 29
Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés, et au cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit, et, si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves que les maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que les maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur être dû; sinon que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.
Article 30
Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérer et administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle: et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s'éclairer d'ailleurs, sans qu'on en puisse tire aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.
Article 31
Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être en jugement en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été contre leurs esclaves.
Article 32
Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres partie, (sinon) en cas de complicité: et seront les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec les mêmes formalités que les personnes libres.
Article 33
L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.
Article 34
Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort, s'il y échet.
Article 35
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, boeufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.
Article 36
Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne à sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s'il y échet, les condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice et marqués d'une fleur de lys.
Article 37
Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.
Article 38
L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys une épaule; s'il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule; et, la troisième fois, il sera puni de mort.
Article 39
Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers les maîtres en l'amende de 300 livres de sucre par chacun jour de rétention, et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres tournois d'amende par chacun jour de rétention.
Article 40
L'esclave sera puni de mort sur la dénonciation de son maître non complice du crime dont il aura été condamné sera estimé avant l'exécution par deux des principaux habitants de l'île, qui seront nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation en sera payé au maître; et, pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune tête de nègre payant droits la somme portée par l'estimation, laquelle sera régalé sur chacun desdits nègres et levée par le fermier du domaine royal pour éviter à frais.
Article 41
Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.
Article 42
Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement.
Article 43
Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous Lettres de grâce.
Article 44
Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire.
Article 45
N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.
Article 46
Seront dans les saisies des esclaves observées les formes prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre de saisies; ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégié auront été payées et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.
Article 47
Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même maître; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites; ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sous peine, contre ceux qui feront les aliénations, d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.
Article 48
Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu'à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, habitation, dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries et habitations, sans y comprendre les nègres de l'âge susdit y travaillant actuellement.
Article 49
Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves, sera tenu de payer le prix entier de son bail, sans qu'il puisse compter parmi les fruits qu'il perçoit les enfants qui seront nés des esclaves pendant son bail.
Article 50
Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret; et, à cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche, avant l'interposition du décret, desdits enfants nés esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait mention, dans la même affiche, des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.
Article 51
Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves.
Article 52
Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds.
Article 53
Ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec fonds ni l'adjudicataire à retenir les esclaves sans les fonds.
Article 54
Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille, sans qu'ils soient tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés desdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en sont maîtres et les propriétaires.
Article 55
Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans.
Article 56
Les esclaves qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Article 57
Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nosdites îles et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels de notre royauté, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers.
Article 58
Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne: les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.
Article 59
Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.
Article 60
Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point de destination particulière, par ces présentes nous appartenir, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de nos droits et de nos revenus; voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées.
Vernon Palmer a écrit en 1998 : "Ce Code fut, contrairement à la Coutume de Paris, la seule législation complète qui s'appliquait à l'ensemble de la population, aussi bien noire que blanche. Dans ces colonies où la population esclave dépassait largement le nombre des Européens, et où le travail des esclaves était le moteur de l'économie, ainsi que son plus grand investissement en capital, le Code affectait tant les relations sociales, religieuses que patrimoniales entre les classes. Le Code est aussi un véritable portrait sociologique, car aucune législation ne révèle mieux les croyances de l'Europe, notamment ses peurs, ses valeurs et son aveuglement moral "
La traite ne peut que continuer :
3ème négrier armé à la Rochelle, l'Amitié, capitaine Guillememin, qui a embarqué sa cargaison à St Louis du Sénégal et livré ses nègres à St Domingue.
1er négrier armé à Honfleur, la Catherine, capitaine Berranger, qui a embarqué sa cargaison Gorée au Sénégal et livré ses nègres à St Domingue.
Recensement de Mariegalante : 1.285 âmes dont 771 esclaves (59%), 27 mulâtres et mulâtresses
Article 1er
Voulons que l'édit du feu Roi de Glorieuse Mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nosdites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.
Article 2
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneur et intendant desdites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.
Article 3
Interdisons tout exercice public d'autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements.
Article 4
Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.
Article 5
Défendons à nos sujets de la religion protestante d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.
Article 6
Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.
Article 7
Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands.
Article 8
Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine incapables de contracter à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.
Article 9
Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.
Article 10
Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la Déclaration de 1639 pour les mariages seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.
Article 11
Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Article 12
Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.
Article 13
Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Article 14
Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.
Article 15
Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.
Article 16
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys; et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret.
Article 17
Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion desdites assemblées et en 10 écus d'amende pour la première fois et au double en cas de récidive.
Article 18
Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet contre les esclaves, de 10 livres tournois contre le maître qui l'aura permis et de pareille amende contre l'acheteur.
Article 19
Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans des maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues; à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution de prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs.
Article 20
Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers dans chaque marché pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres dont ils seront porteurs.
Article 21
Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où leurs esclaves auront été surpris en délit: sinon elles seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis.
Article 22
Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de boeuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion: et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
Article 23
Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ou guildive, pour tenir lieu de subsistance mentionnée en l'article précédent.
Article 24
Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
Article 25
Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres.
Article 26
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
Article 27
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu'ils eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave.
Article 28
Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres; et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.
Article 29
Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés, et au cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit, et, si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves que les maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que les maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur être dû; sinon que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.
Article 30
Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérer et administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle: et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s'éclairer d'ailleurs, sans qu'on en puisse tire aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.
Article 31
Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être en jugement en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été contre leurs esclaves.
Article 32
Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres partie, (sinon) en cas de complicité: et seront les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec les mêmes formalités que les personnes libres.
Article 33
L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.
Article 34
Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort, s'il y échet.
Article 35
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, boeufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.
Article 36
Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne à sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s'il y échet, les condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice et marqués d'une fleur de lys.
Article 37
Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.
Article 38
L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys une épaule; s'il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule; et, la troisième fois, il sera puni de mort.
Article 39
Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers les maîtres en l'amende de 300 livres de sucre par chacun jour de rétention, et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres tournois d'amende par chacun jour de rétention.
Article 40
L'esclave sera puni de mort sur la dénonciation de son maître non complice du crime dont il aura été condamné sera estimé avant l'exécution par deux des principaux habitants de l'île, qui seront nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation en sera payé au maître; et, pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune tête de nègre payant droits la somme portée par l'estimation, laquelle sera régalé sur chacun desdits nègres et levée par le fermier du domaine royal pour éviter à frais.
Article 41
Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.
Article 42
Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement.
Article 43
Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous Lettres de grâce.
Article 44
Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire.
Article 45
N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.
Article 46
Seront dans les saisies des esclaves observées les formes prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre de saisies; ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégié auront été payées et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.
Article 47
Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même maître; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites; ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sous peine, contre ceux qui feront les aliénations, d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.
Article 48
Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu'à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, habitation, dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries et habitations, sans y comprendre les nègres de l'âge susdit y travaillant actuellement.
Article 49
Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves, sera tenu de payer le prix entier de son bail, sans qu'il puisse compter parmi les fruits qu'il perçoit les enfants qui seront nés des esclaves pendant son bail.
Article 50
Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret; et, à cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche, avant l'interposition du décret, desdits enfants nés esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait mention, dans la même affiche, des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.
Article 51
Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves.
Article 52
Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds.
Article 53
Ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec fonds ni l'adjudicataire à retenir les esclaves sans les fonds.
Article 54
Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille, sans qu'ils soient tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés desdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en sont maîtres et les propriétaires.
Article 55
Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans.
Article 56
Les esclaves qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Article 57
Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nosdites îles et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels de notre royauté, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers.
Article 58
Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne: les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.
Article 59
Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.
Article 60
Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point de destination particulière, par ces présentes nous appartenir, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de nos droits et de nos revenus; voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées.
Vernon Palmer a écrit en 1998 : "Ce Code fut, contrairement à la Coutume de Paris, la seule législation complète qui s'appliquait à l'ensemble de la population, aussi bien noire que blanche. Dans ces colonies où la population esclave dépassait largement le nombre des Européens, et où le travail des esclaves était le moteur de l'économie, ainsi que son plus grand investissement en capital, le Code affectait tant les relations sociales, religieuses que patrimoniales entre les classes. Le Code est aussi un véritable portrait sociologique, car aucune législation ne révèle mieux les croyances de l'Europe, notamment ses peurs, ses valeurs et son aveuglement moral "
La traite ne peut que continuer :
3ème négrier armé à la Rochelle, l'Amitié, capitaine Guillememin, qui a embarqué sa cargaison à St Louis du Sénégal et livré ses nègres à St Domingue.
1er négrier armé à Honfleur, la Catherine, capitaine Berranger, qui a embarqué sa cargaison Gorée au Sénégal et livré ses nègres à St Domingue.
Recensement de Mariegalante : 1.285 âmes dont 771 esclaves (59%), 27 mulâtres et mulâtresses
1686 : Le marquis de Seignelay écrit : " Il faudroit que les vaisseaux des Compagnies de Sénégal et de Guinée arrivassent au plus tard a la fin d'avril, veu que par ce moyen leurs negres seroient payez des premiers sucres, au lieu qu'arrivant plus tard la saison des sucres est presque achevée et ils sont obligez d'en attendre un autre"
L'intendant général Dumaitz annonce l'arrivée en Martinique du négrier Les Jeux, capitaine Pirraux, de la Compagnie de Guinée avec 560 nègres. Il était parti de la Rochelle et avait fait sa traite au Bénin :
Parmi les autres négriers, parti de Bordeaux, le Saint Jean Baptiste de la Compagnie du Sénégal, capitaine Lecerf, 130 tonneaux, 4 canons, fait sa traite à St Louis du Sénégal où il charge 105 nègres en mai et arrive à St Domingue avec 90 esclaves à vendre.
Autre négrier de La Rochelle, l'Avanturier, capitaine De la Prolle, destination inconnue...
Premier négrier du Havre, la Renommée, capitaine Jacques de Lestrille, qui a chargé en Guinée Bissau et livré à St Domingue.
Premier négrier de St Malo, la Victoire, capitaine Jean de la Closerie, qui a chargé à St Louis du Sénégal et livré à St Domingue.
St Domingue semble une destination prioritaire...
1687 : Négrier du Havre, la Sirène, capitaine Canut, qui a chargé à Albreda (actuelle Gambie) et livré à St Domingue.
Autre négrier de La Rochelle, le Saint-Louis, capitaine Viguer, qui charge au Bénin pour une destination non retrouvée...
Le gouverneur de Mariegalante, Auger, réclame d’urgence 100 nègres aux commis de la Compagnie, faute de quoi on ne pourra pas accroitre les défrichements…
Le gouverneur général De Blénac donne ordre à la Compagnie de Guinée de les lui fournir.
Autre négrier de La Rochelle, l'Avanturier, capitaine De la Prolle, destination inconnue...
Premier négrier du Havre, la Renommée, capitaine Jacques de Lestrille, qui a chargé en Guinée Bissau et livré à St Domingue.
Premier négrier de St Malo, la Victoire, capitaine Jean de la Closerie, qui a chargé à St Louis du Sénégal et livré à St Domingue.
St Domingue semble une destination prioritaire...
1687 : Négrier du Havre, la Sirène, capitaine Canut, qui a chargé à Albreda (actuelle Gambie) et livré à St Domingue.
Autre négrier de La Rochelle, le Saint-Louis, capitaine Viguer, qui charge au Bénin pour une destination non retrouvée...
Le gouverneur de Mariegalante, Auger, réclame d’urgence 100 nègres aux commis de la Compagnie, faute de quoi on ne pourra pas accroitre les défrichements…
Le gouverneur général De Blénac donne ordre à la Compagnie de Guinée de les lui fournir.
1688 : En janvier, " Arrest du Conseil d'Etat, concernant les Priviléges de la Compagnie de Guinée " : il maintient les exemptions qui étaient contestées par les Fermiers Généraux...
Le 22 septembre, le Roy écrit " Aux interessez en la Compagnie de Guinée & du Senegal sur l'envoy des nègres aux isles Ste Croix, St Martin, St Barthelemy & Marie Galande" :
" Le Roy a esté informé que les isles Ste Croix, St Martin, St Barthelemy & Marie Galante tombent en friche faute de Noirs et que les habitants se ruinent a en aller chercher dans les autres isles et comme il est important non seulement d'empescher la suite de ce mal ; mais mesme d'ameliorer ces colonies et de mettre les habitans en estat de mettre en valeur les terres qui n'ont pas encore esté defrichées, sa Maté desire que vous vous entendiez avec les gouverneurs des d. isles et avec le sr Dumaitz de Goimpy pour y faire passer tous les ans la quantité de noirs qu on estimera necessaire, et il faut pour cet effet que vous vous entendiez aussy avec les interessez en la Compagnie de Guinée afin que vous regliez ensemble la quantité que chaque compagnie devra y envoyer "
Premier navire de traite au départ de Nantes : la Paix.
Nantes va devenir le principal port négrier français au XVIIIème siècle à partir du quai de la Fosse : 1.427 expéditions y seront armées, soit 42 % de la traite française…
La Rochelle, en avance sur les autres ports en cette fin XVIIème, envoie cette année 5 navires de traite : la Tempeste, commandée par Du Casse lui-même, qui va charger à Ouidah et livrer 287 nègres en Martinique, 16 morts pendant le passage du milieu, et 4 autres, le Pont d'Or, l'Avanturier, le St Jean et un autre...
Les armateurs bordelais envoient le Glorieux, 120 tonneaux, capitaine Macet, à la "Coste d'Angolle" pour amener des nègres à l'île de Cayenne et à St Domingue, on ne sait s'il a réussi avec le début de la guerre de la Ligue d'Augsbourg...
1689 : L'intendant Dumaitz annonce l'arrivée en Martinique de 2 navires :
Le vaisseau du Roy La Perle, commandant Mr D'Arbouville et le négrier Le Marin, capitaine Guillotin, qui livre 180 nègres de Guinée :
Le 22 septembre, le Roy écrit " Aux interessez en la Compagnie de Guinée & du Senegal sur l'envoy des nègres aux isles Ste Croix, St Martin, St Barthelemy & Marie Galande" :
" Le Roy a esté informé que les isles Ste Croix, St Martin, St Barthelemy & Marie Galante tombent en friche faute de Noirs et que les habitants se ruinent a en aller chercher dans les autres isles et comme il est important non seulement d'empescher la suite de ce mal ; mais mesme d'ameliorer ces colonies et de mettre les habitans en estat de mettre en valeur les terres qui n'ont pas encore esté defrichées, sa Maté desire que vous vous entendiez avec les gouverneurs des d. isles et avec le sr Dumaitz de Goimpy pour y faire passer tous les ans la quantité de noirs qu on estimera necessaire, et il faut pour cet effet que vous vous entendiez aussy avec les interessez en la Compagnie de Guinée afin que vous regliez ensemble la quantité que chaque compagnie devra y envoyer "
Premier navire de traite au départ de Nantes : la Paix.
Nantes va devenir le principal port négrier français au XVIIIème siècle à partir du quai de la Fosse : 1.427 expéditions y seront armées, soit 42 % de la traite française…
La Rochelle, en avance sur les autres ports en cette fin XVIIème, envoie cette année 5 navires de traite : la Tempeste, commandée par Du Casse lui-même, qui va charger à Ouidah et livrer 287 nègres en Martinique, 16 morts pendant le passage du milieu, et 4 autres, le Pont d'Or, l'Avanturier, le St Jean et un autre...
Les armateurs bordelais envoient le Glorieux, 120 tonneaux, capitaine Macet, à la "Coste d'Angolle" pour amener des nègres à l'île de Cayenne et à St Domingue, on ne sait s'il a réussi avec le début de la guerre de la Ligue d'Augsbourg...
1689 : L'intendant Dumaitz annonce l'arrivée en Martinique de 2 navires :
Le vaisseau du Roy La Perle, commandant Mr D'Arbouville et le négrier Le Marin, capitaine Guillotin, qui livre 180 nègres de Guinée :
1690 : " Arrest du Conseil d'Estat, qui exempte de la moitié des Droits d'Entrée toutes les Marchandises de la Compagnie du Sénégal apportées soit des Costes d'Afrique , soịt des Isles de l'Amerique "
1691 : Attaque anglaise de Mariegalande, avec destructions systématiques et capture des esclaves…
Le négrier Le Pont d'Or, armé à la Rochelle, livre en Martinique 500 nègres.
1692 : La Compagnie du Sénégal est toujours en difficulté financière, la plupart des actionnaires ont changé, dont Du Casse qui est devenu gouverneur de St Domingue…
Le nouveau secrétaire d’Etat De Ponchartrain promulgue un " Arrêt qui permet aux intéressez en la Compagnie du Sénégal, de faire la vente dudit Sénégal, Gorée et lieux en dépendants, justices, seigneuries, et privilèges du commerce à ceux qui se prétendent pour les acquérir "
1693 : Un " Mémoire du Sieur de la Courbe sur le commerce de Guinée " nous montre que la traite était à priori rentable…
Selon Benjamin Steiner : " À la Petite Côte (Sénégal, Cap Vert etc.), 800 captifs coûtaient 29 200 livres tournois et étaient vendus aux îles de l’Amérique pour 240 000 livres tournois ; 510 quintaux d’ivoire coûtaient 8 920 livres et étaient vendus en France pour 51 000 livres ; 400 quintaux de cire coûtaient 7 000 livres et étaient vendus pour 36 000 livres ; 45 000 cuirs coûtaient 11 530 livres et étaient vendus pour 146 250 livres ; 2 000 quintaux de gomme coûtaient 6 000 livres et étaient vendus pour 40 000 livres ; et 52 marcs d’or coûtaient 7 440 livres et était vendus pour 20 800 livres. Ainsi la Compagnie versait pour ces produits 70 090 livres à ses partenaires africains qu’elle revendait 534 050 livres. Le bénéfice brut était de 463 960 livres. Mais la Compagnie au Sénégal avait des frais… "
1694 : La Compagnie devient la Compagnie Royale du Sénégal : " Vente faite par les anciens intéressez en la Compagnie du Sénégal à M. d’Appougny de ces habitations dudit lieu île de Gorée, cap Vert, et ca. Moyennant 300 000 livres "
D'Appougny est secrétaire du Roi...
1696 : " Lettre patentes du Roi, portant établissement d’une nouvelle Compagnie Royale du Sénégal, Cap-Vert et Côtes d’Affrique ".
1691 : Attaque anglaise de Mariegalande, avec destructions systématiques et capture des esclaves…
Le négrier Le Pont d'Or, armé à la Rochelle, livre en Martinique 500 nègres.
1692 : La Compagnie du Sénégal est toujours en difficulté financière, la plupart des actionnaires ont changé, dont Du Casse qui est devenu gouverneur de St Domingue…
Le nouveau secrétaire d’Etat De Ponchartrain promulgue un " Arrêt qui permet aux intéressez en la Compagnie du Sénégal, de faire la vente dudit Sénégal, Gorée et lieux en dépendants, justices, seigneuries, et privilèges du commerce à ceux qui se prétendent pour les acquérir "
1693 : Un " Mémoire du Sieur de la Courbe sur le commerce de Guinée " nous montre que la traite était à priori rentable…
Selon Benjamin Steiner : " À la Petite Côte (Sénégal, Cap Vert etc.), 800 captifs coûtaient 29 200 livres tournois et étaient vendus aux îles de l’Amérique pour 240 000 livres tournois ; 510 quintaux d’ivoire coûtaient 8 920 livres et étaient vendus en France pour 51 000 livres ; 400 quintaux de cire coûtaient 7 000 livres et étaient vendus pour 36 000 livres ; 45 000 cuirs coûtaient 11 530 livres et étaient vendus pour 146 250 livres ; 2 000 quintaux de gomme coûtaient 6 000 livres et étaient vendus pour 40 000 livres ; et 52 marcs d’or coûtaient 7 440 livres et était vendus pour 20 800 livres. Ainsi la Compagnie versait pour ces produits 70 090 livres à ses partenaires africains qu’elle revendait 534 050 livres. Le bénéfice brut était de 463 960 livres. Mais la Compagnie au Sénégal avait des frais… "
1694 : La Compagnie devient la Compagnie Royale du Sénégal : " Vente faite par les anciens intéressez en la Compagnie du Sénégal à M. d’Appougny de ces habitations dudit lieu île de Gorée, cap Vert, et ca. Moyennant 300 000 livres "
D'Appougny est secrétaire du Roi...
1696 : " Lettre patentes du Roi, portant établissement d’une nouvelle Compagnie Royale du Sénégal, Cap-Vert et Côtes d’Affrique ".
La Compagnie est autorisée "de faire les traites de toutes les marchandises, même des Negres Captifs, qu'elle pourra seule négocier sur la Côte et dans les Terres Fermes et Isles voisines..."
Elle obtient des privilèges pour favoriser ses affaires : les marchandises d’Afrique qui arrivent en France sont exonérées des taxes de douanes et elle est récompensée de " 13 livres pour chaque teste de nègre " qui arrive à l’Amérique des Isles ou de la Terre ferme.
1698 : Le gouverneur d'Amblimont annonce l'arrivée de 233 nègres en Martinique sur un navire de la Compagnie du Sénégal "lesquels ont esté tres bien et promptement vendus, par la necessité ou l'on en estoit, quoy que ce ne soit pas les meilleurs de la Coste d'affrique pour la culture des terres" ...
Elle obtient des privilèges pour favoriser ses affaires : les marchandises d’Afrique qui arrivent en France sont exonérées des taxes de douanes et elle est récompensée de " 13 livres pour chaque teste de nègre " qui arrive à l’Amérique des Isles ou de la Terre ferme.
1698 : Le gouverneur d'Amblimont annonce l'arrivée de 233 nègres en Martinique sur un navire de la Compagnie du Sénégal "lesquels ont esté tres bien et promptement vendus, par la necessité ou l'on en estoit, quoy que ce ne soit pas les meilleurs de la Coste d'affrique pour la culture des terres" ...
Il s'agit probablement du négrier La Vigilante, parti de Bordeaux l'année précédente...
1699 : Le capitaine de vaisseau Jean-Baptiste de Gennes voulait établir une base française sur la côte du Pacifique de l'Amérique du Sud pour s'emparer des mines d'argent du Pérou.
Il constitue à la Cour une société de 85 actionnaires, dont Vauban, la princesse de Conti, la marquise de Montespan.
6 navires sont armés, 4 frégates le Faucon-Anglais (capitaine Jean-Baptiste de Gennes), le Soleil-d'Afrique, le Séditieux, la Félicité, et 2 flûtes la Gloutonne et la Féconde. Ils partent de La Rochelle le 3 juin 1695. Il passe par Gorée, la rivière de Gambie où il enlève le fort Saint-Jammes tenu par les Anglais, il capture les Noirs qu'il a trouvé dans les magasins anglais pour les vendre en Martinique. Il relâche dans la baie de Rio de Janeiro, arrive le 11 février 1696 à l'entrée du détroit de Magellan, tente 2 fois de le franchir sans succès. Il abandonne et va croiser plusieurs mois dans la mer des Antilles où il capture 5 bateaux anglais.
Cette longue expédition, partiellement négrière, est relatée dans la "Relation d'un voyage fait en 1695,1696 et 1697 aux Côtes d'Afrique, etc..." rédigée par le sieur Froger qui était ingénieur sur le vaisseau de De Gennes et publiée en 1699 :
1699 : Le capitaine de vaisseau Jean-Baptiste de Gennes voulait établir une base française sur la côte du Pacifique de l'Amérique du Sud pour s'emparer des mines d'argent du Pérou.
Il constitue à la Cour une société de 85 actionnaires, dont Vauban, la princesse de Conti, la marquise de Montespan.
6 navires sont armés, 4 frégates le Faucon-Anglais (capitaine Jean-Baptiste de Gennes), le Soleil-d'Afrique, le Séditieux, la Félicité, et 2 flûtes la Gloutonne et la Féconde. Ils partent de La Rochelle le 3 juin 1695. Il passe par Gorée, la rivière de Gambie où il enlève le fort Saint-Jammes tenu par les Anglais, il capture les Noirs qu'il a trouvé dans les magasins anglais pour les vendre en Martinique. Il relâche dans la baie de Rio de Janeiro, arrive le 11 février 1696 à l'entrée du détroit de Magellan, tente 2 fois de le franchir sans succès. Il abandonne et va croiser plusieurs mois dans la mer des Antilles où il capture 5 bateaux anglais.
Cette longue expédition, partiellement négrière, est relatée dans la "Relation d'un voyage fait en 1695,1696 et 1697 aux Côtes d'Afrique, etc..." rédigée par le sieur Froger qui était ingénieur sur le vaisseau de De Gennes et publiée en 1699 :
Jean Baptiste de Gennes est nommé gouverneur de St Christophe, ce qui ne lui réussira pas : il sera fait prisonnier par les Anglais en 1702 et décèdera à Plymouth en 1705...
Recensement des Isles du Vent : en Martinique, 20.277 âmes, dont 13.292 esclaves, en Guadeloupe, 10.436 âmes, dont 6.185 esclaves, Mariegalande n'est recensée qu'avec les anciens chiffres : 482 habitants...
1700 : Depuis 1643, selon Eric Saugera, on recense 53 expéditions négrières françaises...
Le négrier Marianne, 350 tonneaux, capitaine Dufay, armé par la Compagnie de Guinée, part de Bordeaux en novembre pour effectuer sa traite vers Juda et Elmina, il livrera ses esclaves en Martinique en septembre 1701.
En Martinique, le navire négrier l’Europe, commandé par Monsieur de La Flocellière, revient de la "Coste de Guinée", où il est allé chercher une cargaison de nègres, sur commande du sieur Ricord, habitant sucrier et négociant de l’île. On l’accuse d’avoir mal nourri ses nègres, car sur une cargaison de 899, seuls 819 sont à la vente. A noter que si le sieur Ricord lui-même s’en ait réservé 361, le gouverneur d’Amblimont en a acheté 20 pour un montant de 11.000 livres…
Recensement des Isles du Vent : en Martinique, 20.277 âmes, dont 13.292 esclaves, en Guadeloupe, 10.436 âmes, dont 6.185 esclaves, Mariegalande n'est recensée qu'avec les anciens chiffres : 482 habitants...
1700 : Depuis 1643, selon Eric Saugera, on recense 53 expéditions négrières françaises...
Le négrier Marianne, 350 tonneaux, capitaine Dufay, armé par la Compagnie de Guinée, part de Bordeaux en novembre pour effectuer sa traite vers Juda et Elmina, il livrera ses esclaves en Martinique en septembre 1701.
En Martinique, le navire négrier l’Europe, commandé par Monsieur de La Flocellière, revient de la "Coste de Guinée", où il est allé chercher une cargaison de nègres, sur commande du sieur Ricord, habitant sucrier et négociant de l’île. On l’accuse d’avoir mal nourri ses nègres, car sur une cargaison de 899, seuls 819 sont à la vente. A noter que si le sieur Ricord lui-même s’en ait réservé 361, le gouverneur d’Amblimont en a acheté 20 pour un montant de 11.000 livres…
1701 : La Compagnie de Guinée vient de changer de mains et appartient à 8 associés, les frères Antoine et Pierre Crozat, Maynon, Thomé, Bernard, Vanolle, Landais et D'Armigny.
Les financiers Crozat sont les fils du Capitoul de Toulouse. Antoine, marquis du Châtel était initialement associé à la Ferme du tabac en 1697, puis actionnaire principal de la Compagnie Royale de la Mer du Sud en 1698, enfin directeur de la Compagnie de Guinée et de la Compagnie de St Domingue.
Signature de l’Asiento entre les Rois de France et d’Espagne, pour la fourniture par la France de nègres dans les colonies Espagnoles, signé par l'amiral Du Casse : " Traité fait entre les deux Roys catholiques et très chrétiens avec la Compagnie Royale de Guinée établie en France, concernant l'introduction des Nègres dans l'Amérique "... " le nombre des Négres que la Compagnie devoit fournir aux Indes Espagnoles , seroit fixé à 38000 pendant la Guerre , & à 48000 en cas de Paix ; & le Droit du Roi d'Espagne à 33 piastres & un tiers pour chaque Négre , Piéce d'Inde , dont la Compagnie paya par avance la plus grande partie "
Les Espagnols, grands consommateurs d’esclaves dans leurs colonies, ont toujours sous-traité la traite, d’abord aux Portugais, puis aux Hollandais, avant de la confier progressivement aux autres Européens.
1703 : Antoine Crozat, qui dirige déjà la Compagnie de St Domingue et la Compagnie de Guinée, les transforment en Compagnie Royale de l'Assiente, confirmée le 9 juin par " Arrest du Conseil d'Estat concernant le Traité de la Compagnie Royale de l'Assiente "
1706 : La compagnie du Sénégal arme 2 négriers au départ de Nantes.
1709 : La Compagnie du Sénégal est en faillite : le Conseil d’État accepte la vente des concessions de la Compagnie à un groupe réuni autour d’un financier de Rouen, Mustellier.
1712 : Antoine Crozat a obtenu de Louis XIV le monopole de la Louisiane pour 15 ans : il crée la Compagnie de Louisiane pour son exploitation.
De 1709 à 1712, 18 navires de traite négrière, 1 au départ de Brest, 4 de La Rochelle, 3 de Lorient et 10 de Nantes.
Leur destination finale est la Martinique pour 6 d'entre eux, St Domingue pour 6, Cayenne pour 2, mais aussi 4 participent à l'Asiento en fournissant des esclaves aux Espagnols de Cuba et de Carthagène.
Plus de 600 nègres ont été capturés par l’escadre de l’Amiral Cassard lors de la prise de Montserrat et introduits en Guadeloupe : les petits habitants n’ont pu en profiter, car ils constituaient des familles qu’on n’a pas voulu séparer...
1713 : Fin de la Guerre de Succession d’Espagne avec le traité d’Utrecht : il fait de l'Angleterre, pour une durée de 30 ans, la bénéficiaire du monopole de l’Asiento, qu'elle concéde aussitôt à la Compagnie (anglaise) des Mers du Sud (South Seas Company), qui va l’assurer jusqu’en 1759.
La traite française perd de facto une partie de son activité...
Les armateurs de Nantes négocient et obtiennent une Ordonnance qui leur donne la liberté du commerce de Guinée moyennant un droit à payer à la Compagnie.
1er navire de traite au départ de Dunkerque, le Duc de Bretagne, 120 tonneaux, qui livrera 60 nègres du Sénégal à St Domingue.
2ème négrier au départ de St Malo, l'Affriquain, qui livrera 129 nègres en Martinique.
Le 1er négrier au départ du Havre, le Gorée, ne sera pas très performant : il revient du Sénégal avec 305 nègres destinés à St Domingue, mais par incompétence des officiers, Saint-Domingue est dépassé ! Le navire s’échoue le 17 janvier 1714 à Cuba où il doit décharger la majorité de sa cargaison. Arrivé le 14 avril au Cap avec seulement 38 nègres, il repart le 23 pour Cuba, où il ne retrouve pas le reste des nègres qui ont été vendus !
1714 : 1er navire négrier armé à Marseille, Le Sauveur, à destination de St Domingue.
En Martinique, depuis le début de l’année jusqu’en septembre, sont arrivés de 4 vaisseaux avec 1.254 "pièces de nègres", le commerce triangulaire a rédemarré en force depuis le retour de la paix…
1715 : Mort de Louis XIV.
La Compagnie du Sénégal aux mains du groupe de négociants de Rouen fait 368.000 livres de bénéfice…
Premiers navires de traite au départ de Rochefort et de Honfleur, le Ruby armé par des négociants bordelais.
En Martinique, 1.625 nègres ont été introduits entre octobre 1714 et juillet 1715, les droits à 15 livres par tête ont rapporté 24.375 livres. Une partie a été distribuée entre la Guadeloupe et Marie-Galante.
En Guadeloupe, le navire l’Heureux Aventurier, armé à Nantes, arrive avec 70 nègres.
Les financiers Crozat sont les fils du Capitoul de Toulouse. Antoine, marquis du Châtel était initialement associé à la Ferme du tabac en 1697, puis actionnaire principal de la Compagnie Royale de la Mer du Sud en 1698, enfin directeur de la Compagnie de Guinée et de la Compagnie de St Domingue.
Signature de l’Asiento entre les Rois de France et d’Espagne, pour la fourniture par la France de nègres dans les colonies Espagnoles, signé par l'amiral Du Casse : " Traité fait entre les deux Roys catholiques et très chrétiens avec la Compagnie Royale de Guinée établie en France, concernant l'introduction des Nègres dans l'Amérique "... " le nombre des Négres que la Compagnie devoit fournir aux Indes Espagnoles , seroit fixé à 38000 pendant la Guerre , & à 48000 en cas de Paix ; & le Droit du Roi d'Espagne à 33 piastres & un tiers pour chaque Négre , Piéce d'Inde , dont la Compagnie paya par avance la plus grande partie "
Les Espagnols, grands consommateurs d’esclaves dans leurs colonies, ont toujours sous-traité la traite, d’abord aux Portugais, puis aux Hollandais, avant de la confier progressivement aux autres Européens.
1703 : Antoine Crozat, qui dirige déjà la Compagnie de St Domingue et la Compagnie de Guinée, les transforment en Compagnie Royale de l'Assiente, confirmée le 9 juin par " Arrest du Conseil d'Estat concernant le Traité de la Compagnie Royale de l'Assiente "
1706 : La compagnie du Sénégal arme 2 négriers au départ de Nantes.
1709 : La Compagnie du Sénégal est en faillite : le Conseil d’État accepte la vente des concessions de la Compagnie à un groupe réuni autour d’un financier de Rouen, Mustellier.
1712 : Antoine Crozat a obtenu de Louis XIV le monopole de la Louisiane pour 15 ans : il crée la Compagnie de Louisiane pour son exploitation.
De 1709 à 1712, 18 navires de traite négrière, 1 au départ de Brest, 4 de La Rochelle, 3 de Lorient et 10 de Nantes.
Leur destination finale est la Martinique pour 6 d'entre eux, St Domingue pour 6, Cayenne pour 2, mais aussi 4 participent à l'Asiento en fournissant des esclaves aux Espagnols de Cuba et de Carthagène.
Plus de 600 nègres ont été capturés par l’escadre de l’Amiral Cassard lors de la prise de Montserrat et introduits en Guadeloupe : les petits habitants n’ont pu en profiter, car ils constituaient des familles qu’on n’a pas voulu séparer...
1713 : Fin de la Guerre de Succession d’Espagne avec le traité d’Utrecht : il fait de l'Angleterre, pour une durée de 30 ans, la bénéficiaire du monopole de l’Asiento, qu'elle concéde aussitôt à la Compagnie (anglaise) des Mers du Sud (South Seas Company), qui va l’assurer jusqu’en 1759.
La traite française perd de facto une partie de son activité...
Les armateurs de Nantes négocient et obtiennent une Ordonnance qui leur donne la liberté du commerce de Guinée moyennant un droit à payer à la Compagnie.
1er navire de traite au départ de Dunkerque, le Duc de Bretagne, 120 tonneaux, qui livrera 60 nègres du Sénégal à St Domingue.
2ème négrier au départ de St Malo, l'Affriquain, qui livrera 129 nègres en Martinique.
Le 1er négrier au départ du Havre, le Gorée, ne sera pas très performant : il revient du Sénégal avec 305 nègres destinés à St Domingue, mais par incompétence des officiers, Saint-Domingue est dépassé ! Le navire s’échoue le 17 janvier 1714 à Cuba où il doit décharger la majorité de sa cargaison. Arrivé le 14 avril au Cap avec seulement 38 nègres, il repart le 23 pour Cuba, où il ne retrouve pas le reste des nègres qui ont été vendus !
1714 : 1er navire négrier armé à Marseille, Le Sauveur, à destination de St Domingue.
En Martinique, depuis le début de l’année jusqu’en septembre, sont arrivés de 4 vaisseaux avec 1.254 "pièces de nègres", le commerce triangulaire a rédemarré en force depuis le retour de la paix…
1715 : Mort de Louis XIV.
La Compagnie du Sénégal aux mains du groupe de négociants de Rouen fait 368.000 livres de bénéfice…
Premiers navires de traite au départ de Rochefort et de Honfleur, le Ruby armé par des négociants bordelais.
En Martinique, 1.625 nègres ont été introduits entre octobre 1714 et juillet 1715, les droits à 15 livres par tête ont rapporté 24.375 livres. Une partie a été distribuée entre la Guadeloupe et Marie-Galante.
En Guadeloupe, le navire l’Heureux Aventurier, armé à Nantes, arrive avec 70 nègres.
Au large de Ouidah (Juda), à bord du navire négrier nantais Le Prudent, capitaine Gamot, avec 428 Noirs à bord, révolte des Noirs le 30 juillet qui " voulurent même s’emparer du navire et couper les cables d’iceluy, ce que voyant lui déclarant pour éviter et prévenir les mauvais desseins desdits noirs fut obligé deprendre les armes jointement avec son équipage et qu’ayant tiré plusieurs coups d’armes sur iceux noirs et ce pour sauver leur vie et navire et marchandises, il en fut tué dans cette occasion 39, qu’il fut blessé dans cette rencontre 4 ou 5 hommes de l'équipage du déclarant, que cela fini on rangea lesdits noirs restant en leur devoir et on les renferra "...
Le Prudent arrivera en Martinique le 23 décembre avec seulement 356 noirs, 198 morts en tout...
1716 : Le Régent Philippe, duc d’Orléans, supprime le monopole des Compagnies pour la traite : en plus de Nantes, des Lettres patentes de janvier autorisent les ports de Rouen, La Rochelle, et Bordeaux à " faire librement le commerce des nègres ", suivis d'une autre Lettre Patente en août pour Honfleur et Le Havre et en janvier suivant pour Calais, Dieppe, Saint Malo, Morlaix , Brest, Bayonne et Cette (Sète)
Le Prudent arrivera en Martinique le 23 décembre avec seulement 356 noirs, 198 morts en tout...
1716 : Le Régent Philippe, duc d’Orléans, supprime le monopole des Compagnies pour la traite : en plus de Nantes, des Lettres patentes de janvier autorisent les ports de Rouen, La Rochelle, et Bordeaux à " faire librement le commerce des nègres ", suivis d'une autre Lettre Patente en août pour Honfleur et Le Havre et en janvier suivant pour Calais, Dieppe, Saint Malo, Morlaix , Brest, Bayonne et Cette (Sète)
En contre-partie, ils doivent payer "entre les mains du Trésorier général de la Marine en exercice, la somme de vingt livres par chaque Négre qui auroit été débarqué aux Isles ", somme réduite par une Déclaration du Roi en décembre " pour les Négrillons de l'âge de 12 ans et au-dessous , aux deux tiers et pour les Négrittes du même âge , à la moitié "
Le banquier Antoine Crozat est condamné à payer 6.600.000 livres de dettes fiscales, il va devoir restituer à la Couronne ses privilèges...
Le banquier John Law de Lauriston, qui a séduit le Régent, est chargé d’essayer de redresser les finances de la France : il est autorisé à créer la Banque générale et à émettre du papier-monnaie contre de l'or.
En Martinique, le 28 septembre arrive le navire négrier L'Aurore : parti de Nantes le 19 février, il a chargé 463 noirs à Bony (Bénin) entre le 29 mars et le 21 mai, il ne lui reste à l'arrivée que 155 esclaves à vendre, ayant eu 308 morts pendant la traversée...
Le capitaine Joubert écrit : " On a toujours remarqué que les nègres de Bénin ne réussissent pas comme les Aradas, les Mines et les Sénégalais ; ils se laissent mourir en route par orgueil ou désespoir et ceux qui restent ne sont pas d’un grand service sur les habitations. Cependant quelques capitaines séduits par le bon marché, qui les ruine ensuite, vont à cette côte, qui est d’ailleurs la plus malsaine de l’Afrique ; ils y perdent la moitié et quelquefois les deux tiers de leurs équipages comme a fait ledit capitaine Joubert. M. de Bonivet, qui y a fait aussi sa traite, a eu le même sort "...
En 3 mois, 4 négriers (2 de Nantes, 1 de La Rochelle, 1 du Havre) ont introduits en Martinique 1.044 esclaves, moitié d’Angole, moitié de Guinée, comme toujours revendus aussi dans les autres îles du Vent, dont probablement Marie-Galante.
1717 : Le banquier John Law crée la Compagnie d'Occident, après avoir racheté la Compagnie du Mississippi, reprise en 1713 par le financier Antoine Crozat.
Un Arrest du Conseil d'Etat du 26 mars " ordonne que toutes les Marchandises du Cru des Isles & Colonies Françoises, meme celles provenans de la Traite des Noirs , payeront le Droit de Trois pour cent , dù à la Ferme du Domaine d'Occident "
1718 : La Compagnie d'Occident va absorber en 1 an toutes les autres compagnies coloniales françaises - la Compagnie du Sénégal, la Compagnie de Guinée, la Compagnie de Chine, la Compagnie de Barbarie, la Compagnie des Mers du Sud et la Compagnie des Indes Orientales - et devient la nouvelle Compagnie des Indes dite Perpétuelle, par Edit du Roi en mai suivant.
Lorient est le port officiel de la Compagnie.
Le 4 décembre, la Banque Générale de Law devient la Banque Royale.
Le banquier Antoine Crozat, l'homme le plus riche de France, en grande partie grâce à la traite négrière, va, comme l'écrit Grossin s'ouvrir " les portes de l’aristocratie, en mariant sa fille à Louis-Henri de la Tour d’Auvergne, comte d’Evreux ".
Ce dernier, grâce à la dot de 2.000.000 de livres de la jeune épouse (12 ans...), va pouvoir se faire construire son Hôtel particulier, notre futur Palais de l'Élysée...
Cela ne portera pas bonheur à la jeune épouse qui sera congédiée lors de l'inauguration de cet Hôtel d'Evreux et remplacée par la maîtresse du comte, la duchesse de Lesdiguières...
1719 : Les armateurs de Marseille obtiennent une Lettre patente qui leur autorise aussi la traite.
En Martinique, le nouveau gouverneur général Vauthier de Moyancourt s’insurge dès son arrivée contre la contrebande de nègres : " les vaisseaux Négriers passent devant la Guadeloupe pour St Domingue, ils ne s’y arrestent point cependant ou payeroit chaque nègre 7 à 800 livres pièce d’Inde, argent comptant et c’est ce qui oblige les habitans de faire la contrebande... On ne peut découvrir la contrebande faute de dénonciateurs…"
Le banquier Antoine Crozat est condamné à payer 6.600.000 livres de dettes fiscales, il va devoir restituer à la Couronne ses privilèges...
Le banquier John Law de Lauriston, qui a séduit le Régent, est chargé d’essayer de redresser les finances de la France : il est autorisé à créer la Banque générale et à émettre du papier-monnaie contre de l'or.
En Martinique, le 28 septembre arrive le navire négrier L'Aurore : parti de Nantes le 19 février, il a chargé 463 noirs à Bony (Bénin) entre le 29 mars et le 21 mai, il ne lui reste à l'arrivée que 155 esclaves à vendre, ayant eu 308 morts pendant la traversée...
Le capitaine Joubert écrit : " On a toujours remarqué que les nègres de Bénin ne réussissent pas comme les Aradas, les Mines et les Sénégalais ; ils se laissent mourir en route par orgueil ou désespoir et ceux qui restent ne sont pas d’un grand service sur les habitations. Cependant quelques capitaines séduits par le bon marché, qui les ruine ensuite, vont à cette côte, qui est d’ailleurs la plus malsaine de l’Afrique ; ils y perdent la moitié et quelquefois les deux tiers de leurs équipages comme a fait ledit capitaine Joubert. M. de Bonivet, qui y a fait aussi sa traite, a eu le même sort "...
En 3 mois, 4 négriers (2 de Nantes, 1 de La Rochelle, 1 du Havre) ont introduits en Martinique 1.044 esclaves, moitié d’Angole, moitié de Guinée, comme toujours revendus aussi dans les autres îles du Vent, dont probablement Marie-Galante.
1717 : Le banquier John Law crée la Compagnie d'Occident, après avoir racheté la Compagnie du Mississippi, reprise en 1713 par le financier Antoine Crozat.
Un Arrest du Conseil d'Etat du 26 mars " ordonne que toutes les Marchandises du Cru des Isles & Colonies Françoises, meme celles provenans de la Traite des Noirs , payeront le Droit de Trois pour cent , dù à la Ferme du Domaine d'Occident "
1718 : La Compagnie d'Occident va absorber en 1 an toutes les autres compagnies coloniales françaises - la Compagnie du Sénégal, la Compagnie de Guinée, la Compagnie de Chine, la Compagnie de Barbarie, la Compagnie des Mers du Sud et la Compagnie des Indes Orientales - et devient la nouvelle Compagnie des Indes dite Perpétuelle, par Edit du Roi en mai suivant.
Lorient est le port officiel de la Compagnie.
Le 4 décembre, la Banque Générale de Law devient la Banque Royale.
Le banquier Antoine Crozat, l'homme le plus riche de France, en grande partie grâce à la traite négrière, va, comme l'écrit Grossin s'ouvrir " les portes de l’aristocratie, en mariant sa fille à Louis-Henri de la Tour d’Auvergne, comte d’Evreux ".
Ce dernier, grâce à la dot de 2.000.000 de livres de la jeune épouse (12 ans...), va pouvoir se faire construire son Hôtel particulier, notre futur Palais de l'Élysée...
Cela ne portera pas bonheur à la jeune épouse qui sera congédiée lors de l'inauguration de cet Hôtel d'Evreux et remplacée par la maîtresse du comte, la duchesse de Lesdiguières...
1719 : Les armateurs de Marseille obtiennent une Lettre patente qui leur autorise aussi la traite.
En Martinique, le nouveau gouverneur général Vauthier de Moyancourt s’insurge dès son arrivée contre la contrebande de nègres : " les vaisseaux Négriers passent devant la Guadeloupe pour St Domingue, ils ne s’y arrestent point cependant ou payeroit chaque nègre 7 à 800 livres pièce d’Inde, argent comptant et c’est ce qui oblige les habitans de faire la contrebande... On ne peut découvrir la contrebande faute de dénonciateurs…"
De Moyancourt n'a pas tort quant à la fréquentation de la Guadeloupe par les négriers : seuls 2 sont venus vendre en Guadeloupe en 10 ans, 1 en 1715, 1 en 1717, la Martinique et St Domingue sont les destinations privilégiées.
La Guadeloupe et Marie-Galante sont dépendantes pour leurs nègres des revendeurs de St Pierre de la Martinique ou de la contrebande...
Le recensement de Marie Galante retrouve 2.009 habitants dont 1.434 esclaves (71%).
La Guadeloupe et Marie-Galante sont dépendantes pour leurs nègres des revendeurs de St Pierre de la Martinique ou de la contrebande...
Le recensement de Marie Galante retrouve 2.009 habitants dont 1.434 esclaves (71%).
La Compagnie des Indes prend possession de la Ferme Générale, donc de la collecte de tous les impôts…
1720 : La Banque royale et la Compagnie perpétuelle des Indes fusionnent le 5 janvier, John Law est nommé contrôleur général des finances, puis surintendant général des Finances.
La Banque Royale a émis plus d'un milliard de livres de papier monnaie.
Le 23 mars, le système de Law perd la confiance des déposants qui se présentent en masse pour échanger leur papier-monnaie contre des espèces métalliques que la société ne possède déjà plus !
En juillet, la banqueroute est totale...
En décembre 1720, Bourgeois, le trésorier de la Banque qui s’était considérablement enrichi, est conduit à la Bastille, ainsi que Durevest, le contrôleur et Fromaget, l'un des directeurs.
John Law, ruiné, est obligé de fuir le royaume et se réfugie à Venise, où il finira ses jours en 1729.
La Compagnie des Indes lui survit, avec une nécessaire réorganisation depuis qu'elle a retrouvé son indépendance…
Le Privilège exclusif de la traite est rétablit en sa faveur le 27 septembre, avec en plus une exemption des 20 livres de droits par tête, mais elle doit s'engager à apporter 3000 nègres par an aux Isles Françoises de l'Amérique, au lieu des 1000 de l'ancienne Compagnie de Guinée.
Le maire de Nantes et subdélégué de l’Intendance de Bretagne, Gérard Mellier, fournit une " Réponse au Mémoire présenté à Nos seigneurs du Conseil Royal de la Marine concernant les nègres esclaves que les officiers et habitants des Colonies Françaises de l'Amérique amenèrent en France pour leur service ", justifiant le bien-fondé de la traite :
" Les motifs de ces édits sont fondés sur ce que la traite des nègres qu'on porte aux îles de l'Amérique est absolument nécessaire pour la culture des sucres, tabacs, cotons, indigos et autres denrées qui sont apportées de ces pays en France. Ce commerce qui par la vénalité des hommes les rend comparables aux Bestiaux, ne serait pas autorisé sans le besoin indispensable qu'on a de leur service dans nos colonies et sans que les nègres que nous y transportons sortent de l'erreur et de l'idolâtrie pour y recevoir le Baptême, et qu'ils y sont instruits avec soin dans la Religion Romaine par les prêtres et les missionnaires préposés à cet effet... "
Mellier profite aussi de la réorganisation de la Compagnie, pour faire désigner sa ville, Nantes, comme seul lieu de vente des marchandises des Indes, privilège qui sera maintenu jusqu’en 1733.
Les autres armateurs, dont les Bordelais sont pénalisés par l'exemption de droits de la Compagnie...
1721 : Dunkerque est le 9ème port français à recevoir l'autorisation de la traite.
Pour les Isles du Vent, l’intendant général Besnard fournit le 22 août un : "Estat des nègres introduits à la Martinique du 1er janvier 1714 au 7 aoust 1721" :
1720 : La Banque royale et la Compagnie perpétuelle des Indes fusionnent le 5 janvier, John Law est nommé contrôleur général des finances, puis surintendant général des Finances.
La Banque Royale a émis plus d'un milliard de livres de papier monnaie.
Le 23 mars, le système de Law perd la confiance des déposants qui se présentent en masse pour échanger leur papier-monnaie contre des espèces métalliques que la société ne possède déjà plus !
En juillet, la banqueroute est totale...
En décembre 1720, Bourgeois, le trésorier de la Banque qui s’était considérablement enrichi, est conduit à la Bastille, ainsi que Durevest, le contrôleur et Fromaget, l'un des directeurs.
John Law, ruiné, est obligé de fuir le royaume et se réfugie à Venise, où il finira ses jours en 1729.
La Compagnie des Indes lui survit, avec une nécessaire réorganisation depuis qu'elle a retrouvé son indépendance…
Le Privilège exclusif de la traite est rétablit en sa faveur le 27 septembre, avec en plus une exemption des 20 livres de droits par tête, mais elle doit s'engager à apporter 3000 nègres par an aux Isles Françoises de l'Amérique, au lieu des 1000 de l'ancienne Compagnie de Guinée.
Le maire de Nantes et subdélégué de l’Intendance de Bretagne, Gérard Mellier, fournit une " Réponse au Mémoire présenté à Nos seigneurs du Conseil Royal de la Marine concernant les nègres esclaves que les officiers et habitants des Colonies Françaises de l'Amérique amenèrent en France pour leur service ", justifiant le bien-fondé de la traite :
" Les motifs de ces édits sont fondés sur ce que la traite des nègres qu'on porte aux îles de l'Amérique est absolument nécessaire pour la culture des sucres, tabacs, cotons, indigos et autres denrées qui sont apportées de ces pays en France. Ce commerce qui par la vénalité des hommes les rend comparables aux Bestiaux, ne serait pas autorisé sans le besoin indispensable qu'on a de leur service dans nos colonies et sans que les nègres que nous y transportons sortent de l'erreur et de l'idolâtrie pour y recevoir le Baptême, et qu'ils y sont instruits avec soin dans la Religion Romaine par les prêtres et les missionnaires préposés à cet effet... "
Mellier profite aussi de la réorganisation de la Compagnie, pour faire désigner sa ville, Nantes, comme seul lieu de vente des marchandises des Indes, privilège qui sera maintenu jusqu’en 1733.
Les autres armateurs, dont les Bordelais sont pénalisés par l'exemption de droits de la Compagnie...
1721 : Dunkerque est le 9ème port français à recevoir l'autorisation de la traite.
Pour les Isles du Vent, l’intendant général Besnard fournit le 22 août un : "Estat des nègres introduits à la Martinique du 1er janvier 1714 au 7 aoust 1721" :
- 13 navires dont 8 armés à Nantes en 1714, introduisant 2.460 nègres
- 11 négriers dont 10 nantais en 1715 avec 2.553 esclaves
- 12 négriers dont 9 nantais en 1716 avec 1.899 esclaves
- 4 négriers nantais en 1717 avec 1256 esclaves
- 3 négriers nantais en 1718 avec 686 esclaves
- 5 négriers dont 4 nantais en 1719 avec 446 esclaves
- 8 négriers dont 6 nantais en 1720 avec 1.219 esclaves
- 6 négriers dont 4 nantais en 1721 avec 1.014 esclaves
Dans le même temps, 35 négriers nantais ont vendu directement à St Domingue, au Cap Français, à Léogane et à Petit Goave.
Enfin 1 pour Cayenne et 1 pour Surinam.
Dans le courrier qui accompagne cet "Estat", l’intendant constate que de fait la Guadeloupe achète ses nègres essentiellement avec le commerce étranger, en particulier anglais, on peut supposer la même chose pour Marie-Galante…
La provenance des esclaves est précisée dans tous les cas : 4 de la " Coste d’Angole ", tous les autres de la " Coste de Guynée ", avec dans bien des cas la provenance précise : Juda, Galbar, Bony, cap La Hogue, coste des Mina ou rivière du Bénin.
1722 : La nouvelle Compagnie des Indes arme 23 navires, dont 8 pour la traite, de 35 à 580 tonneaux, en moyenne 300.
La destination est le Sénégal (Gorée) pour 7 d’entre-eux, 1 seul pour la Guinée (Juda)
Les armateurs nantais obtiennent une Déclaration du Roy qui leur donne une exemption de droits de 6 livres par nègre introduit.
1723 : Le Régent Philippe d'Orléans donne une nouvelle administration à la Compagnie des Indes, celle-ci étant régie par 12 directeurs et 8 syndics. Le directeur est nommé par la Compagnie et ultérieurement un commissaire du Roi exerce une réelle surveillance. Par ailleurs, Le privilège exclusif de la vente du café est rétabli et est concédé à la nouvelle Compagnie.
La Compagnie arme cette année au départ de Lorient 19 navires dont 11 pour la traite. 4 ont pour destination première le Sénégal, les 7 autres la Côte de Guinée et en particulier Juda.
Parmi eux, le Courrier de Bourbon, 120 tonneaux, charge 55 nègres en Gambie, puis 100 à Gorée le 27 juillet, où le capitaine note :
" le gouverneur et le garde magasin ont fait un choix des plus mauvais à nous donner"...
Le 11 août, il écrit dans son journal :
"Voilà déjà pour si peu de temps que nous sommes sortis de Gorée, 15 à 16 noirs tant mâles que femelles bien incommodés de la vérette; nous appréhendons une plus fâcheuse suite"...
Ils auront 13 morts avant d'arriver à la Grenade.
Le vaisseau négrier l’Annibal, également armé par la Compagnie des Indes, capitaine Dutertre-Hardouin, part en mars de Port-Louis et va chercher ses captifs en Guinée autour de Juda : le 16 septembre, sa traite est finie avec " 139 nègres, 15 nègresses, 7 nègrillons et 4 négrilles ", il repart vers les Antilles.
La Compagnie arme cette année au départ de Lorient 19 navires dont 11 pour la traite. 4 ont pour destination première le Sénégal, les 7 autres la Côte de Guinée et en particulier Juda.
Parmi eux, le Courrier de Bourbon, 120 tonneaux, charge 55 nègres en Gambie, puis 100 à Gorée le 27 juillet, où le capitaine note :
" le gouverneur et le garde magasin ont fait un choix des plus mauvais à nous donner"...
Le 11 août, il écrit dans son journal :
"Voilà déjà pour si peu de temps que nous sommes sortis de Gorée, 15 à 16 noirs tant mâles que femelles bien incommodés de la vérette; nous appréhendons une plus fâcheuse suite"...
Ils auront 13 morts avant d'arriver à la Grenade.
Le vaisseau négrier l’Annibal, également armé par la Compagnie des Indes, capitaine Dutertre-Hardouin, part en mars de Port-Louis et va chercher ses captifs en Guinée autour de Juda : le 16 septembre, sa traite est finie avec " 139 nègres, 15 nègresses, 7 nègrillons et 4 négrilles ", il repart vers les Antilles.
Il mouille à St Pierre de la Martinique de décembre 1723 à mai 1724, pour vendre ses esclaves et réparer. Après une escale de 2 jours en Guadeloupe, il rentre à Lorient.
Pendant plus de 30 ans, tous les négriers de la Compagnie vont partir de Lorient.
Pendant plus de 30 ans, tous les négriers de la Compagnie vont partir de Lorient.
1724 : En août," Arrest du Conseil d'Etat, pour le payement de la gratification de treize livres par tête de Négre, & de vingt livres par chaque marc de Matiere ou Poudre d'Or, que la Compagnie du Sénégal & Cote d Afrique fera entrer en France , venant des Païs de la Concession "
La Compagnie arme cette année 28 navires au départ de Port Louis (Lorient), dont 13 pour la traite, tel le Pingre l’Aventurier, ci-dessous, destiné à " Juda Coste de Guiné ", 300 tonneaux, 14 canons, capitaine La Chapelle Maillard, parti le 17 octobre.
La Compagnie arme cette année 28 navires au départ de Port Louis (Lorient), dont 13 pour la traite, tel le Pingre l’Aventurier, ci-dessous, destiné à " Juda Coste de Guiné ", 300 tonneaux, 14 canons, capitaine La Chapelle Maillard, parti le 17 octobre.
Il coulera à son retour le 10 février 1726 en face de Molène…
Bordeaux, après quelques rares navires négriers, commence la traite bien après Nantes : 2 navires cette année pour la Martinique le Duc de Bourbon, 200 tonneaux, 294 nègres et la Grande Flore, 250 tonneaux, 506 nègres...
Seconde version du Code Noir par Louis XV, destinée à la Louisiane...
Bordeaux, après quelques rares navires négriers, commence la traite bien après Nantes : 2 navires cette année pour la Martinique le Duc de Bourbon, 200 tonneaux, 294 nègres et la Grande Flore, 250 tonneaux, 506 nègres...
Seconde version du Code Noir par Louis XV, destinée à la Louisiane...
1725 : En France, suppression des monopoles des Compagnies de traite : tous les ports français peuvent désormais la pratiquer, la traite devient libre en échange de droits.
La Compagnie des Indes va armer cette année 19 navires dont 10 pour la traite au départ de Port Louis, 5 pour le Sénégal, 5 pour la Guinée.
1726 : La Compagnie arme 16 navires au départ de Port Louis, dont 10 négriers.
9 d’entre-eux prendront leurs esclaves au Sénégal, 2 couleront sur les cayes de Saint Domingue, on ne sait si c’est avant ou après livraison de leur marchandise…
La Compagnie perd son exclusif, ne gardant que la concession du Sénégal, et elle ne perçoit plus que 10 livres au lieu de 20 des armateurs indépendants.
Recensement de Marie Galante : 2.332 habitants dont 1.806 esclaves (77%), 678 nègres payant droit, 480 négresses payant droit, 361 négrillons, 287 négrittes.
La Compagnie des Indes va armer cette année 19 navires dont 10 pour la traite au départ de Port Louis, 5 pour le Sénégal, 5 pour la Guinée.
1726 : La Compagnie arme 16 navires au départ de Port Louis, dont 10 négriers.
9 d’entre-eux prendront leurs esclaves au Sénégal, 2 couleront sur les cayes de Saint Domingue, on ne sait si c’est avant ou après livraison de leur marchandise…
La Compagnie perd son exclusif, ne gardant que la concession du Sénégal, et elle ne perçoit plus que 10 livres au lieu de 20 des armateurs indépendants.
Recensement de Marie Galante : 2.332 habitants dont 1.806 esclaves (77%), 678 nègres payant droit, 480 négresses payant droit, 361 négrillons, 287 négrittes.
1727 : Édit en octobre qui condamne aux galères tout individu coupable d’avoir introduit des " nègres, effets, denrées ou marchandises autrement que par navire français " : le gouvernement veut faire cesser le commerce " interlope ", qui est devenu dominant du fait de la faiblesse du commerce maritime français.
Sur la côte d'Afrique, Agadja, nouveau roi du Dahomey s'est lancé à la conquête de ses voisins, essentiellement pour prendre le monopole du commerce avec les Européens, Ardres est tombé en 1724, Juda ne va pas tarder à tomber.
Ces guerres tribales vont perturber la traite, le capitaine Guesneau du négrier nantais Le More en est témoin :
" ...pendant sa traite à Juda, il a été interrompu dans son commerce par la guerre des nègres dudit lieu et ceux de Dahomet, ce qui obligea ledit sieur Guesneau de s’en aller à son bord et de quitter son magasin... sans avoir eu seulement le temps de pouvoir faire inventaire des marchandises qu’il laissa dans ledit magasin appartenant tant à la cargaison qu’aux particuliers, les nègres de Dahomet étant dès ce temps à un quart de lieu de Xavier, qu’ils commençaient à brûler tout le pays et entrèrent à Juda qu’ils brûlèrent entièrement, pillèrent et emportèrent toutes les marchandises qui se trouvèrent dans ledit magasin et prirent prisonniers lesdits gens de son équipage qu’il avait laissés à la garde de son dit magasin."
Le More arrivera quand même en Martinique le 28 mai avec 277 nègres à vendre sur les 300 du départ.
Ces 5 dernières années, Nantes a armé 32 navires négriers dont 22 ont eu la Martinique pour destination, pas un pour la Guadeloupe....
Recensement à Mariegalande : 2.539 habitants dont 1.769 esclaves (69%), à Basse-Terre (futur Grand Bourg) 846 esclaves dont 452 payant droits, à Capesterre 613 esclaves dont 288 payant droits, à Vieux Fort 370 esclaves dont 219 payant droits. Ceux pour lesquels les maîtres ne payent pas de droits de capitation ne travaillent pas encore ou plus : en-dessous de 14 ans ou au-dessus de 60.
Sur la côte d'Afrique, Agadja, nouveau roi du Dahomey s'est lancé à la conquête de ses voisins, essentiellement pour prendre le monopole du commerce avec les Européens, Ardres est tombé en 1724, Juda ne va pas tarder à tomber.
Ces guerres tribales vont perturber la traite, le capitaine Guesneau du négrier nantais Le More en est témoin :
" ...pendant sa traite à Juda, il a été interrompu dans son commerce par la guerre des nègres dudit lieu et ceux de Dahomet, ce qui obligea ledit sieur Guesneau de s’en aller à son bord et de quitter son magasin... sans avoir eu seulement le temps de pouvoir faire inventaire des marchandises qu’il laissa dans ledit magasin appartenant tant à la cargaison qu’aux particuliers, les nègres de Dahomet étant dès ce temps à un quart de lieu de Xavier, qu’ils commençaient à brûler tout le pays et entrèrent à Juda qu’ils brûlèrent entièrement, pillèrent et emportèrent toutes les marchandises qui se trouvèrent dans ledit magasin et prirent prisonniers lesdits gens de son équipage qu’il avait laissés à la garde de son dit magasin."
Le More arrivera quand même en Martinique le 28 mai avec 277 nègres à vendre sur les 300 du départ.
Ces 5 dernières années, Nantes a armé 32 navires négriers dont 22 ont eu la Martinique pour destination, pas un pour la Guadeloupe....
Recensement à Mariegalande : 2.539 habitants dont 1.769 esclaves (69%), à Basse-Terre (futur Grand Bourg) 846 esclaves dont 452 payant droits, à Capesterre 613 esclaves dont 288 payant droits, à Vieux Fort 370 esclaves dont 219 payant droits. Ceux pour lesquels les maîtres ne payent pas de droits de capitation ne travaillent pas encore ou plus : en-dessous de 14 ans ou au-dessus de 60.
1729 : Le négrier l'Amériquain, capitaine L'Epinay, arrive en Martinique "très richement chargé tant en poudre d'or qu'en nègres, dont tous les officiers ou étoient morts, ou avoient été changés par le Directeur de la Compagnie de Guinée"
Le négrier bordelais l'Union, 65 tonneaux va chercher sa cargaison à Gorée et amène 125 esclaves à St Pierre de la Martinique.
1730 : Dans son Dictionnaire Universel de Commerce, Jacques Savary des Bruslons définit ainsi la traite :
" Les Européens font depuis des siècles commerce de ces malheureux esclaves, qu’ils tirent de Guinée et des autres côtes d’Afrique, pour soutenir les Colonies qu’ils ont établies dans plusieurs endroits de l’Amérique et dans les Antilles."
Au Sénégal, l'Isle de Gorée, au large de Dakar, est en pleine activité pour la traite française...
1730 : Dans son Dictionnaire Universel de Commerce, Jacques Savary des Bruslons définit ainsi la traite :
" Les Européens font depuis des siècles commerce de ces malheureux esclaves, qu’ils tirent de Guinée et des autres côtes d’Afrique, pour soutenir les Colonies qu’ils ont établies dans plusieurs endroits de l’Amérique et dans les Antilles."
Au Sénégal, l'Isle de Gorée, au large de Dakar, est en pleine activité pour la traite française...
Parmi les vaisseaux négriers nantais qui ont chargé à Gorée, le Monarque, 150 tonneaux, armé par la veuve Bertrand, commandé par le capitaine Marias, a livré en mars à la Martinique 364 esclaves. Il a perdu pendant la traversée 9 membres d’équipage et 90 esclaves.
Premier navire de traite au départ de Vannes, le Diligent, avec la Martinique pour destination finale.
1733 : En Martinique, arrivée de 1.145 esclaves sur 3 négriers, vendus pour un montant total de 693.000 livres, soit en moyenne 605 livres par esclave, mais il y 2 fois plus de femmes que d’hommes.
1734 : La Compagnie des Indes décide de transférer de Nantes à Lorient le siège de toutes ses ventes, et fait construire par l'architecte Jean-Charles Gabriel les nouveaux bâtiments pour accueillir ses activités dans l" Enclos" de Port-Louis, à l’entrée de la rade.
Premier navire de traite au départ de Vannes, le Diligent, avec la Martinique pour destination finale.
1733 : En Martinique, arrivée de 1.145 esclaves sur 3 négriers, vendus pour un montant total de 693.000 livres, soit en moyenne 605 livres par esclave, mais il y 2 fois plus de femmes que d’hommes.
1734 : La Compagnie des Indes décide de transférer de Nantes à Lorient le siège de toutes ses ventes, et fait construire par l'architecte Jean-Charles Gabriel les nouveaux bâtiments pour accueillir ses activités dans l" Enclos" de Port-Louis, à l’entrée de la rade.
En France, le 6 juillet, Ordonnance du Roy " qui règle les certificats de la Traite des Nègres aux Isles Françoises de l’Amérique " avec de plus un " Modèle de Facture et de Bordereau du produit de la Vente des Nègres" fourni…
Les révoltes de Noirs sont de plus en plus fréquentes à bord de navires de traite sur la côte d'Afrique : sur l'Aventurier à Juda, avec 240 nègres, ils " égorgèrent le sieur pilote qui était malade et frappèrent plusieurs membres de l'équipage à coup de hache, couteaux...dont ils se saisirent, ce qui obligea le sieur Barnabé Shiell, commandant à bord (rapport à ce que le déclarant était malade) à faire prendre les armes à 5 à 6 hommes qui restoient sur le gaillard arrière afin de se défendre, le surplus étant malade sur leurs cadres et autres tant occupés à terre que sur la barre, que dans cette dite révolte ils ont perdu 40 nègres tant tués sur le champ que morts de leurs blessures et quelques uns qui se jettèrent à la mer "...
En Martinique, on dispose d’un "Etat des Batiments marchands venant de Guinée arrivez à la Martinique pendant l'année 1733 et des noirs qu'ils y on apportés" : 2 négriers pour Fort St Pierre, le Fortune de Nantes avec 388 esclaves et la Ste Anne St Antoine et Almas, navire portugais qui doit vendre ses 111 esclaves faute de vivres…
Pour Fort Royal, 2 négriers de Nantes, la Françoise 204 esclaves et le Héros 452 esclaves.
Le négrier Le St Dominique vend sa cargaison de nègres à l'arrivée en Guadeloupe : les hommes "pièces d’Inde" sont vendus de 900 à 1.000 livres, les femmes de 600 à 700, les garçons et filles de 400 à 500 livres.
1735 : En Martinique, 4 négriers, dont 3 de Nantes et 1 de la Compagnie des Indes, ont amené de Juda et du Sénégal
1.176 esclaves.
Les épidémies déciment les équipages : sur les 134 morts à l’hôpital de St Pierre, 124 viennent de ces navires.
Dans le rapport du commerce des Isles du Vent, il est bien rappelé "qu’à l’isle de Marie Galande qu’il n’a point été de vaisseau directement, leur commerce se fait par des batteaux qui portent leur denrées à la Martinique ", ce qui est certainement aussi le cas des négriers qui transitent par la Martinique et non la Guadeloupe.
1737 : Sur l’année, 9 négriers, dont 3 de Nantes, ont introduit 2.603 esclaves en Martinique.
Marie-Galante, qui dépend toujours de la Martinique, en a récuperé probablement une partie…
1739 : En Martinique, arrivée de 7 négriers, dont 2 de la Compagnie des Indes, en provenance de la Côte de Guinée avec 2.335 esclaves.
Depuis 1728, le seul petit négrier bordelais l'Union aura fait 5 voyages de traite et livré ses esclaves en Martinique ou à St Domingue. Son armateur Jean Marchais aura armé 7 des 11 expéditions bordelaises en 9 ans...
1740 : Lorient, siège de la Compagnie à Port Louis, bénéficie de la prospérité de celle-ci.
La majorité des bateaux négriers partis de Port-Louis vont charger à St Louis du Sénégal et à Gorée, compléter leur chargement en Guinée (Juda), aller vendre leur cargaison surtout à St Domingue, secondairement en Martinique et accessoirement en Guadeloupe.
A Juda ou Ouidah ou Whidah, port du Royaume d’Abomey (futur Bénin), la traite négrière est le monopole royal du Roi Kpengla.
Elle est alimentée par des razzias aux limites du royaume, au bénéfice de l'ethnie des Fons.
Presque tous les pays européens sont présents sur place, disposant chacun d’un fort destiné à la traite :
fort Français, fort Anglais, fort Danois, fort Portugais, fort Hollandais…
1735 : En Martinique, 4 négriers, dont 3 de Nantes et 1 de la Compagnie des Indes, ont amené de Juda et du Sénégal
1.176 esclaves.
Les épidémies déciment les équipages : sur les 134 morts à l’hôpital de St Pierre, 124 viennent de ces navires.
Dans le rapport du commerce des Isles du Vent, il est bien rappelé "qu’à l’isle de Marie Galande qu’il n’a point été de vaisseau directement, leur commerce se fait par des batteaux qui portent leur denrées à la Martinique ", ce qui est certainement aussi le cas des négriers qui transitent par la Martinique et non la Guadeloupe.
1737 : Sur l’année, 9 négriers, dont 3 de Nantes, ont introduit 2.603 esclaves en Martinique.
Marie-Galante, qui dépend toujours de la Martinique, en a récuperé probablement une partie…
1739 : En Martinique, arrivée de 7 négriers, dont 2 de la Compagnie des Indes, en provenance de la Côte de Guinée avec 2.335 esclaves.
Depuis 1728, le seul petit négrier bordelais l'Union aura fait 5 voyages de traite et livré ses esclaves en Martinique ou à St Domingue. Son armateur Jean Marchais aura armé 7 des 11 expéditions bordelaises en 9 ans...
1740 : Lorient, siège de la Compagnie à Port Louis, bénéficie de la prospérité de celle-ci.
La majorité des bateaux négriers partis de Port-Louis vont charger à St Louis du Sénégal et à Gorée, compléter leur chargement en Guinée (Juda), aller vendre leur cargaison surtout à St Domingue, secondairement en Martinique et accessoirement en Guadeloupe.
A Juda ou Ouidah ou Whidah, port du Royaume d’Abomey (futur Bénin), la traite négrière est le monopole royal du Roi Kpengla.
Elle est alimentée par des razzias aux limites du royaume, au bénéfice de l'ethnie des Fons.
Presque tous les pays européens sont présents sur place, disposant chacun d’un fort destiné à la traite :
fort Français, fort Anglais, fort Danois, fort Portugais, fort Hollandais…
18 armements de la Compagnie au départ de Port Louis, dont 8 navires négriers.
Parmi eux, La Gloire, 400 tonneaux, 20 canons, capitaine Charles Bocquet de Fontené, part de Lorient le 25 mai.
Il ancre devant Gorée le 12 août et charge "600 testes de negres" : 353 hommes, 143 femmes, 43 négrites et 61 négrillons.
Parmi eux, La Gloire, 400 tonneaux, 20 canons, capitaine Charles Bocquet de Fontené, part de Lorient le 25 mai.
Il ancre devant Gorée le 12 août et charge "600 testes de negres" : 353 hommes, 143 femmes, 43 négrites et 61 négrillons.
Pendant la traversée, il essuie une tempête, puis une révolte des nègres, 5 morts chez les marins, chiffre inconnu pour les nègres…
Il ancre devant Fort Royal de la Martinique le 24 septembre, la vente des nègres est ouverte le 5 octobre, elle se termine le 6, il charge du sucre à partir du 10 octobre et mets les voiles pour Lorient le 18.
Autre exemple de traite : les instructions de l'armateur nantais de La Légère à son capitaine Fouquet lui donnent l’ordre d’aller à Cabingue, comptoir portugais de Guinée : " Il ne vous faut absolument traiter que de jeunes nègres de 15 à 20 ans, 2/3 mâles et 1/3 femelles. Vous ferez surtout attention qu’ils soient tous nègres véritables congo ou missy-congo. Sur toutes choses point de nègres mayombes, mondogo ni soigne, parce qu’ils sont peu estimés dans les colonies et surtout au Cap François où vous vous rendrez moyennant l’aide du Seigneur " ...
1741 : " Arrest du conseil d'Etat du Roy qui permet aux négociants et armateurs des ports, autorisez à faire le Commerce des Colonies d'Amérique, d'armer et d'équiper leurs vaisseaux pour la Côte de Guinée" : la Compagnie a perdu son exclusif...
Il ancre devant Fort Royal de la Martinique le 24 septembre, la vente des nègres est ouverte le 5 octobre, elle se termine le 6, il charge du sucre à partir du 10 octobre et mets les voiles pour Lorient le 18.
Autre exemple de traite : les instructions de l'armateur nantais de La Légère à son capitaine Fouquet lui donnent l’ordre d’aller à Cabingue, comptoir portugais de Guinée : " Il ne vous faut absolument traiter que de jeunes nègres de 15 à 20 ans, 2/3 mâles et 1/3 femelles. Vous ferez surtout attention qu’ils soient tous nègres véritables congo ou missy-congo. Sur toutes choses point de nègres mayombes, mondogo ni soigne, parce qu’ils sont peu estimés dans les colonies et surtout au Cap François où vous vous rendrez moyennant l’aide du Seigneur " ...
1741 : " Arrest du conseil d'Etat du Roy qui permet aux négociants et armateurs des ports, autorisez à faire le Commerce des Colonies d'Amérique, d'armer et d'équiper leurs vaisseaux pour la Côte de Guinée" : la Compagnie a perdu son exclusif...
La campagne du négrier La Vestale est détaillée dans son journal de bord : parti de Port-Louis le 4 octobre 1741, armé par la Compagnie des Indes, capitaine Blain des Cormiers, le navire charge au Sénégal le 26 octobre, à Gorée le 7 novembre, puis en Gambie le 21 novembre, un total de 400 esclaves dont 315 hommes.
Il perd 13 Noirs pendant la traversée, il livre la Martinique du 5 juillet au 9 octobre 1742, où il en perd 15 autres pendant la vente.
Il avait perdu 3 hommes d’équipage pendant la traversée et 2 à l’arrivée en Martinique.
10 membres d’équipage ont déserté pendant le séjour en Martinique, dont le chirurgien du bord.
Le retour à Lorient se fait le 6 décembre 1742, ayant perdu un homme à la mer.
Bordeaux arme 7 négriers cette année.
Premier navire de traite au départ de Bayonne : le Junon, parti le 13 mai et qui livrera ses nègres en Martinique le 10 mars de l'année suivante. Bayonne ne sera pas un grand port négrier : en tout 9 navires jusqu'en 1790...
1742 : Une Ordonnance du Roy du 13 mars exempte de droits ' les marchandises provenant de la traite des Nègres aus Isles Françaises de l'Amérique" : le troc doit rester le plus rentable...
Il avait perdu 3 hommes d’équipage pendant la traversée et 2 à l’arrivée en Martinique.
10 membres d’équipage ont déserté pendant le séjour en Martinique, dont le chirurgien du bord.
Le retour à Lorient se fait le 6 décembre 1742, ayant perdu un homme à la mer.
Bordeaux arme 7 négriers cette année.
Premier navire de traite au départ de Bayonne : le Junon, parti le 13 mai et qui livrera ses nègres en Martinique le 10 mars de l'année suivante. Bayonne ne sera pas un grand port négrier : en tout 9 navires jusqu'en 1790...
1742 : Une Ordonnance du Roy du 13 mars exempte de droits ' les marchandises provenant de la traite des Nègres aus Isles Françaises de l'Amérique" : le troc doit rester le plus rentable...
1744 : Bordeaux a armé 15 négriers en 2 ans.
19 négriers en provenance de la Côte de Guinée ont introduit en Martinique (et donc partiellement pour sa dépendance Marie-Galante) 5.555 nègres, 2 fois plus qu’en 1739…
Parmi ces navires, 8 ont été affrétés à Nantes, 4 à Bordeaux, 4 à St Malo, 1 pour La Rochelle, Le Havre et Lorient.
Les ventes ont rapporté 3.463.339 livres, soit un prix moyen de 623 livres par esclave.
Les corsaires anglais ont pris ou détruit 6 négriers, dont le Patriarche Abraham de l'armateur bordelais Gradis, avec 653 noirs capturés.
Dans le même temps, 29 navires anglais ont été pris par 8 de nos corsaires, dont 2 négriers avec 369 esclaves.
1745 : Du fait de la guerre avec les Anglais, seuls 7 négriers, dont 6 armés à Nantes, introduisent 2.430 nègres, moitié moins que l’année précédente, de fait l’ensemble du commerce a chuté de moitié…
1746 : La pénurie de nègres augmente avec le blocus…
Début décembre, un corsaire amène à St Pierre sa prise, un négrier anglais avec 400 esclaves : ils sont vendus en 1 matinée, payés en argent comptant, bien que leur prix soit au plus haut : 1.200 à 1.300 livres.
Du Fresne de Francheville écrit avec approbation et privilège du Roy " Histoire de la Compagnie des Indes avec les Titres de ses concessions et privilèges dressée sur les pièces authentiques " : il nous donne une " Carte chronologique des Compagnies de Commerce et de leurs Concessions, dont celles de la Compagnie des Indes tirent leur Origine "
19 négriers en provenance de la Côte de Guinée ont introduit en Martinique (et donc partiellement pour sa dépendance Marie-Galante) 5.555 nègres, 2 fois plus qu’en 1739…
Parmi ces navires, 8 ont été affrétés à Nantes, 4 à Bordeaux, 4 à St Malo, 1 pour La Rochelle, Le Havre et Lorient.
Les ventes ont rapporté 3.463.339 livres, soit un prix moyen de 623 livres par esclave.
Les corsaires anglais ont pris ou détruit 6 négriers, dont le Patriarche Abraham de l'armateur bordelais Gradis, avec 653 noirs capturés.
Dans le même temps, 29 navires anglais ont été pris par 8 de nos corsaires, dont 2 négriers avec 369 esclaves.
1745 : Du fait de la guerre avec les Anglais, seuls 7 négriers, dont 6 armés à Nantes, introduisent 2.430 nègres, moitié moins que l’année précédente, de fait l’ensemble du commerce a chuté de moitié…
1746 : La pénurie de nègres augmente avec le blocus…
Début décembre, un corsaire amène à St Pierre sa prise, un négrier anglais avec 400 esclaves : ils sont vendus en 1 matinée, payés en argent comptant, bien que leur prix soit au plus haut : 1.200 à 1.300 livres.
Du Fresne de Francheville écrit avec approbation et privilège du Roy " Histoire de la Compagnie des Indes avec les Titres de ses concessions et privilèges dressée sur les pièces authentiques " : il nous donne une " Carte chronologique des Compagnies de Commerce et de leurs Concessions, dont celles de la Compagnie des Indes tirent leur Origine "
1748 : Jean-Baptiste Grou, François-Augustin Michel, négociants nantais, s'associent le financier parisien Antoine Crozat pour former la nouvelle Compagnie de Guinée : Ils vont armer leur 1er négrier cette année.
En parallèle, Antoine Walch, grand armateur de Nantes, soutenu par le financier parisien de Montmartel, crée la Compagnie d’Angola, fondée avec un capital de 1.600.000 livres.
Elle possède rapidement une flotte spécialisée : 2 navires de traite de grande capacité : le Roi de Louangue et le Roi de Gabingue,
5 navires de traite aux noms mythologiques : Achille, Alcmène, Amphityon, Andromaque et Hector, des convoyeurs chargés de ravitailler les sites de traite : le Montmartel et le St Charles, une corvette pour la protection des chaloupes et des entrepôts : le Chasseur, etc...
1749 : La paix d'Aix la Chapelle relance l’économie...
Nantes arme 44 navires négriers, d’un tonnage moyen de 175 tonneaux, réalisant à elle seule 45% des expéditions négrières Françaises.
" Pour chaque navire, l’équipage négrier est proportionné au tonnage du navire et au contingent de Noirs prévu par l’armateur.
En moyenne, on prévoit un homme pour 5 ou 6 tonneaux de jauge et 10 captifs. En fait, quand 20 marins suffisent à naviguer 300 tonneaux en droiture vers les Antilles, il en faut au moins 50 pour aller chercher des Noirs en Afrique. Ce surplus de main-d’œuvre s’explique par l’hémorragie d’hommes (provoquée par les débarquements volontaires, les désertions, la maladie, et surtout la mort qui frappe de 10 à 15 % de l’équipage) mais aussi par la double fonction du marin, manœuvrier et garde-chiourme.
Dans ces navires négriers, seul le capitaine bénéficiait d’une cabine assez spacieuse. Les matelots s’entassaient dans un poste d’environ 10 mètres sur 6 avec leurs hamacs, leurs sacs, leurs armes et leurs munitions. L’équipage d’un négrier nécessitait un calfat (ouvrier capable de réparer la coque), un timonier, un voilier, un canonnier, un maître coq en plus des matelots."
En Martinique, le commerce a bien repris, presque doublé en 1 an, la traite aussi : 6 négriers, dont 3 de Nantes, apportent 1.130 esclaves (452 nègres, 371 négresses, 160 négrillons et 147 négrites).
1750 : Pour éviter l’affrontement, Les 2 Compagnies Nantaises décident de se partager à parts égales le droit exclusif de ventes des Noirs, elles vont effectuer à elles deux la moitié de la traite…
En France, Nantes arme 23 navires négriers, d’un tonnage moyen de 163 tonneaux. 20 arriveront à destination, dont 11 pour la Martinique.
En Afrique, la "production " de captifs était gérée essentiellement par des Africains. Mannix estime que seuls 2 % des captifs de la traite atlantique furent kidnappés par des négriers blancs. Les principales modalités de réduction en esclavage étaient la capture à la guerre, l'enlèvement, les règlements de tributs et d'impôts, les dettes, la punition pour crimes, l'abandon et la vente d'enfants, l'asservissement volontaire et la naissance…
En parallèle, Antoine Walch, grand armateur de Nantes, soutenu par le financier parisien de Montmartel, crée la Compagnie d’Angola, fondée avec un capital de 1.600.000 livres.
Elle possède rapidement une flotte spécialisée : 2 navires de traite de grande capacité : le Roi de Louangue et le Roi de Gabingue,
5 navires de traite aux noms mythologiques : Achille, Alcmène, Amphityon, Andromaque et Hector, des convoyeurs chargés de ravitailler les sites de traite : le Montmartel et le St Charles, une corvette pour la protection des chaloupes et des entrepôts : le Chasseur, etc...
1749 : La paix d'Aix la Chapelle relance l’économie...
Nantes arme 44 navires négriers, d’un tonnage moyen de 175 tonneaux, réalisant à elle seule 45% des expéditions négrières Françaises.
" Pour chaque navire, l’équipage négrier est proportionné au tonnage du navire et au contingent de Noirs prévu par l’armateur.
En moyenne, on prévoit un homme pour 5 ou 6 tonneaux de jauge et 10 captifs. En fait, quand 20 marins suffisent à naviguer 300 tonneaux en droiture vers les Antilles, il en faut au moins 50 pour aller chercher des Noirs en Afrique. Ce surplus de main-d’œuvre s’explique par l’hémorragie d’hommes (provoquée par les débarquements volontaires, les désertions, la maladie, et surtout la mort qui frappe de 10 à 15 % de l’équipage) mais aussi par la double fonction du marin, manœuvrier et garde-chiourme.
Dans ces navires négriers, seul le capitaine bénéficiait d’une cabine assez spacieuse. Les matelots s’entassaient dans un poste d’environ 10 mètres sur 6 avec leurs hamacs, leurs sacs, leurs armes et leurs munitions. L’équipage d’un négrier nécessitait un calfat (ouvrier capable de réparer la coque), un timonier, un voilier, un canonnier, un maître coq en plus des matelots."
En Martinique, le commerce a bien repris, presque doublé en 1 an, la traite aussi : 6 négriers, dont 3 de Nantes, apportent 1.130 esclaves (452 nègres, 371 négresses, 160 négrillons et 147 négrites).
1750 : Pour éviter l’affrontement, Les 2 Compagnies Nantaises décident de se partager à parts égales le droit exclusif de ventes des Noirs, elles vont effectuer à elles deux la moitié de la traite…
En France, Nantes arme 23 navires négriers, d’un tonnage moyen de 163 tonneaux. 20 arriveront à destination, dont 11 pour la Martinique.
En Afrique, la "production " de captifs était gérée essentiellement par des Africains. Mannix estime que seuls 2 % des captifs de la traite atlantique furent kidnappés par des négriers blancs. Les principales modalités de réduction en esclavage étaient la capture à la guerre, l'enlèvement, les règlements de tributs et d'impôts, les dettes, la punition pour crimes, l'abandon et la vente d'enfants, l'asservissement volontaire et la naissance…
"Les navires négriers disposaient de plusieurs méthodes pour prendre ces captifs sur la côte africaine. Il fallait choisir la meilleure en fonction d’une conjoncture fluctuante :
La traite au comptoir imposait une file d’attente, la présence agacée de rivaux étrangers (souvent Anglais), un accueil hostile des chefs locaux, une pénurie de captifs, ou des prix extravagants.
La traite itinérante n’était pas la méthode la plus simple. Elle consistait à descendre le long de la côte, à mouiller dans les rades foraines quand il s’en présentait, ou à s’ancrer à l’entrée des rivières qui s’insinuaient à l’intérieur des terres. A chaque fois, on devait disposer de la chaloupe, franchir la barre qui déferle dangereusement le long du rivage, prendre langue avec les autorités locales, leur offrir des présents, et s’entendre avec eux sur les délais de livraison, le nombre et le prix des captifs. Tout cela n’était pas facile : le bateau se dégradait, les captifs suffoquaient dans ses flancs surchauffés, les marins étaient emportés par les fièvres, des expéditions pouvaient languir des mois durant et il fallait alors s’inquiéter de la traversée future…"
1751 : Selon Michon, depuis 1748, en 3 ans, les Français ont armé 199 expéditions négrières !
97 pour Nantes, 31 pour La Rochelle, 23 pour Bordeaux, 22 St Malo, 9 Le Havre, 5 Lorient, 4 pour Bayonne et Dunkerque, 3 Vannes et 1 pour Honfleur...
1752 : Recensement de Marie Galante : 3.881 esclaves, dont 3.267 paiants droits, 501 négrillons ou négrites, 113 nègres ou nègresses infirmes ou suragés.
La traite au comptoir imposait une file d’attente, la présence agacée de rivaux étrangers (souvent Anglais), un accueil hostile des chefs locaux, une pénurie de captifs, ou des prix extravagants.
La traite itinérante n’était pas la méthode la plus simple. Elle consistait à descendre le long de la côte, à mouiller dans les rades foraines quand il s’en présentait, ou à s’ancrer à l’entrée des rivières qui s’insinuaient à l’intérieur des terres. A chaque fois, on devait disposer de la chaloupe, franchir la barre qui déferle dangereusement le long du rivage, prendre langue avec les autorités locales, leur offrir des présents, et s’entendre avec eux sur les délais de livraison, le nombre et le prix des captifs. Tout cela n’était pas facile : le bateau se dégradait, les captifs suffoquaient dans ses flancs surchauffés, les marins étaient emportés par les fièvres, des expéditions pouvaient languir des mois durant et il fallait alors s’inquiéter de la traversée future…"
1751 : Selon Michon, depuis 1748, en 3 ans, les Français ont armé 199 expéditions négrières !
97 pour Nantes, 31 pour La Rochelle, 23 pour Bordeaux, 22 St Malo, 9 Le Havre, 5 Lorient, 4 pour Bayonne et Dunkerque, 3 Vannes et 1 pour Honfleur...
1752 : Recensement de Marie Galante : 3.881 esclaves, dont 3.267 paiants droits, 501 négrillons ou négrites, 113 nègres ou nègresses infirmes ou suragés.
1753 : En Martinique, le gouverneur général de Bompar et l’intendant général Hurson envoie le 20 février un " Mémoire sur la disette des nègres ", constatant l’absence d’arrivée de négriers depuis près d’un an…
1754 : Le cartographe Jean Nicolas Bellin, à qui nous devrons 10 ans plus tard les cartes de la Guadeloupe et de Marie Galante, nous fourni une carte d'Afrique correspondant aux zones de traite, leurs ports et leurs forts :
1754 : Le cartographe Jean Nicolas Bellin, à qui nous devrons 10 ans plus tard les cartes de la Guadeloupe et de Marie Galante, nous fourni une carte d'Afrique correspondant aux zones de traite, leurs ports et leurs forts :
1756 : Depuis 1751, les négriers nantais ont armé 143 navires, mais seulement 104 sont arrivés à bon port, l'année 1755 a été une année noire avec 8 navires sur 22 arrivés à destination entre les corsaires anglais, les naufrages et les révoltes de Noirs...
Sur ces 104, 24 sont arrivés en Martinique, 75 à St Domingue, 3 à Grenade, 1 à Cayenne et 2 en Guadeloupe, dont l'un Le Princesse "venant de la Coste de Guinée ayant manqué sa traite" arrive sans esclaves...
En 1756, les négriers nantais perdent le seul navire armé sur la côte africaine et en 1757 ils n'enverront qu'un navire à Cayenne.
Toujours depuis 1751, les négriers bordelais n'ont armé que 28 navires, 14 semblent arrivés à bon port dont 7 pour St Domingue et 4 pour la Martinique, les 2 derniers de 1755 ont été capturés par les Anglais...
La traite va s'arrêter du fait de la guerre pendant 5 ans, elle ne reprendra qu'en 1763 avec le retour de la paix...
1758 : Les Anglais s’emparent de Gorée et de St Louis du Sénégal, 2 de nos principaux comptoirs négriers.
La traite va devoir se déplacer plus au sud de la côte africaine pendant les 21 années d'occupation...
1759 : La Guadeloupe et Marie Galante sont occupées par les Anglais.
Aucun négrier ne pourra atteindre la Martinique cette année, pour la Guadeloupe et Marie-Galante, il faudrait disposer des archives anglaises…Il semble que les négriers de Bristol et de Liverpool auraient livré 18.000 esclaves en 3 ans d'occupation !
1763 : Fin de la Guerre de Sept Ans après le Traité de Versailles du 10 février.
La traite reprend : dès cette année, les Nantais arment 32 négriers, les Bordelais 3...
1764 : Depuis la reprise de la traite l'année précédente, les négriers nantais ont armé 60 navires dont 50 sont arrivés à destination: 33 pour St Domingue, 9 pour le Martinique, 3 pour Cayenne mais surtout, du fait de sa toute nouvelle indépendance vis à vis de la Martinique, la Guadeloupe a reçu 5 négriers en direct en 1 an.
Manque de chance, sur ces 5, l'Amphitrite n'a apporté que 114 nègres sur les 280 du départ, la cargaison a été décimée par la petite vérole (variole)...
Quant aux négriers bordelais, ils ont armé 11 navires, dont 10 sont arrivés à destination, tous à St Domingue...
1765 : Pour beaucoup à l’époque, la traite est une entreprise qui dispense le bonheur et le négrier est un homme de bien : arrivés aux colonies, les Noirs " se voient ressusciter parmi leurs semblables, qui sont pour eux des êtres merveilleux, dont ils envient le sort " écrit le capitaine négrier Button.
Le théologien Bellon de Saint Quentin rajoute : " le plus grand malheur qu’on puisse faire à ces pauvres Africains serait la cessation de ce trafic " !…
Le Duc de Choiseul écrit : " Il faut observer que tous les nègres qui ont été transportés aux Colonies comme esclaves, que l’esclavage a imprimé une tâche ineffaçable sur toute leur postérité, même sur ceux qui se trouvent d’un sang-mêlé ; et que, par conséquent, ceux qui en descendent ne peuvent jamais entrer dans la classe des Blancs. Car s’il était un temps où ils pourraient être réputés blancs, ils jouiraient alors de tous les privilèges des Blancs et pourraient, comme eux, prétendre à toutes les places et dignités, ce qui serait absolument contraire à la constitution des colonies "...
Le Fermier Général Jean François de Laporte, proche de Choiseul, dont le père était l'un des directeurs de la Compagnie de Indes, a pris des notes sur la valeur des nègres, probablement à l'occasion d'un achat de 610 esclaves, de destination inconnue :
La 1ère classe, les nègres de 15 à 30 ans valent 1 pièce d'Inde, la seconde, vieux et malades 3/4 de pièce d'Inde, la troisième, 3 grands enfants au dessus de 1O ans valent 2 pièces, la 4ème; les enfants de 5 à 10 ans, 2 pour 1 pièce...
Sur ces 104, 24 sont arrivés en Martinique, 75 à St Domingue, 3 à Grenade, 1 à Cayenne et 2 en Guadeloupe, dont l'un Le Princesse "venant de la Coste de Guinée ayant manqué sa traite" arrive sans esclaves...
En 1756, les négriers nantais perdent le seul navire armé sur la côte africaine et en 1757 ils n'enverront qu'un navire à Cayenne.
Toujours depuis 1751, les négriers bordelais n'ont armé que 28 navires, 14 semblent arrivés à bon port dont 7 pour St Domingue et 4 pour la Martinique, les 2 derniers de 1755 ont été capturés par les Anglais...
La traite va s'arrêter du fait de la guerre pendant 5 ans, elle ne reprendra qu'en 1763 avec le retour de la paix...
1758 : Les Anglais s’emparent de Gorée et de St Louis du Sénégal, 2 de nos principaux comptoirs négriers.
La traite va devoir se déplacer plus au sud de la côte africaine pendant les 21 années d'occupation...
1759 : La Guadeloupe et Marie Galante sont occupées par les Anglais.
Aucun négrier ne pourra atteindre la Martinique cette année, pour la Guadeloupe et Marie-Galante, il faudrait disposer des archives anglaises…Il semble que les négriers de Bristol et de Liverpool auraient livré 18.000 esclaves en 3 ans d'occupation !
1763 : Fin de la Guerre de Sept Ans après le Traité de Versailles du 10 février.
La traite reprend : dès cette année, les Nantais arment 32 négriers, les Bordelais 3...
1764 : Depuis la reprise de la traite l'année précédente, les négriers nantais ont armé 60 navires dont 50 sont arrivés à destination: 33 pour St Domingue, 9 pour le Martinique, 3 pour Cayenne mais surtout, du fait de sa toute nouvelle indépendance vis à vis de la Martinique, la Guadeloupe a reçu 5 négriers en direct en 1 an.
Manque de chance, sur ces 5, l'Amphitrite n'a apporté que 114 nègres sur les 280 du départ, la cargaison a été décimée par la petite vérole (variole)...
Quant aux négriers bordelais, ils ont armé 11 navires, dont 10 sont arrivés à destination, tous à St Domingue...
1765 : Pour beaucoup à l’époque, la traite est une entreprise qui dispense le bonheur et le négrier est un homme de bien : arrivés aux colonies, les Noirs " se voient ressusciter parmi leurs semblables, qui sont pour eux des êtres merveilleux, dont ils envient le sort " écrit le capitaine négrier Button.
Le théologien Bellon de Saint Quentin rajoute : " le plus grand malheur qu’on puisse faire à ces pauvres Africains serait la cessation de ce trafic " !…
Le Duc de Choiseul écrit : " Il faut observer que tous les nègres qui ont été transportés aux Colonies comme esclaves, que l’esclavage a imprimé une tâche ineffaçable sur toute leur postérité, même sur ceux qui se trouvent d’un sang-mêlé ; et que, par conséquent, ceux qui en descendent ne peuvent jamais entrer dans la classe des Blancs. Car s’il était un temps où ils pourraient être réputés blancs, ils jouiraient alors de tous les privilèges des Blancs et pourraient, comme eux, prétendre à toutes les places et dignités, ce qui serait absolument contraire à la constitution des colonies "...
Le Fermier Général Jean François de Laporte, proche de Choiseul, dont le père était l'un des directeurs de la Compagnie de Indes, a pris des notes sur la valeur des nègres, probablement à l'occasion d'un achat de 610 esclaves, de destination inconnue :
La 1ère classe, les nègres de 15 à 30 ans valent 1 pièce d'Inde, la seconde, vieux et malades 3/4 de pièce d'Inde, la troisième, 3 grands enfants au dessus de 1O ans valent 2 pièces, la 4ème; les enfants de 5 à 10 ans, 2 pour 1 pièce...
Un Mémoire des négociants de La Rochelle précise les dépenses de "mise-hors" d'un négrier avitaillé et armé pour le transport de 300 nègres : 242.000 livres dont 50.000 pour l'achat du navire, 42.500 pour l'avitaillement, 144.000 pour la cargaison dont 100.000 fournies par la Compagnie de Indes...
1766 : Le duc de Praslin remplace son cousin le duc de Choiseul à la Marine.
A Cabinda, sur la Coste d'Angole, l'achat d'un nègre ou pièce d'Inde se fait en troc : pour 9 pièces d'Inde, il faut 1 fusil, 2 barils de poudre, 2 guinées (cotonnades de couleur) et pour 1 seule pièce, il faut 5 canettes (bouteilles en grés) et 24 couteaux...
1767 : Arrêt du Conseil du Roi le 31 juillet concernant le commerce des esclaves sur la côte de Guinée et au Sénégal : le Roi percevra désormais les 10 livres par tête de nègre à la place de la Compagnie des Indes et se chargera en contrepartie de l’entretien des forts et comptoirs. La Compagnie a perdu son exclusif...
Création à Paris de l"Association pour la Traite des Nègres, le Commerce de l'Amérique et la Pêche"; ils écrivent : " si la traite des nègres et le commerce ordinaire de l'Amérique sont tombés dans un état de langueur et de discrédit, c'est qu'on n'a point encore trouvé les moyens de s'attirer et affermir la confiance des coopérateurs à ces entreprises"...
Bordeaux a envoyé 7 négriers, dont la capacité augmente : le Glaneur est prévu pour 620 esclaves...
1768 : Arrêt du Conseil du Roi avec exemption du droit de 10 livres par tête de nègre introduit aux colonies par les négriers de Bordeaux, après ceux de Saint-Malo, Le Havre, Honfleur :
1766 : Le duc de Praslin remplace son cousin le duc de Choiseul à la Marine.
A Cabinda, sur la Coste d'Angole, l'achat d'un nègre ou pièce d'Inde se fait en troc : pour 9 pièces d'Inde, il faut 1 fusil, 2 barils de poudre, 2 guinées (cotonnades de couleur) et pour 1 seule pièce, il faut 5 canettes (bouteilles en grés) et 24 couteaux...
1767 : Arrêt du Conseil du Roi le 31 juillet concernant le commerce des esclaves sur la côte de Guinée et au Sénégal : le Roi percevra désormais les 10 livres par tête de nègre à la place de la Compagnie des Indes et se chargera en contrepartie de l’entretien des forts et comptoirs. La Compagnie a perdu son exclusif...
Création à Paris de l"Association pour la Traite des Nègres, le Commerce de l'Amérique et la Pêche"; ils écrivent : " si la traite des nègres et le commerce ordinaire de l'Amérique sont tombés dans un état de langueur et de discrédit, c'est qu'on n'a point encore trouvé les moyens de s'attirer et affermir la confiance des coopérateurs à ces entreprises"...
Bordeaux a envoyé 7 négriers, dont la capacité augmente : le Glaneur est prévu pour 620 esclaves...
1768 : Arrêt du Conseil du Roi avec exemption du droit de 10 livres par tête de nègre introduit aux colonies par les négriers de Bordeaux, après ceux de Saint-Malo, Le Havre, Honfleur :
" Le Roi étant informé que les négociants du port de Bordeaux se livrent avec beaucoup de zèle au commerce de la Traite des Nègres, qu'il résulte des états qui lui ont été présentés que, depuis le 30 avril 1767 jusqu'au 30 octobre de la même année, ils ont armé sept navires pour la côte de Guinée, qu'ils en ont actuellement six autres en armement pour le même objet ; et que si la traite était favorable, ils pourraient introduire 5.190 nègres aux colonies : ils jouiront de l'exemption du droit de dix livres par tête "
1769 : Victime des défaites de la guerre de Sept Ans, la 2ème Compagnie des Indes dite Perpétuelle est suspendue le 13 août :
" L’exercice du privilège exclusif de la Compagnie des Indes aux îles de France et de Bourbon, aux Indes, à la Chine et dans les mers au-delà du cap de Bonne-Espérance, sera et demeurera suspendu jusqu’à ce qu’il en soit par S.M. autrement décidé "
Les armateurs privées vont pouvoir prendre la relève : dés la première année, la Compagnie des Indes perd 2610 tonneaux de transport de marchandises sur un total de 7930 tonneaux...
Depuis 1765, les négriers nantais ont armé 126 navires dont 116 sont arrivés à bon port, les pertes diminuent...
90 ont approvisionné St Domingue, la plus grande des îles à sucre, la Martinique en a reçu 11, la Guadeloupe 6 mais plus aucun depuis qu'elle est devenue à nouveau dépendante de la Martinique l'an dernier...
Pendant la même période, les négriers bordelais ont armé 37 navires, 1 seul naufragé, 36 sont arrivés à bon port dont 1 pour Cayenne, 1 pour la Martinique, 3 pour la Guadeloupe, les 31 restants tous pour St Domingue, qui concentre ainsi 80% de la traite des 2 ports !
" L’exercice du privilège exclusif de la Compagnie des Indes aux îles de France et de Bourbon, aux Indes, à la Chine et dans les mers au-delà du cap de Bonne-Espérance, sera et demeurera suspendu jusqu’à ce qu’il en soit par S.M. autrement décidé "
Les armateurs privées vont pouvoir prendre la relève : dés la première année, la Compagnie des Indes perd 2610 tonneaux de transport de marchandises sur un total de 7930 tonneaux...
Depuis 1765, les négriers nantais ont armé 126 navires dont 116 sont arrivés à bon port, les pertes diminuent...
90 ont approvisionné St Domingue, la plus grande des îles à sucre, la Martinique en a reçu 11, la Guadeloupe 6 mais plus aucun depuis qu'elle est devenue à nouveau dépendante de la Martinique l'an dernier...
Pendant la même période, les négriers bordelais ont armé 37 navires, 1 seul naufragé, 36 sont arrivés à bon port dont 1 pour Cayenne, 1 pour la Martinique, 3 pour la Guadeloupe, les 31 restants tous pour St Domingue, qui concentre ainsi 80% de la traite des 2 ports !
1770 : Par Arrêté du 17 février, la Compagnie des Indes céde au Roi ses immeubles, meubles - en particulier ses navires - et ses droits.
Choiseul fait racheter 4 de ses vaisseaux et plusieurs de ses frégates que la Marine intègre dans ses rangs.
La Compagnie effectuera ses dernières activités de transport en 1771...
La Marine récupère aussi ses installations de Lorient qui s'additionnent aux trois arsenaux dont elle dispose déjà à Brest, Rochefort et Toulon.
Les bois, les agrès et les munitions étant hors de prix en temps de guerre, on constitue des stocks gigantesques.
A Marie Galante, Paul Botreau Roussel, vient d’acheter une partie de l’habitation sucrerie Saint Louis "sans nègre" : il demande une dérogation au gouverneur pour introduire 100 nègres étrangers, car il " ne vient point de négriers aux Isles du Vent ".
Choiseul fait racheter 4 de ses vaisseaux et plusieurs de ses frégates que la Marine intègre dans ses rangs.
La Compagnie effectuera ses dernières activités de transport en 1771...
La Marine récupère aussi ses installations de Lorient qui s'additionnent aux trois arsenaux dont elle dispose déjà à Brest, Rochefort et Toulon.
Les bois, les agrès et les munitions étant hors de prix en temps de guerre, on constitue des stocks gigantesques.
A Marie Galante, Paul Botreau Roussel, vient d’acheter une partie de l’habitation sucrerie Saint Louis "sans nègre" : il demande une dérogation au gouverneur pour introduire 100 nègres étrangers, car il " ne vient point de négriers aux Isles du Vent ".
1771 : Pierre Étienne Bourgeois de Boynes devient secrétaire d'Etat à la Marine.
1772 : L’Académie de Bordeaux propose au concours le thème suivant : " Quels sont les meilleurs moyens pour préserver les nègres qu’on transporte de l’Afrique dans les colonies, des maladies fréquentes et si souvent funestes qu’ils éprouvent dans ce trajet ? "
1774 : Le comte Gabriel de Sartine devient secrétaire d'Etat à la Marine.
Il décide d'encourager "les navigateurs français qui découvriraient quelques lieux propres à la traite des noirs, dans le grand espace qui sépare les possessions portugaises du Cap de Bonne-Espérance"
L’esclavage est en pleine expansion : 51 expéditions négrières vont partir des ports français dont 19 de Nantes.
En 10 ans, rien que pour les négriers nantais, 208 navires sont arrivés à bon port sur les 225 qui ont été armés pour la traite : 12 à la Martinique, 11 à la Guadeloupe et 169 à St Domingue !
" C’est le plein essor du Commerce triangulaire, aussi appelé Traite occidentale, traite négrière menée au moyen d'échanges entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques, pour assurer la distribution d'esclaves noirs aux colonies du Nouveau Monde, pour approvisionner l'Europe en produits de ces colonies et pour fournir à l'Afrique des produits européens et américains"
" Le tonnage moyen des négriers nantais était compris entre 140 et 300 tonneaux. Le navire devait être polyvalent, c'est-à-dire capable de contenir des marchandises comme des captifs. Les navires les plus utilisés étaient des flûtes, des trois mâts, des bricks et surtout des senaux (2 mâts, le second plus haut que le premier) ne dépassant pas 30 mètres hors tout avec 7 ou 8 mètres de large, dont 3 ou 4 mètres de cale.
Le volume de la cale devait être très important pour l'eau et les vivres : en supposant qu'il faille 2,8 litres d'eau par personne et par jour, pour 45 marins et 600 captifs, sur un voyage de deux mois et demi, les besoins en eau se montaient à 140.000 litres d'eau et il fallait compter 40 kilos de vivres par personne.
1772 : L’Académie de Bordeaux propose au concours le thème suivant : " Quels sont les meilleurs moyens pour préserver les nègres qu’on transporte de l’Afrique dans les colonies, des maladies fréquentes et si souvent funestes qu’ils éprouvent dans ce trajet ? "
1774 : Le comte Gabriel de Sartine devient secrétaire d'Etat à la Marine.
Il décide d'encourager "les navigateurs français qui découvriraient quelques lieux propres à la traite des noirs, dans le grand espace qui sépare les possessions portugaises du Cap de Bonne-Espérance"
L’esclavage est en pleine expansion : 51 expéditions négrières vont partir des ports français dont 19 de Nantes.
En 10 ans, rien que pour les négriers nantais, 208 navires sont arrivés à bon port sur les 225 qui ont été armés pour la traite : 12 à la Martinique, 11 à la Guadeloupe et 169 à St Domingue !
" C’est le plein essor du Commerce triangulaire, aussi appelé Traite occidentale, traite négrière menée au moyen d'échanges entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques, pour assurer la distribution d'esclaves noirs aux colonies du Nouveau Monde, pour approvisionner l'Europe en produits de ces colonies et pour fournir à l'Afrique des produits européens et américains"
" Le tonnage moyen des négriers nantais était compris entre 140 et 300 tonneaux. Le navire devait être polyvalent, c'est-à-dire capable de contenir des marchandises comme des captifs. Les navires les plus utilisés étaient des flûtes, des trois mâts, des bricks et surtout des senaux (2 mâts, le second plus haut que le premier) ne dépassant pas 30 mètres hors tout avec 7 ou 8 mètres de large, dont 3 ou 4 mètres de cale.
Le volume de la cale devait être très important pour l'eau et les vivres : en supposant qu'il faille 2,8 litres d'eau par personne et par jour, pour 45 marins et 600 captifs, sur un voyage de deux mois et demi, les besoins en eau se montaient à 140.000 litres d'eau et il fallait compter 40 kilos de vivres par personne.
La Marie Séraphique, négrier nantais qui a réalisé 4 expéditions de 1769 à 1775, déportant au total 1344 noirs, soit 336 en moyenne par voyage
La hauteur de l'entrepont devait être comprise entre 1m40 et 1m70. L'entrepont servait de parcs à esclaves et avec cette hauteur, les négriers augmentaient la surface disponible en installant des plates-formes à mi-hauteur sur les côtés. La ventilation n’était assurée que par les écoutilles et les manches à air."
" L'embarquement des captifs se faisait par petits groupes de quatre à six personnes. Dès qu'ils étaient à bord, les hommes étaient séparés des femmes et des enfants. Ils étaient enchaînés deux à deux par les chevilles et ceux qui résistaient étaient entravés aux poignets. Dans certains navires, la place était si réduite qu’ils ne pouvaient que rester couchés sur le côté, imbriqués les uns contre les autres "...
" La durée moyenne de la traversée - le Passage du Milieu - était de 66 jours. Mais selon les points de départ et d'arrivée, la durée pouvait être très différente.
Ainsi les Hollandais mettaient 71 à 81 jours pour rejoindre les Antilles"
" La mortalité des déportés lors de la traversée serait comprise entre 11,9 % et 13,25 %. Dans le cas des expéditions négrières nantaises, le taux de mortalité des déportés avoisinait 13,6 %."
" Sur 3.341 expéditions négrières françaises recensées au XVIIIème siècle, on retrouve 155 révoltes de noirs, dont 75 réussies avec évasion"…
Pierre Samuel du Pont de Nemours, économiste et futur conseiller d’Etat de Louis XVI, étudie les coûts de l’esclavage :
Aux Antilles Françaises, il estime qu’un esclave coûte 420 livres par an à son maître, entre l’amortissement de l’achat, la nourriture et l’entretien.
Dans cette somme, il inclut 38 livres de marronnage "moyen" par an…
1777 : Le 9 aôut," Déclaration du Roi pour la police des Noirs " : " Faisons défense expresse à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, même à tous étrangers, d’amener dans notre royaume, après la publication et enregistrement de notre présente Déclaration, aucun noir, mulâtre, ou autres gens de couleur, de l’un et de l’autre sexe, et de les y retenir à leur service ; le tout à peine de trois mille livres d’amende, même de plus grande peine s’il y échoit. Défendons pareillement, sous les mêmes peines, à tous noirs, mulâtres qui ne seraient point en service, d’entrer à l’avenir dans notre royaume, sous quelque cause et prétexte que ce soit "...
La hauteur de l'entrepont devait être comprise entre 1m40 et 1m70. L'entrepont servait de parcs à esclaves et avec cette hauteur, les négriers augmentaient la surface disponible en installant des plates-formes à mi-hauteur sur les côtés. La ventilation n’était assurée que par les écoutilles et les manches à air."
" L'embarquement des captifs se faisait par petits groupes de quatre à six personnes. Dès qu'ils étaient à bord, les hommes étaient séparés des femmes et des enfants. Ils étaient enchaînés deux à deux par les chevilles et ceux qui résistaient étaient entravés aux poignets. Dans certains navires, la place était si réduite qu’ils ne pouvaient que rester couchés sur le côté, imbriqués les uns contre les autres "...
" La durée moyenne de la traversée - le Passage du Milieu - était de 66 jours. Mais selon les points de départ et d'arrivée, la durée pouvait être très différente.
Ainsi les Hollandais mettaient 71 à 81 jours pour rejoindre les Antilles"
" La mortalité des déportés lors de la traversée serait comprise entre 11,9 % et 13,25 %. Dans le cas des expéditions négrières nantaises, le taux de mortalité des déportés avoisinait 13,6 %."
" Sur 3.341 expéditions négrières françaises recensées au XVIIIème siècle, on retrouve 155 révoltes de noirs, dont 75 réussies avec évasion"…
Pierre Samuel du Pont de Nemours, économiste et futur conseiller d’Etat de Louis XVI, étudie les coûts de l’esclavage :
Aux Antilles Françaises, il estime qu’un esclave coûte 420 livres par an à son maître, entre l’amortissement de l’achat, la nourriture et l’entretien.
Dans cette somme, il inclut 38 livres de marronnage "moyen" par an…
1777 : Le 9 aôut," Déclaration du Roi pour la police des Noirs " : " Faisons défense expresse à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, même à tous étrangers, d’amener dans notre royaume, après la publication et enregistrement de notre présente Déclaration, aucun noir, mulâtre, ou autres gens de couleur, de l’un et de l’autre sexe, et de les y retenir à leur service ; le tout à peine de trois mille livres d’amende, même de plus grande peine s’il y échoit. Défendons pareillement, sous les mêmes peines, à tous noirs, mulâtres qui ne seraient point en service, d’entrer à l’avenir dans notre royaume, sous quelque cause et prétexte que ce soit "...
La déclaration prévoit aussi que soit créé dans chaque port des " dépôts de Noirs " pour les loger pendant le séjour de leur maître en France, en attendant le réembarquement…Cette décision engendre quelques problèmes matériels et moraux comme le montre le questionnaire envoyé par le Ministre de la Marine aux responsables de chaque port.
Ce recensement à Bordeaux retrouve 208 esclaves et 94 Noirs libres.
La même année, François-Armand Cholet, procureur du Roi à l'Amirauté de Bordeaux, s'indignait des mauvaises conditions de détention des prisonniers :
" l’Amirauté de Bordeaux n’a d’autres prisons que celles du palais ; mais elles sont si affreuses que la seule idée d’y enfermer les Noirs révolte l’humanité. Les prisonniers y sont rongés de gale et de vermine ".
" La vente des esclaves aux Antilles est bien organisée : généralement, l’armateur avait pris contact avec une maison de Consignation installée à Fort-Royal ou Pointe-à-Pitre, et l’avait chargée de vendre les captifs, de conserve avec le capitaine ou son agent commercial à bord appelé le subrécargue."
Ce recensement à Bordeaux retrouve 208 esclaves et 94 Noirs libres.
La même année, François-Armand Cholet, procureur du Roi à l'Amirauté de Bordeaux, s'indignait des mauvaises conditions de détention des prisonniers :
" l’Amirauté de Bordeaux n’a d’autres prisons que celles du palais ; mais elles sont si affreuses que la seule idée d’y enfermer les Noirs révolte l’humanité. Les prisonniers y sont rongés de gale et de vermine ".
" La vente des esclaves aux Antilles est bien organisée : généralement, l’armateur avait pris contact avec une maison de Consignation installée à Fort-Royal ou Pointe-à-Pitre, et l’avait chargée de vendre les captifs, de conserve avec le capitaine ou son agent commercial à bord appelé le subrécargue."
" Il faut respecter 2 impératifs pour écouler la cargaison humaine dans des conditions satisfaisantes. D’abord, la rafraîchir pour redonner aux captifs épuisés une apparence extérieure de bon aloi, en les envoyant se requinquer à terre, en améliorant l’ordinaire de fruits et de légumes frais, ou en maquillant les invendables..."
1778 : En 10 ans, Bordeaux a armé 82 navires de traite.
Le 11 janvier, un " Arrêt du Conseil d’Etat du Roi concernant la Police des Noirs, Mulâtres ou autres gens de couleur qui sont dans la ville de Paris " complète l’Arrêt du 9 août dernier qui demandait l’expulsion vers le port le plus proche des noirs non enregistrés aux greffes de Amirautés. Il est demandé à ceux qui étaient enregistrés de se rendre à nouveau aux greffes pour obtenir un nouveau certificat…
1778 : En 10 ans, Bordeaux a armé 82 navires de traite.
Le 11 janvier, un " Arrêt du Conseil d’Etat du Roi concernant la Police des Noirs, Mulâtres ou autres gens de couleur qui sont dans la ville de Paris " complète l’Arrêt du 9 août dernier qui demandait l’expulsion vers le port le plus proche des noirs non enregistrés aux greffes de Amirautés. Il est demandé à ceux qui étaient enregistrés de se rendre à nouveau aux greffes pour obtenir un nouveau certificat…
Le 5 avril, " Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les Mariages des Noirs, Mulâtres ou autres Gens de Couleur " :
" Le Roi étant en son Conseil, a fait et fait défense à tous ses sujets Blancs de l’un et l’autre sexe, de contracter mariage avec les Noirs, Mulâtres ou autres gens de Couleur, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu, par telle loi qu’il appartiendra, sur l’état desdits Noirs, Mulâtres ou autres gens de Couleur de l’un ou l’autre sexe, qui étaient en France avant la déclaration du 9 août dernier ; fait défense à tout Notaire de passer aucun contrat de mariage entre eux, à peine d’amende "...
Le 1er mai, " Arrêt qui établit et fixe, pour la Guadeloupe et ses dépendances, un taux commun de remboursement du prix des esclaves suppliciés et tués en marronage " : 1.300 livres pour les nègres, 1.200 pour les négresses.
Ces sommes sont tirées de la " caisse des nègres justiciés ", alimentée par une taxe de 22 sols par esclave entre 14 et 59 ans.
Ce remboursement est bien en dessous du prix d’achat, aussi les propriétaires préfèrent parfois les vendre dans une autre île que de les livrer à la justice, et ce d’autant plus qu’ils doivent payer le " geolage " avant le jugement…
1779 : Les Français reprennent leurs comptoirs au Sénégal, dont Gorée et St Louis, ainsi que les autres du Cap Vert et de Gambie, ils deviennent la "Colonie du Sénégal et dépendances".
1781 : Recensement de Marie Galante : 299 libres de couleur, 8.764 esclaves dont 2.629 payant droits et 110 marrons...
Le 1er mai, " Arrêt qui établit et fixe, pour la Guadeloupe et ses dépendances, un taux commun de remboursement du prix des esclaves suppliciés et tués en marronage " : 1.300 livres pour les nègres, 1.200 pour les négresses.
Ces sommes sont tirées de la " caisse des nègres justiciés ", alimentée par une taxe de 22 sols par esclave entre 14 et 59 ans.
Ce remboursement est bien en dessous du prix d’achat, aussi les propriétaires préfèrent parfois les vendre dans une autre île que de les livrer à la justice, et ce d’autant plus qu’ils doivent payer le " geolage " avant le jugement…
1779 : Les Français reprennent leurs comptoirs au Sénégal, dont Gorée et St Louis, ainsi que les autres du Cap Vert et de Gambie, ils deviennent la "Colonie du Sénégal et dépendances".
1781 : Recensement de Marie Galante : 299 libres de couleur, 8.764 esclaves dont 2.629 payant droits et 110 marrons...
1783 : Par le Traité de Versailles, le Sénégal appartient désormais à la France.
Du fait de la "disette de nègres" et pour freiner la contrebande, un Arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin donne "permission aux Bâtimens étrangers, du port de cent ving tonneaux et au-dessus, arrivant directement des côtes d'Afrique, chacun avec une cargaison de cent quatre-vingts Noirs au moins, d'aborder dans le port principal des Isles de la Martinique, de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie et de Tobago, jusqu'au premier Août 1786, et d'y vendre les dits Noirs, en payant par chaque tête de Negres, Negresses, Négrillons et Négrittes, un droit de cent livres, argent de France, dont le produit seroit employé en Primes, au profit des Armateurs François, qui importeroient, pendant le même temps, dans les dites Isles du Vent, des Negres provenans de leur commerce en Afrique"
Du fait de la "disette de nègres" et pour freiner la contrebande, un Arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin donne "permission aux Bâtimens étrangers, du port de cent ving tonneaux et au-dessus, arrivant directement des côtes d'Afrique, chacun avec une cargaison de cent quatre-vingts Noirs au moins, d'aborder dans le port principal des Isles de la Martinique, de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie et de Tobago, jusqu'au premier Août 1786, et d'y vendre les dits Noirs, en payant par chaque tête de Negres, Negresses, Négrillons et Négrittes, un droit de cent livres, argent de France, dont le produit seroit employé en Primes, au profit des Armateurs François, qui importeroient, pendant le même temps, dans les dites Isles du Vent, des Negres provenans de leur commerce en Afrique"
1784 : Le 6 avril, un Mémoire de la Chambre de Commerce de Nantes précise : "La traite des Noirs est la base de toute notre navigation : c'est elle qui fournit des bras pour la culture de nos isles, qui nous procure en retour une masse incroyable de denrées en marchandises, telles que le sucre, le café, le coton et l'indigo, tant pour la consommation du royaume que pour en faire commerce avec les étrangers"...
Le 30 aôut, "Arrêt du Conseil d'Etat concernant le Commerce étranger dans les Isles Françoises de l'Amérique" :
" Sa Majesté ... a reconnu qu’il avoit été nécessaire de tempérer successivement la rigueur primitive des Lettres patentes du mois d’octobre 1727, dont les dispositions écartent absolument l’Étranger du Commerce de ses Colonies ; & que pour maintenir dans un juste équilibre des intérêts qui doivent se favoriſer mutuellement, il avoit fallu en différens temps apporter les modifications à la sévérité des Règlemens prohibitifs. Considérant que les circonstances actuelles sollicitent de nouveaux adoucissemens, Elle a jugé qu’en les accordant, il convenoit encore de multiplier les Ports d’entrepôt dans les Isles Françoises du Vent & Sous le Vent, d’en rectifier le choix, & de les ouvrir dans des lieux où ils fussent sous la main du Gouvernement & sous l’inſpection du Commerce national, afin de prévenir l’abus d’une contrebande destructive, ou de le réprimer avec d’autant plus de sévérité, que Sa Majesté ayant pourvu aux besoins de ses Colonies, les infracteurs de ses loix en deviendroient plus inexcusables...
Article I : L’entrepôt ci-devant assigné au carénage de Sainte-Lucie, sera maintenu pour ladite Isle seulement, & il en sera établi trois nouveaux aux Isles du Vent ; savoir, un à Saint-Pierre pour la Martinique, un à la Pointe-à-Pitre pour la Guadeloupe & dépendances, un à Scarboroug pour Tabago...
Article XV : Veut Sa Majesté, toujours sous les mêmes peines, que les Bâtimens étrangers auxquels il a été permis pour un temps déterminé, d’introduire aux Isles du Vent seulement, des cargaisons de Noirs, dans les différens Ports d’Amirauté desdites Isles, ne puissent plus dorénavant les introduire pendant ledit temps, que dans les ports du Carénage, de Saint-Pierre, de la Pointe à Pitre & de Scarboroug uniquement ; dérogeant, quant à ce, à l’arrêt de son Conseil du 28 juin 1783, lequel au surplus continuera d’être exécuté selon sa forme & teneur. "
Un nouvel Arrêt du Conseil d'Etat du Roi le 26 octobre " convertit en gratifications & primes l'exemption du demi-droit accordée aux denrées coloniales provenant de la Traite des Noirs ": " A compter du 10 novembre prochain, il sera accordé aux Armateurs pour chaque tonneau de continence des Navires employés à la traite des Nègres, une gratification de quarante livres qui tiendra lieu de l'exemption de la moitié des droits, qui avoit été accordée par l'article V des Lettres patentes du mois de janvier 1716, qui fera payée à l'Armateur toutes les fois que son Navire sera expédié pour la traite, a condition qu'il transportera à l'une des Colonies françoises les Nègres qui proviendront de ladite traite"
" indépendamment le la gratification, il fera accordé aux Armateurs une prime additionnelle par tête de Nègres qu'ils transporteront aux Isles du vent...laquelle prime additionnelle Sa Majesté a fixée à soixante livres argent de France pour les Nègres qui Seront transportés aux Isles de le la Guadeloupe et de la Martinique..."
Cette subvention de 40 livres par tonneau pour l’armement des négriers va entrainer à une course au tonnage réel pour certains armateurs.
Mais surtout, en revoyant le mode de calcul, sans tenir compte du port réel, certains navires inchangés voient leur tonnage largement augmenté, voire doublé lors de la soumission officielle...
Nantes arme 35 navires négriers, d’un tonnage moyen de 202 tonneaux. Bordeaux arme 22 négriers, de tonnage moyen 271.
Article I : L’entrepôt ci-devant assigné au carénage de Sainte-Lucie, sera maintenu pour ladite Isle seulement, & il en sera établi trois nouveaux aux Isles du Vent ; savoir, un à Saint-Pierre pour la Martinique, un à la Pointe-à-Pitre pour la Guadeloupe & dépendances, un à Scarboroug pour Tabago...
Article XV : Veut Sa Majesté, toujours sous les mêmes peines, que les Bâtimens étrangers auxquels il a été permis pour un temps déterminé, d’introduire aux Isles du Vent seulement, des cargaisons de Noirs, dans les différens Ports d’Amirauté desdites Isles, ne puissent plus dorénavant les introduire pendant ledit temps, que dans les ports du Carénage, de Saint-Pierre, de la Pointe à Pitre & de Scarboroug uniquement ; dérogeant, quant à ce, à l’arrêt de son Conseil du 28 juin 1783, lequel au surplus continuera d’être exécuté selon sa forme & teneur. "
Un nouvel Arrêt du Conseil d'Etat du Roi le 26 octobre " convertit en gratifications & primes l'exemption du demi-droit accordée aux denrées coloniales provenant de la Traite des Noirs ": " A compter du 10 novembre prochain, il sera accordé aux Armateurs pour chaque tonneau de continence des Navires employés à la traite des Nègres, une gratification de quarante livres qui tiendra lieu de l'exemption de la moitié des droits, qui avoit été accordée par l'article V des Lettres patentes du mois de janvier 1716, qui fera payée à l'Armateur toutes les fois que son Navire sera expédié pour la traite, a condition qu'il transportera à l'une des Colonies françoises les Nègres qui proviendront de ladite traite"
" indépendamment le la gratification, il fera accordé aux Armateurs une prime additionnelle par tête de Nègres qu'ils transporteront aux Isles du vent...laquelle prime additionnelle Sa Majesté a fixée à soixante livres argent de France pour les Nègres qui Seront transportés aux Isles de le la Guadeloupe et de la Martinique..."
Cette subvention de 40 livres par tonneau pour l’armement des négriers va entrainer à une course au tonnage réel pour certains armateurs.
Mais surtout, en revoyant le mode de calcul, sans tenir compte du port réel, certains navires inchangés voient leur tonnage largement augmenté, voire doublé lors de la soumission officielle...
Nantes arme 35 navires négriers, d’un tonnage moyen de 202 tonneaux. Bordeaux arme 22 négriers, de tonnage moyen 271.
1785 : Nantes arme 34 navires négriers, d’un tonnage moyen de 296 tonneaux.
Charles-Alexandre de Calonne, contrôleur général des finances du royaume, crée une dernière Compagnie des Indes qui n'obtient pas de pouvoir civil et militaire dans ses comptoirs, ni ne dispose du port de Lorient, confié à la Marine royale. Elle durera jusqu'à la Révolution...
A Marie Galante, le Sieur Bourjac, directeur du Domaine du Roi et propriétaire de l’habitation Grande Savane, écrit au Duc de Castries, ministre de la Marine un " Mémoire pour l’introduction de 100 nègres nouveaux en franchise de Droits d’entrée sur son habitation "
Il " possède une sucrerie où il a établi une guildiverie. Ces deux établissements naissants ne peuvent être portés à leur valeur faute d’esclaves pour la culture. Il ne peut même remplacer ceux qu’il a perdus, par la disette des Noirs dans la Colonie…Les Négriers françois attirés à St Domingue par le haut prix des Noirs n’en portent plus aux Isles du Vent, où les étrangers également rebutés par celui du droit d’Entrée…"
Il obtiendra du ministère sa dispense de droits, comme " encouragements accordés au Commerce National "…
1786 : La traite européenne aura déporté cette année 74.000 esclaves Africains, dont 38.000 pour les Anglais,
20.000 pour les Français, 10.000 pour les Portugais, 4.000 pour les Hollandais et 2.000 pour les Danois.
En France, Nantes arme 38 navires négriers, d’un tonnage moyen de 338 tonneaux. Bordeaux se rapproche avec 29 négriers...
Une ordonnance est censée stimuler la traite française, avec une prime de 60 livres par tête de nègre.
En Afrique, la traite au fort St Louis de Juda semble difficile selon le mémoire du négrier rochellais Paul Hardy :
" Je parle de Juda, où vous le savez Messieurs, depuis que cette compagnie jouit du dit fort, aucun de vos navires n’a pu s’y fixer sans être écrasés par ceux mêmes de qui ils auraient dû recevoir protection et secours, ils ont été trompés, joués, persiflés même "...
Le responsable semble être le directeur du fort lui-même, un certain Gourg, qui trafique et rançonne...
Dans le royaume d'Ardres, la traite est perturbée par les attaques du Dahomey voisin :
" Des gens du roi du Dahomey ayant fondu, à notre insu sur le bord de la mer de notre praie de Porto-Novo, ou ils ont commis des hostilités, en pillant et brûlant les baraques, dont ils ont enlevé toutes sortes de marchandises diverses, et notamment quatorze Blancs, tant officiers que matelots, ainsi que soixante-neuf canotiers ou piroguiers de Chama et de la Mine, et trente-huit captifs enlevés, le tout appartenant à Messieurs les capitaines français en traite dans notre ville d’Ardres "
A Bony dans le delta du Niger, une négresse Ibo pouvait valoir à " 65 barres soit 7 pièces de tissus, 3 fusils, 5 barils de poudre, 5 barres de fer, 8 chapeaux et bonnets, des perles, 4 cadenas et 2 couteaux ".
La description d'un navire négrier anglais le " Brooks" schématise bien la manière dont on y entasse les esclaves...
Il obtiendra du ministère sa dispense de droits, comme " encouragements accordés au Commerce National "…
1786 : La traite européenne aura déporté cette année 74.000 esclaves Africains, dont 38.000 pour les Anglais,
20.000 pour les Français, 10.000 pour les Portugais, 4.000 pour les Hollandais et 2.000 pour les Danois.
En France, Nantes arme 38 navires négriers, d’un tonnage moyen de 338 tonneaux. Bordeaux se rapproche avec 29 négriers...
Une ordonnance est censée stimuler la traite française, avec une prime de 60 livres par tête de nègre.
En Afrique, la traite au fort St Louis de Juda semble difficile selon le mémoire du négrier rochellais Paul Hardy :
" Je parle de Juda, où vous le savez Messieurs, depuis que cette compagnie jouit du dit fort, aucun de vos navires n’a pu s’y fixer sans être écrasés par ceux mêmes de qui ils auraient dû recevoir protection et secours, ils ont été trompés, joués, persiflés même "...
Le responsable semble être le directeur du fort lui-même, un certain Gourg, qui trafique et rançonne...
Dans le royaume d'Ardres, la traite est perturbée par les attaques du Dahomey voisin :
" Des gens du roi du Dahomey ayant fondu, à notre insu sur le bord de la mer de notre praie de Porto-Novo, ou ils ont commis des hostilités, en pillant et brûlant les baraques, dont ils ont enlevé toutes sortes de marchandises diverses, et notamment quatorze Blancs, tant officiers que matelots, ainsi que soixante-neuf canotiers ou piroguiers de Chama et de la Mine, et trente-huit captifs enlevés, le tout appartenant à Messieurs les capitaines français en traite dans notre ville d’Ardres "
A Bony dans le delta du Niger, une négresse Ibo pouvait valoir à " 65 barres soit 7 pièces de tissus, 3 fusils, 5 barils de poudre, 5 barres de fer, 8 chapeaux et bonnets, des perles, 4 cadenas et 2 couteaux ".
La description d'un navire négrier anglais le " Brooks" schématise bien la manière dont on y entasse les esclaves...
" La vente des esclaves aux Antilles est bien organisée : généralement, l’armateur avait pris contact avec une maison de Consignation installée à Fort-Royal ou Pointe-à-Pitre, et l’avait chargée de vendre les captifs, de conserve avec le capitaine ou son agent commercial à bord appelé le subrécargue.
Il faut respecter 2 impératifs pour écouler la cargaison humaine dans des conditions satisfaisantes.
D’abord, la "rafraîchir" pour redonner aux captifs épuisés une apparence extérieure de bon aloi, en les envoyant se requinquer à terre, en améliorant l’ordinaire de fruits et de légumes frais, voire en maquillant les invendables "...
Il faut respecter 2 impératifs pour écouler la cargaison humaine dans des conditions satisfaisantes.
D’abord, la "rafraîchir" pour redonner aux captifs épuisés une apparence extérieure de bon aloi, en les envoyant se requinquer à terre, en améliorant l’ordinaire de fruits et de légumes frais, voire en maquillant les invendables "...
" Ensuite, procéder à une vente rapide, publiquement affichée et annoncée dans les gazettes locales. Les prix des captifs dépendent de leur qualité intrinsèque, de leur âge et de leur sexe : un négrillon, une négresse, valent moins qu’un beau nègre qui représente une force de travail supérieure et immédiatement productive. Les prix varient aussi selon l’offre et la demande. Le marché est parfois saturé et les cours chutent. Le prix moyen est de 1.500 à 2.500 livres environ par individu (la livre coloniale, était supérieure d’un tiers à la livre de France)
Une fois arrivés chez leur maître, les esclaves sont répartis dans leurs cases.
Près de la maison du maître ou Grand Case se tiennent les cases des privilégiés, domestiques et nègres à talents (ouvriers qualifiés, sucriers, tonneliers, etc…) avec qui les nouveaux n’avaient rien à faire.
Près de la case du commandeur, qui dirige les esclaves, sont alignées les cases des nègres dits de culture ou de jardin qui constituent l’atelier et sont les plus nombreux. On y recense beaucoup de femmes et on y accueille les bossales, nouveaux arrivés d’Afrique."
Les cases-nègres sont maintenant souvent construites par des maçons et des charpentiers avec l’pparition des "kaz an bwa" relativement standard d’environ 3 m sur 6, hautes de 2 m 70, avec 2 pièces et cuisine extérieure.
Une Ordonnance Royale du 15 octobre, dans son article 2 demande " qu’il soit distribué à chaque nègre ou négresse une petite portion de l’habitation pour être par eux cultivée à leur profit, ainsi que bon leur semblera sans que les vivres recueillis dans ce jardin puissent entrer en compensation de ce qui est dû à chacun pour sa nourriture " : elle donne officiellement aux esclaves le samedi libre pour s’occuper de leur "jardin à nègre" : c’est l’avènement du " samedi jardin ".
Dans le même temps, elle limite les coups de fouet à 50 par punition…
Une fois arrivés chez leur maître, les esclaves sont répartis dans leurs cases.
Près de la maison du maître ou Grand Case se tiennent les cases des privilégiés, domestiques et nègres à talents (ouvriers qualifiés, sucriers, tonneliers, etc…) avec qui les nouveaux n’avaient rien à faire.
Près de la case du commandeur, qui dirige les esclaves, sont alignées les cases des nègres dits de culture ou de jardin qui constituent l’atelier et sont les plus nombreux. On y recense beaucoup de femmes et on y accueille les bossales, nouveaux arrivés d’Afrique."
Les cases-nègres sont maintenant souvent construites par des maçons et des charpentiers avec l’pparition des "kaz an bwa" relativement standard d’environ 3 m sur 6, hautes de 2 m 70, avec 2 pièces et cuisine extérieure.
Une Ordonnance Royale du 15 octobre, dans son article 2 demande " qu’il soit distribué à chaque nègre ou négresse une petite portion de l’habitation pour être par eux cultivée à leur profit, ainsi que bon leur semblera sans que les vivres recueillis dans ce jardin puissent entrer en compensation de ce qui est dû à chacun pour sa nourriture " : elle donne officiellement aux esclaves le samedi libre pour s’occuper de leur "jardin à nègre" : c’est l’avènement du " samedi jardin ".
Dans le même temps, elle limite les coups de fouet à 50 par punition…
1787 : En Angleterre, création de la Société pour l’Abolition de la Traite.
En France, cette année, 101 expéditions négrières vont partir au départ de 17 ports français : la Traite bat son plein…
1788 : En Afrique, les Européens disposent de 66 comptoirs ou forts destinés à la traite, depuis le Cap Blanc en Mauritanie jusqu’à St Paul de Loango en Angola : 40 Anglais, 15 Hollandais, 4 Danois, 4 Portugais et 3 Français au Sénégal, dont celui de Gorée.
Départ de "La Rosalie du Havre, capitaine Cassaudet, allant du dit lieu à la Côte d'Angolle"
En France, cette année, 101 expéditions négrières vont partir au départ de 17 ports français : la Traite bat son plein…
1788 : En Afrique, les Européens disposent de 66 comptoirs ou forts destinés à la traite, depuis le Cap Blanc en Mauritanie jusqu’à St Paul de Loango en Angola : 40 Anglais, 15 Hollandais, 4 Danois, 4 Portugais et 3 Français au Sénégal, dont celui de Gorée.
Départ de "La Rosalie du Havre, capitaine Cassaudet, allant du dit lieu à la Côte d'Angolle"
La traite reste une activité compliquée par les jeux de pouvoir locaux : le négrier rochelais Le Solide est en traite le 3 mars dans le village de Guemeul, à une demi-lieue de Badagri. Beaucoup de captifs sont déjà marchandés et tout se passe pour le mieux jusqu’au moment où " le roi d’Onis est venu avec une armée de deux mille pirogues avec vingt soldats dans chaque ".
L’Onis, vassal du Dahomey, est un petit royaume positionné entre ceux de Ouidah et d’Ardres. Pendant que le chef de Guemeul s’enfuit dans les bois, le village est entièrement pillé, puis brûlé, les assaillants récupérant toutes les marchandises européennes ainsi que 50 captifs. N’ayant plus de marchandises, il était impossible au Solide de continuer la traite.
Au final, sur les 400 Noirs escomptés, seuls 160 firent partie de la cargaison...
Les esclaves parviennent parfois à prendre le contrôle du navire de traite, telle la corvette l'Augustine, partie de Nantes le 20 juillet, sur laquelle les esclaves se révoltent le 26 décembre : " Les esclaves au nombre de 40 s’y sont emparés d’un coffre d’armes et ont attaqué 7 hommes de l’équipage qui étaient alors à bord, 2 sont massacrés, les 5 autres ont été blessés et jetés à la mer ; mais ils ont eu le bonheur de se sauver dans le canot, et se sont réfugiés à Mayombe où ce bateau était en traite. Le navire la Belle Ninette aussi de Nantes, est venu chercher l’équipage qu’il a amené avec le capitaine qui était à terre lors de l’événement. Les Noirs une fois maîtres du bateau ont levé l’ancre et ont appareillé "
La Chambre de commerce de La Rochelle envoie en fin d'année un Mémoire au secrétaire d'Etat à la Marine, le comte César de la Luzerne. Elle expose les conflits ayant cours sur la Côte des Esclaves, la collaboration du souverain d’Ardres, la nécessité de construire un fort, concluant que " la traite des nègres expose plus que jamais à la dépérition et à la perte des capitaux. Il serait urgent de rassurer ceux qui se livrent à cette hasardeuse spéculation "...
1789 : Bordeaux est en pleine expansion : 38 navires négriers.
Le député Bordelais Jean Béchade-Casaux, négociant et franc-maçon, écrit à ses collègues de la Chambre de Commerce de Guyennne: " Les États généraux sont encore occupés de la Déclaration des Droits de l'Homme qui doit servir d'introduction à la Constitution ; j'ai peur que cela ne conduise à la suppression de la traite des noirs, d'autant que toutes les têtes sont montées et que l'on regardera cette abolition comme le chef d'oeuvre de la saine philosophie"...
En Guadeloupe, le négrier bordelais Le Sans Pareil apporte le 19 mai 244 Noirs en provenance du Mozambique.
1790 : L’Assemblée Nationale décrète l'ouverture du commerce au-delà du cap de Bonne-Espérance à tous les Français ainsi que la liquidation de la dernière Compagnie...
1792 : La traite se ralentit avec l'arrivée de la République...
Nantes va encore armer 21 navires négriers, 7 seront pris par les Anglais avec lesquels nous sommes à nouveau en guerre, 1 fera naufrage et sur les 13 restants, 4 arriveront en Guadeloupe. Sa moyenne annuelle depuis 10 ans était de 29 négriers.
En utilisant le répertoire de Jean Mettas pour le XVIIIème siècle, depuis ses débuts, Nantes a armé 1.427 navires pour la traite, loin devant tous les autres ports...
La Rochelle aura été le 2ème port négrier avec 427 expéditions en 80 ans.
Le Havre est 3ème pour Mettas avec 398 navires de traite.
Bordeaux est à son apogée pour le XVIIIème, en 10 ans, 225 expéditions de traite, mais ayant commencé plus tardivement 393 depuis le début.
Mais selon les nouvelles estimations d'Eric Saugera, Bordeaux atteindrait 411 expéditions et serait donc 3ème...
St Malo prend la 5ème place avec 216, Lorient 6ème avec 156 suivi par Honfleur 125, Dunkerque 44, Rochefort 20, Bayonne 9, Brest 7
Du fait de la situation révolutionnaire à St Domingue, les négriers ont réorienté leurs cargaisons vers la Guadeloupe, 6.000 nègres sont ainsi introduits cette année dans l’archipel…
Parmi les derniers négriers arrivés en Guadeloupe, la Petite Fille arrive de la Côte d'Angole le 8 mai avec 181 noirs.
Lors de la visite du chirurgien le lendemain, 93 nègres sont sur le pont : " il les aurait trouvé ayant pâti par le voyage, ce qui leur a occasionné du scorbut à la plus grande partie ". 88 négresses ou négrillons sur le gaillard d’arrière : " il les aurait également trouvés attaqués du scorbut, sans aucune autre maladie apparente, si ce n’est un jeune négrillon attaqué des pians ".
Le compte de vente de 166 Noirs "négociables " est le suivant : le 10 mai, 156 à 1 600 livres en sucre ; le 26 juin, 1 à 1 650 livres ; le 28 juillet, 8 pour 7 200 livres ; le 28 juillet, 1 à 1 600 livres..
Le prix moyen des esclaves vendus par le négrier la Petite Fille en mai sera de 1.600 livres coloniales.
Le bureau du Domaine nous fournit un "Etat des nègres introduits à la Pointe à Pitre depuis le 1er août 1790 jusqu’au 31 décembre 1791": 69 proviennent de la traite française et 50 "introduits".
1793 : Le 27 juillet, la Convention supprime la prime aux négriers, ce qui va encore ralentir la traite...
1794 : Le 4 février, la Convention nationale vote le décret d’Abolition de l’esclavage du 16 pluviôse de l’an II pour toutes les colonies françaises.
1801 : Depuis 1701, selon Eric Saugera, on recense 3361 expéditions négrières françaises...
A défaut de traite, les armateurs bordelais se sont reconverti à la Course : de 1796 à 1801, ils ont armé 163 corsaires et ont capturé de nombreux négriers anglais...
1802 : Denis Decrès, ministre de la Marine et des Colonies, qui fait partie de ceux qui ont poussé Napoléon à rétablir l'esclavage, a écrit en janvier :
" La liberté est un aliment pour lequel l’estomac des nègres n’est pas préparé. Je crois qu’il faut saisir toutes les occasions pour leur rendre leur nourriture naturelle, l’esclavage "...
Traité d'Amiens la 27 mars, la paix revient.
Le 20 mai - 30 floréal - Décret de rétablissement de l'esclavage :
" Au nom du Peuple Français, Bonaparte, premier Consul, Proclame le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 30 floréal an X, conformément à la proposition faite par le gouvernement le 27 dudit mois, communiquée au Tribunat le même jour.
DÉCRET.
I. Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d'Amiens, du 6 germinal an X, l'esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789.
II. Il en sera de même dans les autres colonies françaises au-delà du cap de Bonne-Espérance
III. La traite des noirs et leur importation dans les dites colonies, auront lieu, conformément aux lois et règlements existants avant ladite époque de 1789."
Mais ce décret ne peut donc concerner la Guadeloupe et ses dépendances, îles qui, comme St Domingue, n'ont pas été restituées par le traité d'Amiens...
Bonaparte devra prendre un Arrêté spécifique le 16 juillet - 27 messidor - pour rendre la loi applicable à la Guadeloupe.
Art 1 : " La colonie de la Guadeloupe et dépendance sera régie à l’instar de la Martinique, de Ste-Lucie, de Tabago, et des colonies orientales, par les mêmes lois qui y étaient en vigueur en 1789 "
En parallèle, un Arrêté est pris le 2 juillet pour interdire de séjour en métropole à tous les noir, mulâtre ou autre gens de couleur, y compris affranchis : "Arrêté portant défense aux Noirs, Mulâtres et autres gens de couleur, d’entrer sans autorisation sur le territoire continental de la République"
L’Onis, vassal du Dahomey, est un petit royaume positionné entre ceux de Ouidah et d’Ardres. Pendant que le chef de Guemeul s’enfuit dans les bois, le village est entièrement pillé, puis brûlé, les assaillants récupérant toutes les marchandises européennes ainsi que 50 captifs. N’ayant plus de marchandises, il était impossible au Solide de continuer la traite.
Au final, sur les 400 Noirs escomptés, seuls 160 firent partie de la cargaison...
Les esclaves parviennent parfois à prendre le contrôle du navire de traite, telle la corvette l'Augustine, partie de Nantes le 20 juillet, sur laquelle les esclaves se révoltent le 26 décembre : " Les esclaves au nombre de 40 s’y sont emparés d’un coffre d’armes et ont attaqué 7 hommes de l’équipage qui étaient alors à bord, 2 sont massacrés, les 5 autres ont été blessés et jetés à la mer ; mais ils ont eu le bonheur de se sauver dans le canot, et se sont réfugiés à Mayombe où ce bateau était en traite. Le navire la Belle Ninette aussi de Nantes, est venu chercher l’équipage qu’il a amené avec le capitaine qui était à terre lors de l’événement. Les Noirs une fois maîtres du bateau ont levé l’ancre et ont appareillé "
La Chambre de commerce de La Rochelle envoie en fin d'année un Mémoire au secrétaire d'Etat à la Marine, le comte César de la Luzerne. Elle expose les conflits ayant cours sur la Côte des Esclaves, la collaboration du souverain d’Ardres, la nécessité de construire un fort, concluant que " la traite des nègres expose plus que jamais à la dépérition et à la perte des capitaux. Il serait urgent de rassurer ceux qui se livrent à cette hasardeuse spéculation "...
1789 : Bordeaux est en pleine expansion : 38 navires négriers.
Le député Bordelais Jean Béchade-Casaux, négociant et franc-maçon, écrit à ses collègues de la Chambre de Commerce de Guyennne: " Les États généraux sont encore occupés de la Déclaration des Droits de l'Homme qui doit servir d'introduction à la Constitution ; j'ai peur que cela ne conduise à la suppression de la traite des noirs, d'autant que toutes les têtes sont montées et que l'on regardera cette abolition comme le chef d'oeuvre de la saine philosophie"...
En Guadeloupe, le négrier bordelais Le Sans Pareil apporte le 19 mai 244 Noirs en provenance du Mozambique.
1790 : L’Assemblée Nationale décrète l'ouverture du commerce au-delà du cap de Bonne-Espérance à tous les Français ainsi que la liquidation de la dernière Compagnie...
1792 : La traite se ralentit avec l'arrivée de la République...
Nantes va encore armer 21 navires négriers, 7 seront pris par les Anglais avec lesquels nous sommes à nouveau en guerre, 1 fera naufrage et sur les 13 restants, 4 arriveront en Guadeloupe. Sa moyenne annuelle depuis 10 ans était de 29 négriers.
En utilisant le répertoire de Jean Mettas pour le XVIIIème siècle, depuis ses débuts, Nantes a armé 1.427 navires pour la traite, loin devant tous les autres ports...
La Rochelle aura été le 2ème port négrier avec 427 expéditions en 80 ans.
Le Havre est 3ème pour Mettas avec 398 navires de traite.
Bordeaux est à son apogée pour le XVIIIème, en 10 ans, 225 expéditions de traite, mais ayant commencé plus tardivement 393 depuis le début.
Mais selon les nouvelles estimations d'Eric Saugera, Bordeaux atteindrait 411 expéditions et serait donc 3ème...
St Malo prend la 5ème place avec 216, Lorient 6ème avec 156 suivi par Honfleur 125, Dunkerque 44, Rochefort 20, Bayonne 9, Brest 7
Du fait de la situation révolutionnaire à St Domingue, les négriers ont réorienté leurs cargaisons vers la Guadeloupe, 6.000 nègres sont ainsi introduits cette année dans l’archipel…
Parmi les derniers négriers arrivés en Guadeloupe, la Petite Fille arrive de la Côte d'Angole le 8 mai avec 181 noirs.
Lors de la visite du chirurgien le lendemain, 93 nègres sont sur le pont : " il les aurait trouvé ayant pâti par le voyage, ce qui leur a occasionné du scorbut à la plus grande partie ". 88 négresses ou négrillons sur le gaillard d’arrière : " il les aurait également trouvés attaqués du scorbut, sans aucune autre maladie apparente, si ce n’est un jeune négrillon attaqué des pians ".
Le compte de vente de 166 Noirs "négociables " est le suivant : le 10 mai, 156 à 1 600 livres en sucre ; le 26 juin, 1 à 1 650 livres ; le 28 juillet, 8 pour 7 200 livres ; le 28 juillet, 1 à 1 600 livres..
Le prix moyen des esclaves vendus par le négrier la Petite Fille en mai sera de 1.600 livres coloniales.
Le bureau du Domaine nous fournit un "Etat des nègres introduits à la Pointe à Pitre depuis le 1er août 1790 jusqu’au 31 décembre 1791": 69 proviennent de la traite française et 50 "introduits".
1793 : Le 27 juillet, la Convention supprime la prime aux négriers, ce qui va encore ralentir la traite...
1794 : Le 4 février, la Convention nationale vote le décret d’Abolition de l’esclavage du 16 pluviôse de l’an II pour toutes les colonies françaises.
1801 : Depuis 1701, selon Eric Saugera, on recense 3361 expéditions négrières françaises...
A défaut de traite, les armateurs bordelais se sont reconverti à la Course : de 1796 à 1801, ils ont armé 163 corsaires et ont capturé de nombreux négriers anglais...
1802 : Denis Decrès, ministre de la Marine et des Colonies, qui fait partie de ceux qui ont poussé Napoléon à rétablir l'esclavage, a écrit en janvier :
" La liberté est un aliment pour lequel l’estomac des nègres n’est pas préparé. Je crois qu’il faut saisir toutes les occasions pour leur rendre leur nourriture naturelle, l’esclavage "...
Traité d'Amiens la 27 mars, la paix revient.
Le 20 mai - 30 floréal - Décret de rétablissement de l'esclavage :
" Au nom du Peuple Français, Bonaparte, premier Consul, Proclame le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 30 floréal an X, conformément à la proposition faite par le gouvernement le 27 dudit mois, communiquée au Tribunat le même jour.
DÉCRET.
I. Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d'Amiens, du 6 germinal an X, l'esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789.
II. Il en sera de même dans les autres colonies françaises au-delà du cap de Bonne-Espérance
III. La traite des noirs et leur importation dans les dites colonies, auront lieu, conformément aux lois et règlements existants avant ladite époque de 1789."
Mais ce décret ne peut donc concerner la Guadeloupe et ses dépendances, îles qui, comme St Domingue, n'ont pas été restituées par le traité d'Amiens...
Bonaparte devra prendre un Arrêté spécifique le 16 juillet - 27 messidor - pour rendre la loi applicable à la Guadeloupe.
Art 1 : " La colonie de la Guadeloupe et dépendance sera régie à l’instar de la Martinique, de Ste-Lucie, de Tabago, et des colonies orientales, par les mêmes lois qui y étaient en vigueur en 1789 "
En parallèle, un Arrêté est pris le 2 juillet pour interdire de séjour en métropole à tous les noir, mulâtre ou autre gens de couleur, y compris affranchis : "Arrêté portant défense aux Noirs, Mulâtres et autres gens de couleur, d’entrer sans autorisation sur le territoire continental de la République"
1803 : Le 1er janvier, le Danemark interdit la traite.
1804 : Depuis 1802, 15 armateurs bordelais ont armé 21 négriers avec 23 voyages, Nantes n'en a expédié que 13...
Mais la reprise de la guerre avec les Anglais va rapidement ralentir puis arrêter les négriers, remplacés par des corsaires...
1807 : Le 2 février, l'Angleterre interdit la Traite.
1808 : Le 1er janvier , les Etats Unis interdisent la traite.
1814 : Le 30 mai, le Traité de Paris met fin à la guerre, après l'abdication de Napoléon, le traite va reprendre, mais bientôt dans l'illégalité... Talleyrand négocie un prolongation de la traite pour 5 ans...
1815 : Le 4 février, Acte d’Abolition de la Traite, soumis par les Anglais aux gouvernements européens au Congrès de Vienne, est signé par les vainqueurs comme par les vaincus. Il déclare la traite négrière illégale.
Elle se poursuivra jusqu’en 1831 dans les colonies françaises, avec la complicité des autorités métropolitaines et coloniales, malgré 3 lois successives…
En 1815, les Anglais saisissent et jugent au moins 5 négriers français : La Belle, l'Hermione, la Parisienne, le Cultivateur et l'Actif, puis 4 en 1816.
1804 : Depuis 1802, 15 armateurs bordelais ont armé 21 négriers avec 23 voyages, Nantes n'en a expédié que 13...
Mais la reprise de la guerre avec les Anglais va rapidement ralentir puis arrêter les négriers, remplacés par des corsaires...
1807 : Le 2 février, l'Angleterre interdit la Traite.
1808 : Le 1er janvier , les Etats Unis interdisent la traite.
1814 : Le 30 mai, le Traité de Paris met fin à la guerre, après l'abdication de Napoléon, le traite va reprendre, mais bientôt dans l'illégalité... Talleyrand négocie un prolongation de la traite pour 5 ans...
1815 : Le 4 février, Acte d’Abolition de la Traite, soumis par les Anglais aux gouvernements européens au Congrès de Vienne, est signé par les vainqueurs comme par les vaincus. Il déclare la traite négrière illégale.
Elle se poursuivra jusqu’en 1831 dans les colonies françaises, avec la complicité des autorités métropolitaines et coloniales, malgré 3 lois successives…
En 1815, les Anglais saisissent et jugent au moins 5 négriers français : La Belle, l'Hermione, la Parisienne, le Cultivateur et l'Actif, puis 4 en 1816.
Navire anglais arraisonnant un négrier espagnol...
1817 : Le 8 janvier, Ordonnance du Roi organisant la lutte contre la traite " portant peine de confiscation contre tout navire qui tenterait d’introduire des Noirs de traite dans les Colonies françaises"
1817 : Le 8 janvier, Ordonnance du Roi organisant la lutte contre la traite " portant peine de confiscation contre tout navire qui tenterait d’introduire des Noirs de traite dans les Colonies françaises"
Mais la France vient de reprendre le Sénégal, et les tentations sont grandes...
Le gouverneur anglais de la Sierra Leone écrit au nouveau gouverneur français :
" Tant que les Blancs achèteront des Noirs il aura aucun esprit d'industrie parmi les Africains "...
1818 : Nouvelle Ordonnance du Roi le 24 juin pour lutter contre la traite : " Sera entretenu sur les côtes de nos établissemens d'Afrique une croisière de notre marine à l'effet de visiter tous bâtimens français qui se présenteraient dans les parages de nos possessions sur lesdites côtes et d'empêcher toutes contraventions "
Ferdinand Gavot, commandant particulier de Gorée, est rappelé en France pour non respect de la loi.
Malgré tout, une partie de la traite continue :
Le négrier Le Rôdeur, 200 tonneaux, armé au Havre par Chédel, commandé par le capitaine Boucher, livre à Basse-Terre 160 esclaves achetés à Bonny dans le golfe de Guinée : il en a perdu 40 pendant le " passage du milieu ", ainsi qu 9 hommes d’équipage…
Le schooner Sylphe, 153 tonneaux, armé à Nantes, livre à Basse-Terre 400 esclaves achétés à Bonny dans le golfe de Guinée, apparement sans pertes ?
1820 : Dans sa thèse, Serge Daget dénombre 41 navires français soupçonnables de traite : 9 de Nantes, 5 de Bordeaux, 5 de Honfleur, 5 du Sénégal, 3 du Havre, 3 des Antilles, 3 de Bourbon, 1 de Marseille, 1 de Saint-Malo et 6 d'origine inconnue.
1821 : A la Chambre des députés, le 27 juin, Benjamin Constant demande l'application de la répression de la traite conformément aux engagements du Congrès de Vienne :
" La traite se fait : elle se fait impunément. On sait la date des départs, des achats, des arrivées. On publie des prospectus pour inviter à prendre des actions dans cette traite, seulement on déguise l'achat des esclaves en supposant l'achat des mulets sur la côte d'Afrique où jamais on n'acheta de mulets. La traite se fait plus cruellement que jamais parce que les capitaines négriers, pour se dérober à la surveillance, recourent à des expédients atroces, pour faire disparaître les captifs.
Messieurs, au nom de l'humanité, dans cette cause, où toutes les distinctions de parti doivent disparaître, unissez-vous à moi pour réclamer la loi que le ministère vous avait promise "
Le négrier Daphné, 200 tonneaux, capitaine Allain, livre à Basse-Terre 150 esclaves achetés à Gallinhas en Sierra Leone, apparemment sans pertes pendant la traversée...
1823 : Le nouveau ministre de la Marine et des Colonies, Aimé-Marie Gaspard de Clermont-Tonnerre, fournit un Etat concernant 249 navires inculpés entre le 19 novembre 1817 et le 27 mars 1823 : 103 d'entre-eux proviennent de la métropole, dont 53 de Nantes, 27 de Bordeaux, 15 du Havre, 1 de Honfleur, 1 de Saint-Malo, 1 de Marseille, 1 de Bayonne, 1 du Croisic et 1 de Lorient.
1824 : La traite illégale se poursuit, Nantes tient son rang : en 1824-1825, elle expédie autant de navires négriers qu’au cours de ses meilleures années du XVIIIe siècle et, pour l’ensemble de la période illégale, 305 navires, soit 42,5 % des 717 navires français répertoriés.
En Guadeloupe, en février, arrivée du négrier Le Créole, armé à Nantes, qui livre à Basse-Terre 263 esclaves achetés à Sao Tomé : il en a perdu 56 durant la traversée.
1825 : Sur les mers, la Marine royale est mise à contribution : " des bâtiments de guerre sont envoyés aux côtes occidentales de l’Afrique avec pour mission d’arraisonner les navires marchands susceptibles d’être aussi négriers. Les débuts sont timides : les croisières de répression, opportunément frappées de cécité, n’arrêtent personne.
Mais elles finiront par déployer une belle efficacité à partir de 1825, quand les marins français auront avantage à faire des prises négrières, puisqu’ils touchent une prime de 100 francs par Noir recapturé et se partagent le produit de la liquidation du navire négrier saisi "…
1826 : Dernière expédition négrière illégale Bordelaise : depuis 1672, les armateurs Bordelais auront armé 508 navires de traite, répartis sur 105 armateurs et ayant transporté plus de 120.000 Noirs…
1827 : La loi du 25 avril voulue par le roi Charles X fait de la traite des Noirs un crime, et non plus un délit.
1829 : Abolition de l’esclavage au Mexique.
A Marie-Galante, Romain Louis Auger, 31 ans, nommé Procureur au Tribunal de Première Instance, est arrivé en janvier. Magistrat rigoureux et incorruptible, il se heurte très vite aux colons…
Il écrit au Procureur Général le 14 août :
" Les magistrats et fonctionnaires métropolitains, étant un obstacle aux vues intéressées et illégales des créoles et colons, devinrent l’objet de leur haine. Mes fonctions me mettant en opposition avec leurs intérêts privés, ils cherchèrent d’abord à me séduire par des offres si je voulais consentir à tolérer la traite des noirs, ils m’offrirent plus tard 10.000 frs de rente si je voulais consentir à quitter la colonie…Voyant qu’ils ne pouvaient point me gagner, ils mirent tout en œuvre pour me perdre…"
Auger finira par devoir rentrer en France, il sera nommé en 1830 Avocat Général à St Louis du Sénégal, il se heurtera très vite au Gouverneur Brou pour les mêmes raisons, sera révoqué en 1831 et périra sur le navire du retour avec sa femme et son fils.
Exemple de ce contre quoi il luttait : un négrier armé à Nantes, le César, amène discrètement en novembre 340 esclaves en Guadeloupe, port non précisé…avant de terminer ses livraisons à St Thomas…
1831 : Interdiction effective de la traite avec Convention entre Anglais et Français sur un droit de visite réciproque pour surveiller l’abolition effective.
En Guadeloupe, une corrrespondance nous apprend toutefois que " le vendredi 4 février, un négrier par suite d'une fausse manœuvre s'est échoué sur les cailles de l'Anse-Bertrand et il en est sorti 350 enfants qui ont été conduits chez un habitant de ce quartier, puis vendus sur la même habitation "...
Durcissement des peines encourues pour la Traite par la loi du 4 mars 1831 :
- 10 à 20 ans de travaux forcés pour les principaux responsables du trafic
- Réclusion pour l'équipage d'un négrier pris en mer
- Les fonctionnaires impliqués dans la traite tombent sous le coup du Code pénal ainsi que tout crime ou délit de droit commun commis à bord des navires
- Acheteur, vendeur ou receleur de Noirs sont passibles de la Cour d'Assises en France et aux Colonies...
1840 : Dernier bateau négrier français, nommé Le Philanthrope (!), appartenant au négociant et futur maire du Havre, Jules Masurier. Son navire sera intercepté avant d’atteindre sa destination de Montevideo...
Le gouverneur anglais de la Sierra Leone écrit au nouveau gouverneur français :
" Tant que les Blancs achèteront des Noirs il aura aucun esprit d'industrie parmi les Africains "...
1818 : Nouvelle Ordonnance du Roi le 24 juin pour lutter contre la traite : " Sera entretenu sur les côtes de nos établissemens d'Afrique une croisière de notre marine à l'effet de visiter tous bâtimens français qui se présenteraient dans les parages de nos possessions sur lesdites côtes et d'empêcher toutes contraventions "
Ferdinand Gavot, commandant particulier de Gorée, est rappelé en France pour non respect de la loi.
Malgré tout, une partie de la traite continue :
Le négrier Le Rôdeur, 200 tonneaux, armé au Havre par Chédel, commandé par le capitaine Boucher, livre à Basse-Terre 160 esclaves achetés à Bonny dans le golfe de Guinée : il en a perdu 40 pendant le " passage du milieu ", ainsi qu 9 hommes d’équipage…
Le schooner Sylphe, 153 tonneaux, armé à Nantes, livre à Basse-Terre 400 esclaves achétés à Bonny dans le golfe de Guinée, apparement sans pertes ?
1820 : Dans sa thèse, Serge Daget dénombre 41 navires français soupçonnables de traite : 9 de Nantes, 5 de Bordeaux, 5 de Honfleur, 5 du Sénégal, 3 du Havre, 3 des Antilles, 3 de Bourbon, 1 de Marseille, 1 de Saint-Malo et 6 d'origine inconnue.
1821 : A la Chambre des députés, le 27 juin, Benjamin Constant demande l'application de la répression de la traite conformément aux engagements du Congrès de Vienne :
" La traite se fait : elle se fait impunément. On sait la date des départs, des achats, des arrivées. On publie des prospectus pour inviter à prendre des actions dans cette traite, seulement on déguise l'achat des esclaves en supposant l'achat des mulets sur la côte d'Afrique où jamais on n'acheta de mulets. La traite se fait plus cruellement que jamais parce que les capitaines négriers, pour se dérober à la surveillance, recourent à des expédients atroces, pour faire disparaître les captifs.
Messieurs, au nom de l'humanité, dans cette cause, où toutes les distinctions de parti doivent disparaître, unissez-vous à moi pour réclamer la loi que le ministère vous avait promise "
Le négrier Daphné, 200 tonneaux, capitaine Allain, livre à Basse-Terre 150 esclaves achetés à Gallinhas en Sierra Leone, apparemment sans pertes pendant la traversée...
1823 : Le nouveau ministre de la Marine et des Colonies, Aimé-Marie Gaspard de Clermont-Tonnerre, fournit un Etat concernant 249 navires inculpés entre le 19 novembre 1817 et le 27 mars 1823 : 103 d'entre-eux proviennent de la métropole, dont 53 de Nantes, 27 de Bordeaux, 15 du Havre, 1 de Honfleur, 1 de Saint-Malo, 1 de Marseille, 1 de Bayonne, 1 du Croisic et 1 de Lorient.
1824 : La traite illégale se poursuit, Nantes tient son rang : en 1824-1825, elle expédie autant de navires négriers qu’au cours de ses meilleures années du XVIIIe siècle et, pour l’ensemble de la période illégale, 305 navires, soit 42,5 % des 717 navires français répertoriés.
En Guadeloupe, en février, arrivée du négrier Le Créole, armé à Nantes, qui livre à Basse-Terre 263 esclaves achetés à Sao Tomé : il en a perdu 56 durant la traversée.
1825 : Sur les mers, la Marine royale est mise à contribution : " des bâtiments de guerre sont envoyés aux côtes occidentales de l’Afrique avec pour mission d’arraisonner les navires marchands susceptibles d’être aussi négriers. Les débuts sont timides : les croisières de répression, opportunément frappées de cécité, n’arrêtent personne.
Mais elles finiront par déployer une belle efficacité à partir de 1825, quand les marins français auront avantage à faire des prises négrières, puisqu’ils touchent une prime de 100 francs par Noir recapturé et se partagent le produit de la liquidation du navire négrier saisi "…
1826 : Dernière expédition négrière illégale Bordelaise : depuis 1672, les armateurs Bordelais auront armé 508 navires de traite, répartis sur 105 armateurs et ayant transporté plus de 120.000 Noirs…
1827 : La loi du 25 avril voulue par le roi Charles X fait de la traite des Noirs un crime, et non plus un délit.
1829 : Abolition de l’esclavage au Mexique.
A Marie-Galante, Romain Louis Auger, 31 ans, nommé Procureur au Tribunal de Première Instance, est arrivé en janvier. Magistrat rigoureux et incorruptible, il se heurte très vite aux colons…
Il écrit au Procureur Général le 14 août :
" Les magistrats et fonctionnaires métropolitains, étant un obstacle aux vues intéressées et illégales des créoles et colons, devinrent l’objet de leur haine. Mes fonctions me mettant en opposition avec leurs intérêts privés, ils cherchèrent d’abord à me séduire par des offres si je voulais consentir à tolérer la traite des noirs, ils m’offrirent plus tard 10.000 frs de rente si je voulais consentir à quitter la colonie…Voyant qu’ils ne pouvaient point me gagner, ils mirent tout en œuvre pour me perdre…"
Auger finira par devoir rentrer en France, il sera nommé en 1830 Avocat Général à St Louis du Sénégal, il se heurtera très vite au Gouverneur Brou pour les mêmes raisons, sera révoqué en 1831 et périra sur le navire du retour avec sa femme et son fils.
Exemple de ce contre quoi il luttait : un négrier armé à Nantes, le César, amène discrètement en novembre 340 esclaves en Guadeloupe, port non précisé…avant de terminer ses livraisons à St Thomas…
1831 : Interdiction effective de la traite avec Convention entre Anglais et Français sur un droit de visite réciproque pour surveiller l’abolition effective.
En Guadeloupe, une corrrespondance nous apprend toutefois que " le vendredi 4 février, un négrier par suite d'une fausse manœuvre s'est échoué sur les cailles de l'Anse-Bertrand et il en est sorti 350 enfants qui ont été conduits chez un habitant de ce quartier, puis vendus sur la même habitation "...
Durcissement des peines encourues pour la Traite par la loi du 4 mars 1831 :
- 10 à 20 ans de travaux forcés pour les principaux responsables du trafic
- Réclusion pour l'équipage d'un négrier pris en mer
- Les fonctionnaires impliqués dans la traite tombent sous le coup du Code pénal ainsi que tout crime ou délit de droit commun commis à bord des navires
- Acheteur, vendeur ou receleur de Noirs sont passibles de la Cour d'Assises en France et aux Colonies...
1840 : Dernier bateau négrier français, nommé Le Philanthrope (!), appartenant au négociant et futur maire du Havre, Jules Masurier. Son navire sera intercepté avant d’atteindre sa destination de Montevideo...
1847 : A Marie Galante, Le 26 février, malgré l’interdiction de la traite, une goélette exporte 30 esclaves qui seront revendus à Vieques (Porto Rico), alors que le procureur du Roi Mercier est en tournée à Saint Louis.
Les autorités locales resteront silencieuses…
Mais n'oublions pas que quelques colons marie-galantais vont se réfugier à Vieques au moment de l'Abolition !
1848 : Depuis 1801, selon Eric Saugera, on recense 806 expéditions négrières françaises.
Au total depuis 1643, 4220 expéditions dont 1744 de Nantes, 480 de Bordeaux, 477 de La Rochelle et 455 du Havre...
Depuis l'Abolition de la Traite en 1815, selon Serge Daget, 717 navires français ont pratiqué la traite illégale, dont 305 de Nantes et 41 de Bordeaux.
A titre de comparaison, de 1698 à 1807, les négriers anglais ont armé 11.00O navires, dont 5700 de Liverpool, premier port négrier du monde...
En Angleterre, le Comité d’enquête de la Chambre des Communes à Londres a essayé de fournir des statistiques sur l’ensemble de la Traite Africaine pour les colonies occidentales de 1788 à 1847 :
Les autorités locales resteront silencieuses…
Mais n'oublions pas que quelques colons marie-galantais vont se réfugier à Vieques au moment de l'Abolition !
1848 : Depuis 1801, selon Eric Saugera, on recense 806 expéditions négrières françaises.
Au total depuis 1643, 4220 expéditions dont 1744 de Nantes, 480 de Bordeaux, 477 de La Rochelle et 455 du Havre...
Depuis l'Abolition de la Traite en 1815, selon Serge Daget, 717 navires français ont pratiqué la traite illégale, dont 305 de Nantes et 41 de Bordeaux.
A titre de comparaison, de 1698 à 1807, les négriers anglais ont armé 11.00O navires, dont 5700 de Liverpool, premier port négrier du monde...
En Angleterre, le Comité d’enquête de la Chambre des Communes à Londres a essayé de fournir des statistiques sur l’ensemble de la Traite Africaine pour les colonies occidentales de 1788 à 1847 :
Cette carte publiée par le capitaine de vaisseau Bouet-Willaumez dans son livre " Commerce et Traite aux Côtes Occidentales d'Afrique " montre que la traite (en noir) était toujours active dans les dernières années...
L'abolition du 27 mai va mettre fin à l'esclavage dans nos îles, mais il va continuer à Cuba, à Porto Rico, au Brésil, etc..., où vont partir d'ailleurs certains de nos colons français dont certains marie-galantais...