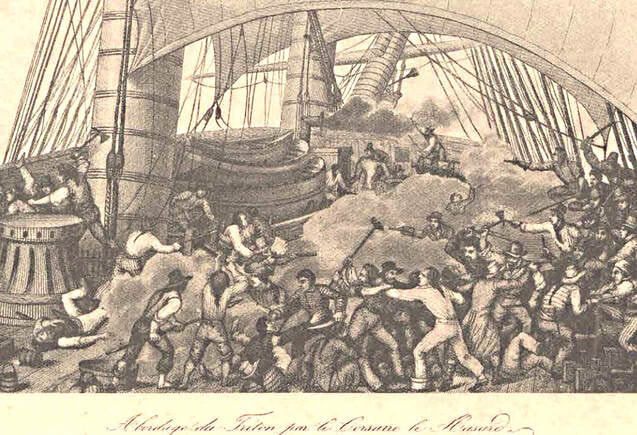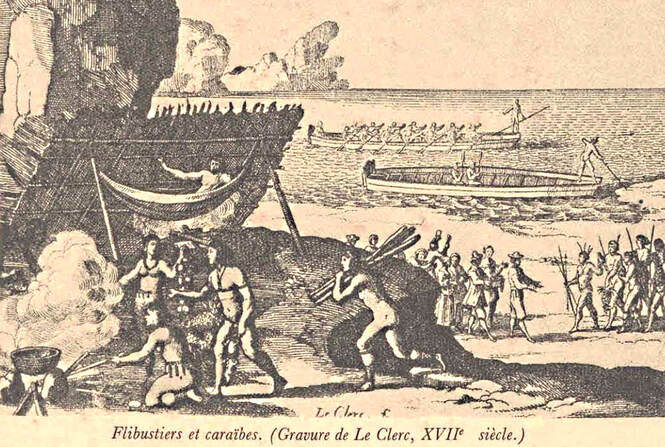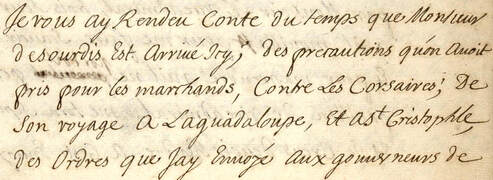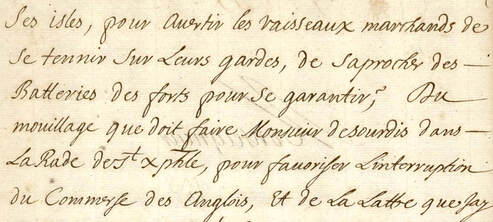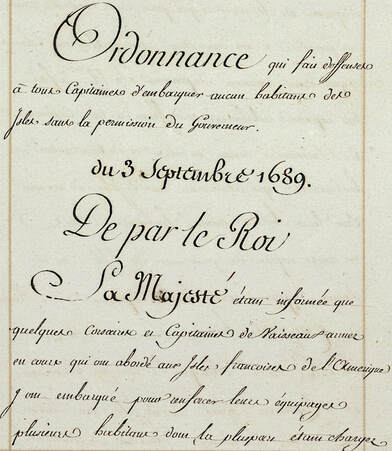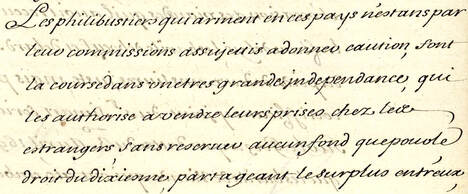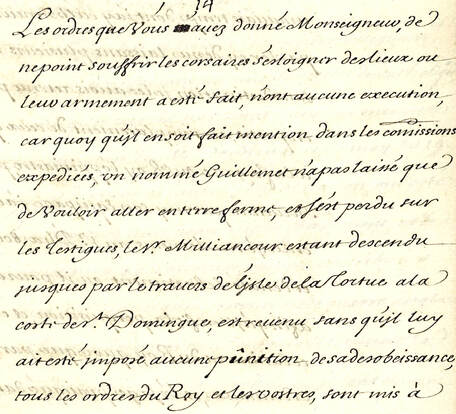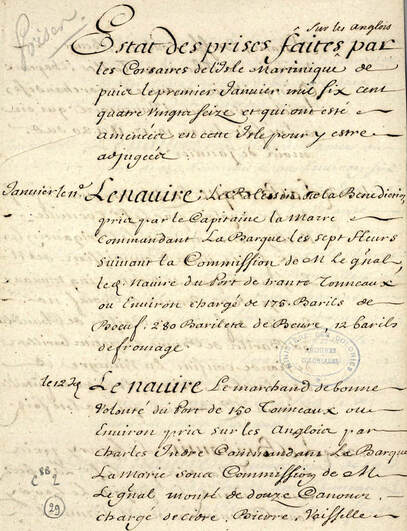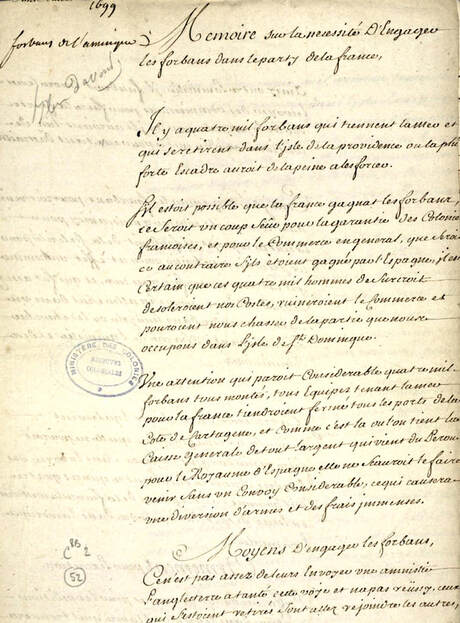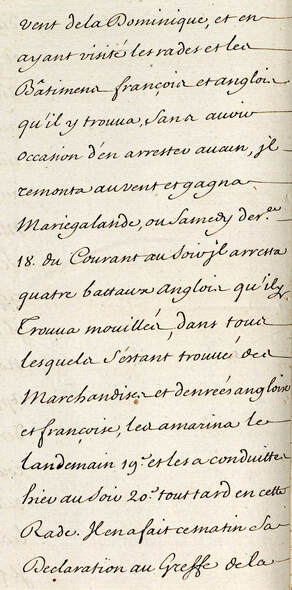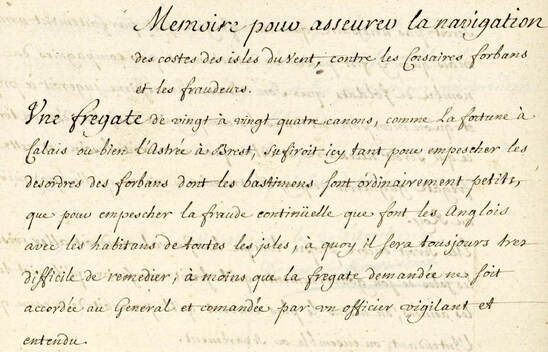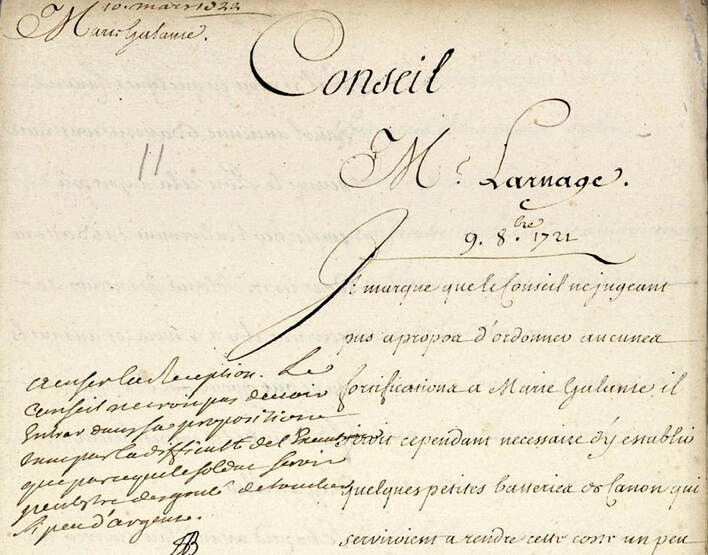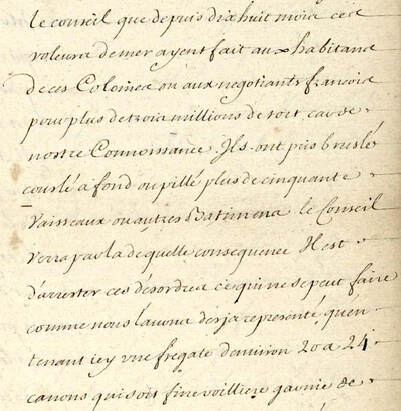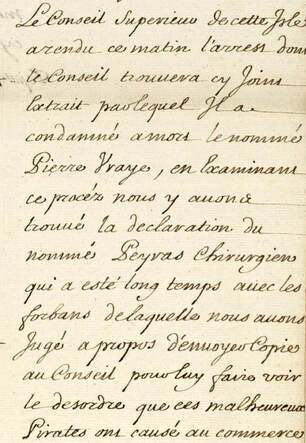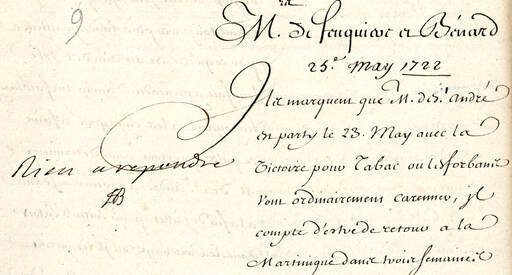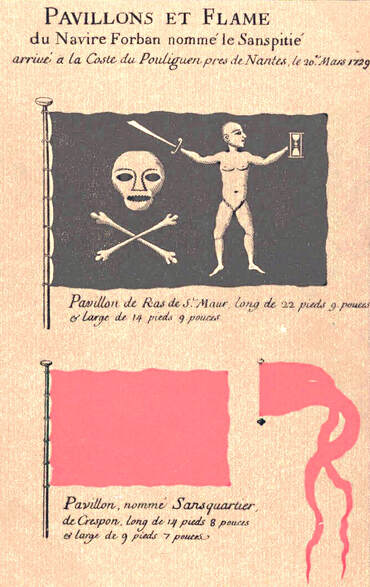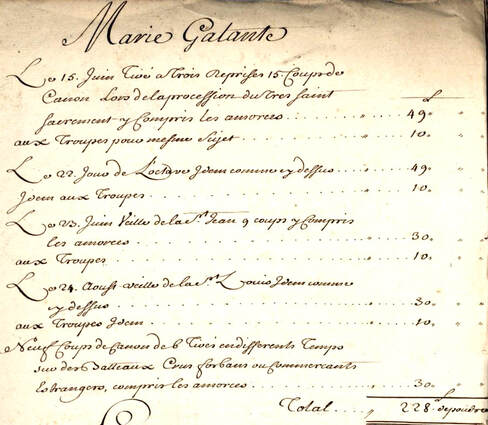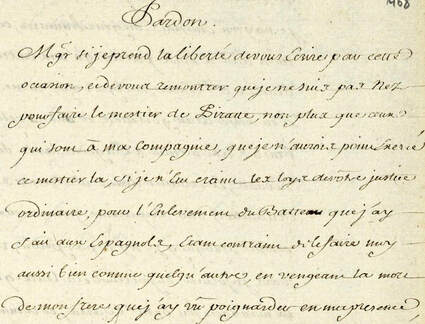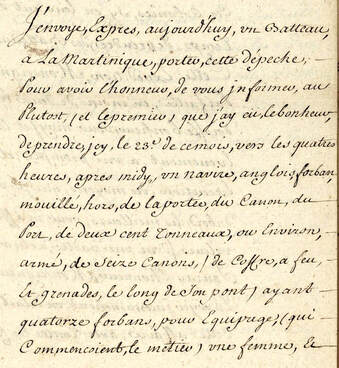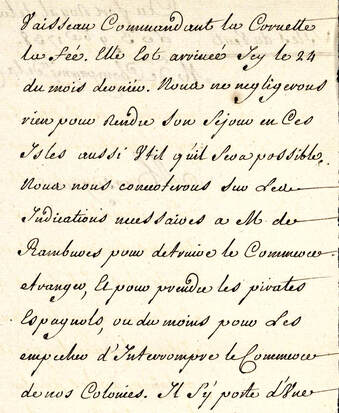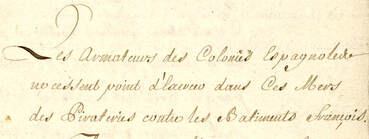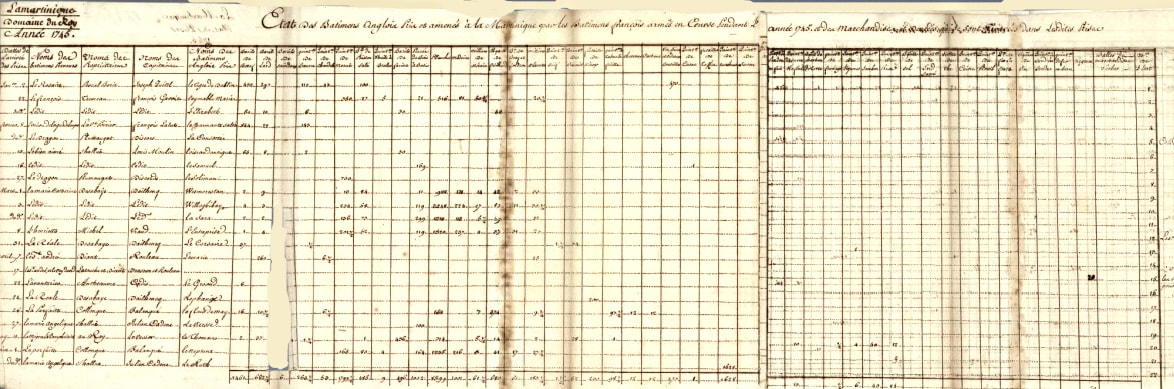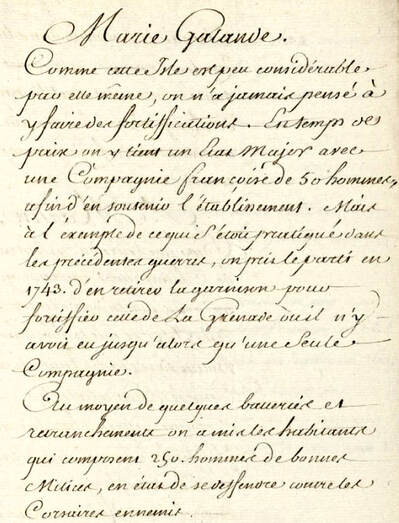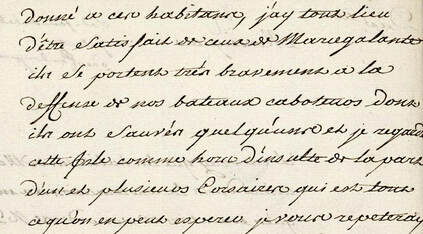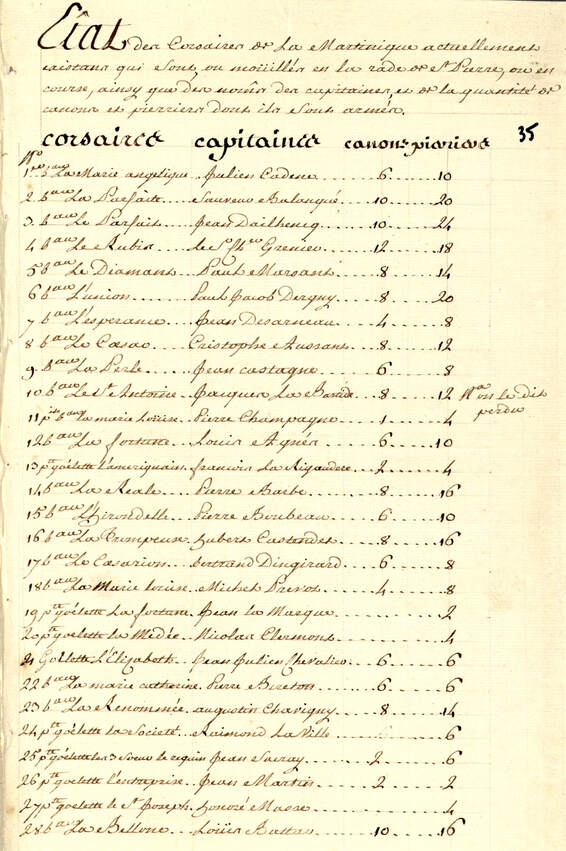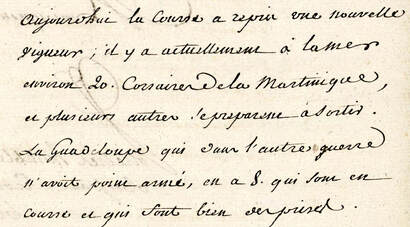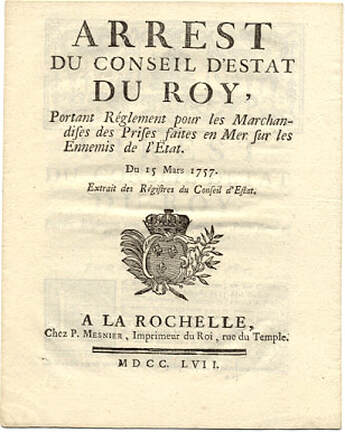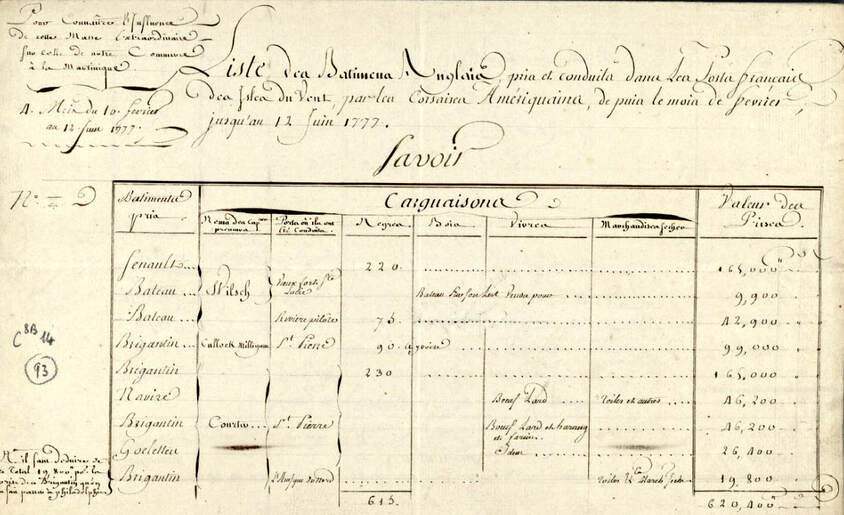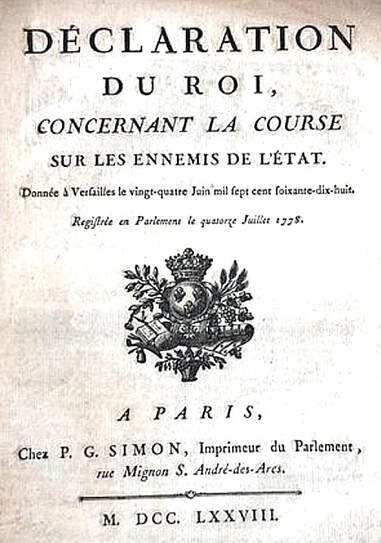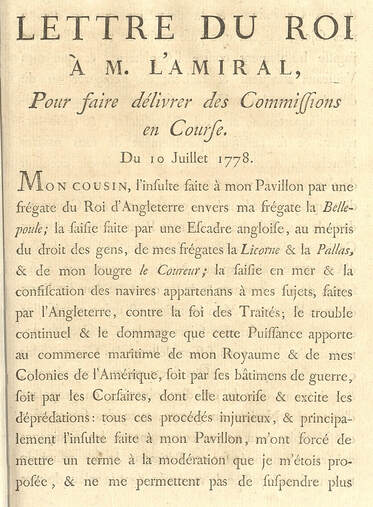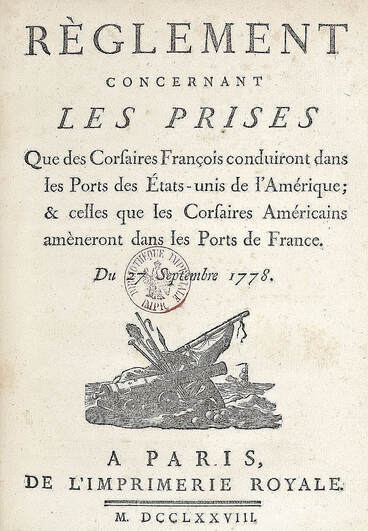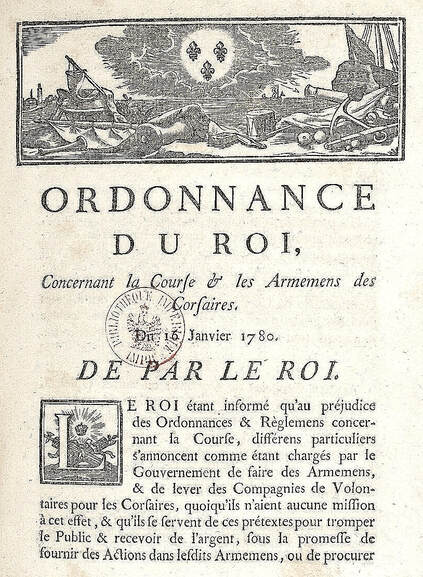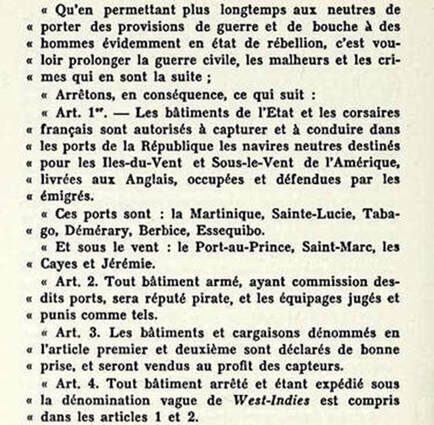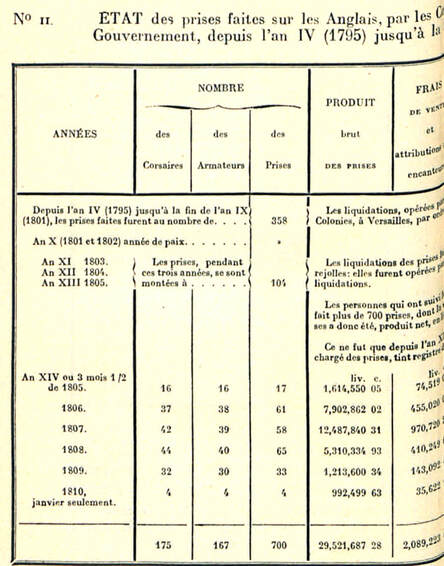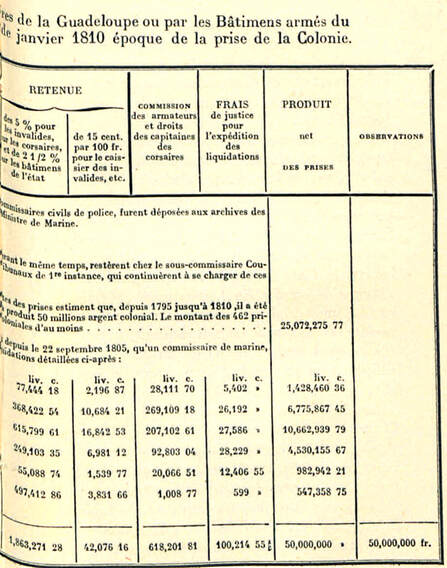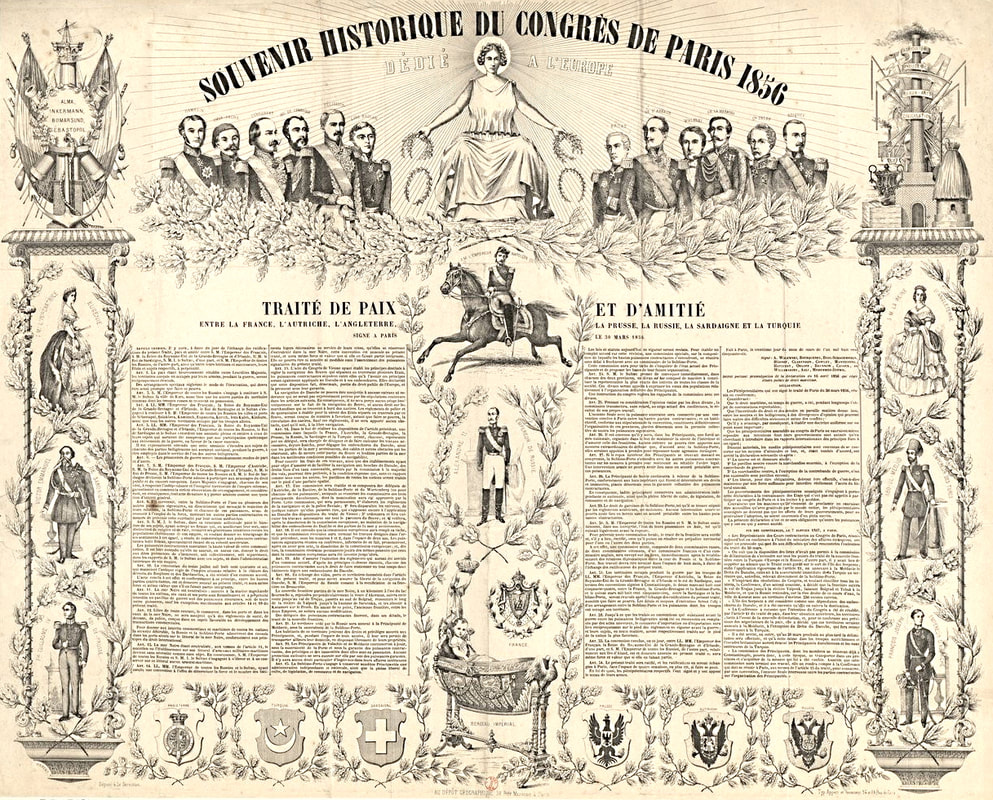Les Espagnols avaient l’habitude de lâcher des bœufs et des porcs sur des îles des Petites Antilles, pour servir de ravitaillement à leurs galions.
Certains "avanturiers" deviennent boucaniers, en fumant la viande et en la revendant aux navires de passage.
Les flibustiers (vrijbuiter : libre faiseur de butin), recrutés parmi ces mêmes "avanturiers", s’occupent surtout du pillage des galions Espagnols tant dans la Caraïbe qu'à travers l'Atlantique et jusqu'à Séville.
Dés le début du XVIème siècle, sur l'île de St Christophe, quelques "avanturiers" français, anglais et hollandais cultivent un peu de tabac et se livrent surtout à des activités de boucaniers et de flibustiers.
A partir de l'attaque de St Christophe par les Espagnols en 1634, leur activité va se transfèrer sur l'île de la Tortue, proche d'Hispaniola, future St Domingue.
Commandés initialement par l'anglais Willis, c'est le Français Jehan Le Vasseur qui va prendre le contrôle de l'île en 1641, et 2 ans plus tard ils disposeront de 7 navires flibustiers.
Sur l’île de la Tortue, ces flibustiers vont constituer une société organisée selon la "Coustume des Frères de la Coste".
Il s'agit pour l'époque d'une organisation sociale quasi républicaine : les frères de la côte sont égaux entre eux, il n'y a pas de préjugés raciaux, ni sexuels, pas de propriété individuelle de la terre. Les capitaines sont élus et révocables.
L'accord de "charte-partie" qui règle à chaque opération le partage du butin, prévoit une part pour indemniser les blessés.
Une fois ce contrat signé les membres de l’équipage s’associent 2 à 2 en vue de s’entraider en cas de maladie ou de blessure.
Ce "matelotage" comporte aussi un testament dans lequel celui qui décède donne tous ses biens à son compagnon.
Le contrat d’indemnisation était le suivant :
Pour se protéger, à partir de 1560, les Espagnols vont adopter le système du convoi "la flota" : ce convoi rassemble de nombreux vaisseaux marchands ainsi que des navires de guerre afin de contrer toute attaque pirate.
Cette flottille, chaque année, prend le départ de Séville (et plus tard de Cadix), avec passagers, troupes et marchandises de l'Ancien monde à destination des colonies du Nouveau Monde. Ces cargaisons du trajet aller servent surtout de lest, car le but principal est de ramener un an de production d'or, d'argent et de pièces de monnaie.
Ce voyage de retour est donc la cible de choix pour les flibustiers qui suivent discrètement la flottille et attaquent les navires qui prennent du retard ou s'écartent des autres...
Certains "avanturiers" deviennent boucaniers, en fumant la viande et en la revendant aux navires de passage.
Les flibustiers (vrijbuiter : libre faiseur de butin), recrutés parmi ces mêmes "avanturiers", s’occupent surtout du pillage des galions Espagnols tant dans la Caraïbe qu'à travers l'Atlantique et jusqu'à Séville.
Dés le début du XVIème siècle, sur l'île de St Christophe, quelques "avanturiers" français, anglais et hollandais cultivent un peu de tabac et se livrent surtout à des activités de boucaniers et de flibustiers.
A partir de l'attaque de St Christophe par les Espagnols en 1634, leur activité va se transfèrer sur l'île de la Tortue, proche d'Hispaniola, future St Domingue.
Commandés initialement par l'anglais Willis, c'est le Français Jehan Le Vasseur qui va prendre le contrôle de l'île en 1641, et 2 ans plus tard ils disposeront de 7 navires flibustiers.
Sur l’île de la Tortue, ces flibustiers vont constituer une société organisée selon la "Coustume des Frères de la Coste".
Il s'agit pour l'époque d'une organisation sociale quasi républicaine : les frères de la côte sont égaux entre eux, il n'y a pas de préjugés raciaux, ni sexuels, pas de propriété individuelle de la terre. Les capitaines sont élus et révocables.
L'accord de "charte-partie" qui règle à chaque opération le partage du butin, prévoit une part pour indemniser les blessés.
Une fois ce contrat signé les membres de l’équipage s’associent 2 à 2 en vue de s’entraider en cas de maladie ou de blessure.
Ce "matelotage" comporte aussi un testament dans lequel celui qui décède donne tous ses biens à son compagnon.
Le contrat d’indemnisation était le suivant :
- Pour la perte d'un œil : 100 écus ou un esclave.
- Pour la perte des deux : 600 écus ou six esclaves.
- Pour la perte de la main droite ou du bras droit : 200 écus ou deux esclaves.
- Pour la perte d'un doigt ou d'une oreille : 100 écus ou un esclave.
- Pour la perte d'un pied ou d'une jambe : 200 écus ou deux esclaves.
- Pour la perte des deux : 600 écus ou six esclaves.
Pour se protéger, à partir de 1560, les Espagnols vont adopter le système du convoi "la flota" : ce convoi rassemble de nombreux vaisseaux marchands ainsi que des navires de guerre afin de contrer toute attaque pirate.
Cette flottille, chaque année, prend le départ de Séville (et plus tard de Cadix), avec passagers, troupes et marchandises de l'Ancien monde à destination des colonies du Nouveau Monde. Ces cargaisons du trajet aller servent surtout de lest, car le but principal est de ramener un an de production d'or, d'argent et de pièces de monnaie.
Ce voyage de retour est donc la cible de choix pour les flibustiers qui suivent discrètement la flottille et attaquent les navires qui prennent du retard ou s'écartent des autres...
Les flibustiers et boucaniers n’hésitent pas à apprendre la langue des Caraïbes et à prendre chez eux des femmes que ces indiens leur accordaient volontiers, des métis jouissant des deux cultures se multipliaient : " Le flibustier peut vivre et mourir comme un indien"...
1522 : Le pirate français Jean Fleury capture deux caravelles espagnoles transportant une partie du trésor des Aztèques, qui viennent d'être conquis par le conquistador Hernan Cortés : il ramène à Honfleur une fortune en or et pierres précieuses.
Il sera pendu par les espagnols à Tolède en 1527, mais cette première prise va encourager les pirates et corsaires français, avec le soutien discret de François 1er, en guerre avec Charles Quint...
1554 : Le corsaire français François Le Clerc, surnommé Jambe de Bois, pille Puerto Rico puis Santiago de Cuba.
1555 : Le corsaire français huguenot Jacques de Sores, surnommé l'Ange exterminateur, attaque La Havane avec 3 navires et 200 hommes : il pille la ville et brûle les églises...
1573 : Le corsaire français Guillaume Le Testut, huguenot de Dieppe, s’allie au corsaire anglais Francis Drake.
Au Panama, ils s’emparent d’un convoi espagnol d’or et d’argent en provenance du Pérou, Le Testut y laisse la vie...
1574 : On recense environ 60 navires armés en course, la majorité au départ de la Rochelle, où se sont réfugiés aussi des corsaires huguenots normands ainsi que des corsaires zélandais missionnés par Guillaume d'Orange Nassau, en rébellion contre Philippe II d'Espagne qui contrôle les Flandres.
1585 : Le corsaire Francis Drake part de Plymouth avec 29 navires et 2.300 hommes, il manque le convoi d'or espagnol devant Vigo, perd 300 hommes des fièvres, continue sur les Antilles, pille la capitale d'Hispaniola, Santo-Domingo puis Carthagène. Il revient en Angleterre en 1586 avec seulement 700 hommes en état de combattre...
1588 : Défaite de l'Invincible Armada de Philippe II d'Espagne, partie pour attaquer l'Angleterre d'Elisabeth Ier et rétablir le catholicisme...
1589 : Les corsaires anglais "sea dogs" sont si nombreux que la "flota" espagnole reste bloquée à La Havane...
1595 : Le corsaire Francis Drake, lors de sa dernière expédition, vient mouiller à Marie Galante avant de s’ancrer 3 jours en Guadeloupe.
1603 : Le normand Pierre Belain d'Esnambuc s'embarque à 18 ans comme matelot sur la barque Le Petit Argus au départ du Havre de Grâce pour le "Brazil et autres isles" : c'est le début de sa carrière de corsaire...
1610 : Le corsaire français Legrand rentre à Dieppe après avoir capturé un galion espagnol chargé d'or : ce succès relance une vague d’expéditions de ceux que l’on appelait les "Péroutiers", car tout l’or était censé venir du Pérou et les Antilles étaient aussi appelées "Isles du Pérou"…
1618 : Début de la guerre de Trente Ans, qui est au départ une guerre de religion qui va impliquer successivement toutes les monarchies européennes : les monarchies catholiques menées par les Habsbourg du Saint Empire Germanique et d'Espagne, soutenues par le Pape, entrent en guerre contre les monarchies qui autorisent le protestantisme luthérien ou calviniste : les Etats protestants du Saint Empire, les Provinces Unies(Hollande), les monarchies scandinaves.
La France de Louis XIII et Richelieu, bien que luttant contre ses propres protestants, redoute l'expansion des Habsbourg et va y participer à partir de 1635 avec la guerre franco-espagnole...
1623 : En janvier, le capitaine anglais Thomas Waerner arrive à St Christophe, qu'il connaissait déja en tant que corsaire, mais cette fois avec sa femme, son fils et une trentaine d'hommes dans un but de colonisation.
Ils sont bien accueillis par le chef Caraibe Tegramund. Ils plantent des vivres et du pétun (tabac).
Pierre Belain d’Esnambuc, "péroutier" ou corsaire normand, signe une charte-partie le 1er mai, avec Henry de Chantail, Jehan Le Vasseur et 51 autres marins pour armer le brigantin l’Espérance : " Pierre de Blain, écuyer, sieur d’Enambusc, capitaine et conducteur après Dieu du navire appelé l'Espérance, du port de cent tonneaux ou viron, étant de présent en ce port et Havre de Grâce, prêt à partir pour faire Dieu aidant le voyage du Pérou, Brésil et autres îles et parties de l’aval, ledit sieur d’Enambusc bercement audit navire, pour lui et les pages d’icelui, pour trois pleins tiers, les bourgeois victuailleurs pour un tiers, Henry de Chantail, écuyer, lieutenant audit navire pour un tiers et demi, Jehan Le Vasseur, enseigne…"
Ils partent du Hâvre de Grâce en décembre avec une soixantaine d’hommes.
Après une exploration en Guyane ou au Brésil, ils réalisent en fin d'année une première implantation à St Christophe et Jehan Le Vasseur - futur gouverneur de La Tortue - semble être resté sur place avec une trentaine d'hommes, majoritairement huguenots.
St Christophe n'était auparavant qu'une base de corsaires...
1625 : Les corsaires normands Bellain d'Esnambuc et Urbain de Rossey partent de Honfleur début mai sur le navire l’Espérance.
Arrivés aux Iles Caimans, dans un combat naval contre un galion espagnol de 30 canons, ils gagnent en dépit de leurs 4 canons, mais perdent un tiers de son équipage et leur brigantin ne tient plus la mer...
Ils décident de faire escale à St Christophe pour réparer où ils retrouvent la trentaine de Français, installés depuis un an, commandés par Le Vasseur, qui cultivent du pétun (tabac).
La colonisation française est lancée...
Après de nombreux aléas à St Christophe dont il est devenu le capitaine, D'Esnambuc va ensuite prendre possession de la Martinique puis de la Dominique en 1635, peu après la prise de possession de la Guadeloupe par Liénard de l’Olive et Duplessis d’Ossonville.
1627 : Richelieu, qui dirige le Conseil Du Roy depuis 3 ans, institue un Conseil de la Marine, qui entre-autres gère les prises des corsaires.
Début de la guerre franco-anglaise dans le cadre de la guerre de Trente Ans : les Anglais soutiennent les huguenots français, leur tentative de débarquement à l'île de Ré sera un échec et il n'arriveront pas à faire lever le siège de La Rochelle, un Traité avec la France sera signé en 1629;
1635 : La Compagnie de St Christophe est devenue la Compagnie des Isles d'Amérique.
Début de la guerre franco-espagnole, toujours dans le cadre de la guerre de Trente Ans...
Les corsaires dunkerquois - Dunkerque est alors espagnole - capturent un navire de la Compagnie de retour de St Christophe, chargé de pétun, mais aussi de documents confidentiels : craignant de ce fait une attaque de l'isle, les associés de la Compagnie des Isles d'Amérique décident d'envoyer "au plus tôt ...une barque d'avis " et de l'armement à D'Esnambuc :
" Le dit Berruyer a dit avoir fait avertir messieurs les associés qui sont à présent en cette ville pour leur faire savoir qu’il a eu avis de Dieppe par le sieur Manicher, commis de la dite Compagnie, que le navire commandé par Richer, revenant de Saint-Christophe chargé de pétun, avait été pris par les Dunkerquois, et que par lettres écrites de l’isle Saint-Christophe au dit sieur du Herteley par le sieur Gentil, commis de la Compagnie, on lui donnait avis que le vaisseau dudit Richer apportait à la Compagnie le mémoire au vrai des Français qui étaient à Saint-Christophe, de leur qualité, des armes qu’il y avait, et de l’état des forts et de ce qu’il était nécessaire de leur envoyer pour la défense et conservation de ladite île, que ces mémoires étant vus à Dunkerque, il était à croire qu’on ne manquerait pas d’y donner avis en Espagne, ce qui pourrait faire penser à surprendre ladite isle en sachant les défauts, que cette affaire méritait d’y donner ordre au plus tôt leur donnant avis de se prendre garde et leur envoyant des armes et munitions. L’affaire mise en délibération, a été résolu d’envoyer au plus tôt en l’île Saint-Christophe une barque d’avis pour les avertir de se tenir sur leurs gardes et de leur envoyer par même moyen cent mousquets avec les bandoulières et fourchettes, deux cents piques, vingt-quatre hallebardes, six cents de mèche, un millier de poudre, savoir cinq cents de poudre à canon et cinq cents de poudre à mousquet, mille livres de plomb, savoir cinq cents livres en balle et cinq cents livres en saumon, et quelques moules pour faire les balles."
D'Esnambuc va décéder l'année suivante à 51 ans.
1641 : Le Commandeur de l'Ordre de Malte, Chevalier de Jérusalem, Philippe Blondel de Lonvilliers, seigneur de Poincy, a été choisi en 1638 par la Compagnie des Isles d'Amérique pour succéder à Belain d'Esnambuc comme Capitaine général : il a pris sa charge à St Christophe en 1639, modifiée par Richelieu, en tant que "Gouverneur et Lieutenant Général de sa Majesté pour toutes les Isles de l’Amérique".
De Poincy nomme gouverneur le huguenot (protestant) Le Vasseur, qui avait initié la 1ère implantation française à St Christophe, et l’envoie prendre possession de l'île de la Tortue, déjà occupée par des flibustiers et boucaniers, mais sous occupation anglaise.
Le Vasseur débarque avec 40 autres protestants chez les flibustiers, en recrute 50 majoritairement protestants et chasse les Anglais. De Poincy avait réussi de ce fait à se débarrasser à St Christophe de presque tous les protestants...
La Tortue offrait déjà un port naturel : ingénieur militaire de formation, Le Vasseur va le fortifier en faisant construire le Fort de la Roche.
1643 : Les Espagnols essayent de reprendre la Tortue, se heurtent aux nouvelles fortifications et laissent 200 morts sur le terrain...
1648 : Fin de la guerre de Trente Ans par le Traité de Whesphalie
1652 : A la Tortue, place forte des flibustiers, la gouvernance du huguenot Le Vasseur, avec de lourds impôts et une persécution contre les catholiques, a soulevé beaucoup de monde contre lui : il est victime d’un complot et assassiné par ses lieutenants Martin et Thibault…Timoléon Hotman, seigneur de Fontenay, le remplace en fin d’année avec l’appui de De Poincy.
1653 : Hotman de Fontenay envoie cette année 22 bâtiments armés en course sur les Grandes Antilles, Campêche et le Honduras
1654 : Les Espagnols ne supportent plus les expéditions des flibustiers - piratas - au départ de l'île de la Tortue : la flotte espagnole de Don Gabriel Rozas de Valle Figueroa reprend l’île et en chasse le gouverneur De Fontenay.
1657 : Après avoir échoué à prendre Hispaniola aux Espagnols, l'amiral anglais Blake s'empare de la Jamaique et donne une base aux flibustiers à Port Royal.
1659 : En France, Mazarin crée le Conseil des prises, présidé par l'Amiral de France et de conseillers d'Etat pour gérer les prises des corsaires.
A la Tortue, le nouveau gouverneur Deschamps du Rausset, ancien lieutenant de Le Vasseur, reprend le contrôle de l’île.
Les flibustiers peuvent reprendre leur activité...Sous sa gouvernance, François Nau, dit l’Olonnais, va prendre le commandement d'un navire et devenir l'un des pirates les plus redouté des Caraibes :
1663 : Deschamps du Rausset rentre en France pour raison de santé. Il passe par Londres pour essayer de vendre son île aux Anglais…
1664 : Deschamps du Rausset est emprisonné à la Bastille, il refuse de vendre la Tortue à la nouvelle Compagnie des Indes…
Il n’en sortira que le 15 novembre pour signer l’acte de vente contre 15.000 livres tournois.
1665 : Bertrand d’Ogeron, seigneur de la Bouère, ancien flibustier, est nommé par la Compagnie des Indes gouverneur "de l'isle de la Tortue et Coste Saint Domingue".
L’île de la Tortue va rester le fief principal des flibustiers ou pirates.
Outre la course en mer pour capturer les galions espagnols, ils vont se renforcer et organiser à partir de la Tortue des expéditions contre des villes.
1666 : Le pirate François Nau et son associé Michel le Basque, à la tête de 8 navires au départ de La Tortue, attaquent et pillent la ville de Maracaïbo au Vénézuela.
Après d'autres campagnes de pillage plus ou moins réussies, il s'échouera au Panama et finira 3 ans plus tard mangé en boucan par les indiens...
Dans un mémoire adressé au gouverneur anglais de St Christophe, le gouverneur Houel se plaint des prises faites par les Anglais pendant la guerre de Hollande : "Il demandera justice des incersions que fait la nation angloise tant contre les vaisseaux et barques de messierus de la compagnie que des habittans et sujet du roy très chrétien notamment de la prise du vaisseau la Fortune chargé de pétuns, sucres, passagers et autre choses de la prise d'une barque appartenant au nommé d'Orange habitant de la Martinique comme le pillage faire à celle de la Berlots par deux fois et a deux ou trois au sieur de la compagnie et encore a une conduite par Parisis appartenant à la dite compagnie "
1670 : Les vaisseaux du Roy ont du interdire l’accès de la Guadeloupe aux corsaires hollandais Constant et Marc Pitre.
1671 : Le gouverneur général De Baas écrit au Roy :
" Les flibustiers sont des gens sans ordre et sans discipline et qui ne sont capables d'aucune conduite dans l'exécution d'autant que le désir du gain les transporte à piller, bruler et presque déserter le meilleur des pays des Indiens "
1673 : Le gouverneur général De Baas réclame un contingent de flibustiers pour s'emparer de Corossol (Curacao). Des 500 hommes prévus, 300 embarquent sur l'Écueil ( !) qui s'échoue à Puerto Rico. Les Français tombés entre les mains des Espagnols sont en grande partie massacrés...
1674 : De Baas informe le ministre qu'il a été contraint de prendre dans ses propres fonds pour rembourser les frais d'un transport qu'il avait fait réaliser par un habitant de la Martinique dont la barque a été prise devant Marie-Galante :
" Que j'ay payer au nommé Robillard marchand en cette isle pour le payement d'une barque qui luy apartenoit perdue pour le service de sa majesté et ce service a esté que cette barque estant à Marie-Gallante lorsque 14 vaisseaux parurent au vent de l'isle, monsieur de Temericourt l'envoya en diligence à la Guadeloupe, pour en donner avis à monsieur Du lion et celuy ci sans perdre de temps me l'envoya en diligence croyant que les 14 voilles estoient l'armement de Flessingue (Hollandais) dont monsieur de Bellinzany nous avoit donné l'avis. Au retour que fit la barque à la Martinique à Marie Galante elle fit rencontre d'un capre holandois qui la prit, cette prise ayant esté bien vérifiée, le bourgeois m'en a demandé le payement "
1675 : Le Capitaine Morgan, redoutable pirate ou corsaire selon les époques, a été fait Chevalier par le Roi d’Angleterre Jacques II :
il est nommé gouverneur de la Jamaïque, dont il deviendra un des plus riches planteurs…
Le marquis Charles François d'Angennes devient corsaire à l'âge de 25 ans, après avoir vendu en 1674 son château et son titre à Françoise d'Aubigné, devenue Mme de Maintenon, maîtresse puis épouse de Louis XIV.
En octobre 1675, il quitte Nantes en tant que commandant de La Fontaine d'Or, 24 canons, accompagné du corsaire Bernard Lemoigne.
1676 : A la Tortue et à St Domingue, Jacques Neveu de Pouancey, neveu du gouverneur Bertrand d'Ogeron, devient gouverneur à sa suite, et entreprend dès son arrivée de désarmer les pirates, boucaniers et flibustiers et de favoriser la culture du sucre aux dépens de celle du tabac, deux ans après la création de la ferme du tabac et de la Compagnie du Sénégal.
Il déplacera la capitale de la partie française de St Domingue de la Tortue à Port de Paix dans la grande île l'année suivante.
Charles d'Angennes réunit une flotte de 10 navires et 800 flibustiers pour aller attaquer l'Isla Margerita, Trinidad et Cumana.
Lors de cette opération, le flibustier John Coxon s'est séparé de la flotte du marquis, il pille en juillet 1677 Santa Marta, et rentre avec ses associés à la Jamaïque, où il fait soumission au gouverneur Vaughan, en lui livrant l'évêque de Santa Marta qu'ils avaient fait prisonnier pour obtenir une rançon. En échange, il reçoit une amnistie.
Charles d'Angennes fera en 1678 la chasse aux flibustiers pour plaire au Roi, deviendra habitant sucrier en Martinique et même gouverneur de Marie Galante en 1679...
1679 : Le Gouverneur général De Blénac écrit au Secrétaire d'Estat à la Marine pour lui parler " des precautions qu'ont avoit pris pour les marchands contre les Corsaires " :
Il sera pendu par les espagnols à Tolède en 1527, mais cette première prise va encourager les pirates et corsaires français, avec le soutien discret de François 1er, en guerre avec Charles Quint...
1554 : Le corsaire français François Le Clerc, surnommé Jambe de Bois, pille Puerto Rico puis Santiago de Cuba.
1555 : Le corsaire français huguenot Jacques de Sores, surnommé l'Ange exterminateur, attaque La Havane avec 3 navires et 200 hommes : il pille la ville et brûle les églises...
1573 : Le corsaire français Guillaume Le Testut, huguenot de Dieppe, s’allie au corsaire anglais Francis Drake.
Au Panama, ils s’emparent d’un convoi espagnol d’or et d’argent en provenance du Pérou, Le Testut y laisse la vie...
1574 : On recense environ 60 navires armés en course, la majorité au départ de la Rochelle, où se sont réfugiés aussi des corsaires huguenots normands ainsi que des corsaires zélandais missionnés par Guillaume d'Orange Nassau, en rébellion contre Philippe II d'Espagne qui contrôle les Flandres.
1585 : Le corsaire Francis Drake part de Plymouth avec 29 navires et 2.300 hommes, il manque le convoi d'or espagnol devant Vigo, perd 300 hommes des fièvres, continue sur les Antilles, pille la capitale d'Hispaniola, Santo-Domingo puis Carthagène. Il revient en Angleterre en 1586 avec seulement 700 hommes en état de combattre...
1588 : Défaite de l'Invincible Armada de Philippe II d'Espagne, partie pour attaquer l'Angleterre d'Elisabeth Ier et rétablir le catholicisme...
1589 : Les corsaires anglais "sea dogs" sont si nombreux que la "flota" espagnole reste bloquée à La Havane...
1595 : Le corsaire Francis Drake, lors de sa dernière expédition, vient mouiller à Marie Galante avant de s’ancrer 3 jours en Guadeloupe.
1603 : Le normand Pierre Belain d'Esnambuc s'embarque à 18 ans comme matelot sur la barque Le Petit Argus au départ du Havre de Grâce pour le "Brazil et autres isles" : c'est le début de sa carrière de corsaire...
1610 : Le corsaire français Legrand rentre à Dieppe après avoir capturé un galion espagnol chargé d'or : ce succès relance une vague d’expéditions de ceux que l’on appelait les "Péroutiers", car tout l’or était censé venir du Pérou et les Antilles étaient aussi appelées "Isles du Pérou"…
1618 : Début de la guerre de Trente Ans, qui est au départ une guerre de religion qui va impliquer successivement toutes les monarchies européennes : les monarchies catholiques menées par les Habsbourg du Saint Empire Germanique et d'Espagne, soutenues par le Pape, entrent en guerre contre les monarchies qui autorisent le protestantisme luthérien ou calviniste : les Etats protestants du Saint Empire, les Provinces Unies(Hollande), les monarchies scandinaves.
La France de Louis XIII et Richelieu, bien que luttant contre ses propres protestants, redoute l'expansion des Habsbourg et va y participer à partir de 1635 avec la guerre franco-espagnole...
1623 : En janvier, le capitaine anglais Thomas Waerner arrive à St Christophe, qu'il connaissait déja en tant que corsaire, mais cette fois avec sa femme, son fils et une trentaine d'hommes dans un but de colonisation.
Ils sont bien accueillis par le chef Caraibe Tegramund. Ils plantent des vivres et du pétun (tabac).
Pierre Belain d’Esnambuc, "péroutier" ou corsaire normand, signe une charte-partie le 1er mai, avec Henry de Chantail, Jehan Le Vasseur et 51 autres marins pour armer le brigantin l’Espérance : " Pierre de Blain, écuyer, sieur d’Enambusc, capitaine et conducteur après Dieu du navire appelé l'Espérance, du port de cent tonneaux ou viron, étant de présent en ce port et Havre de Grâce, prêt à partir pour faire Dieu aidant le voyage du Pérou, Brésil et autres îles et parties de l’aval, ledit sieur d’Enambusc bercement audit navire, pour lui et les pages d’icelui, pour trois pleins tiers, les bourgeois victuailleurs pour un tiers, Henry de Chantail, écuyer, lieutenant audit navire pour un tiers et demi, Jehan Le Vasseur, enseigne…"
Ils partent du Hâvre de Grâce en décembre avec une soixantaine d’hommes.
Après une exploration en Guyane ou au Brésil, ils réalisent en fin d'année une première implantation à St Christophe et Jehan Le Vasseur - futur gouverneur de La Tortue - semble être resté sur place avec une trentaine d'hommes, majoritairement huguenots.
St Christophe n'était auparavant qu'une base de corsaires...
1625 : Les corsaires normands Bellain d'Esnambuc et Urbain de Rossey partent de Honfleur début mai sur le navire l’Espérance.
Arrivés aux Iles Caimans, dans un combat naval contre un galion espagnol de 30 canons, ils gagnent en dépit de leurs 4 canons, mais perdent un tiers de son équipage et leur brigantin ne tient plus la mer...
Ils décident de faire escale à St Christophe pour réparer où ils retrouvent la trentaine de Français, installés depuis un an, commandés par Le Vasseur, qui cultivent du pétun (tabac).
La colonisation française est lancée...
Après de nombreux aléas à St Christophe dont il est devenu le capitaine, D'Esnambuc va ensuite prendre possession de la Martinique puis de la Dominique en 1635, peu après la prise de possession de la Guadeloupe par Liénard de l’Olive et Duplessis d’Ossonville.
1627 : Richelieu, qui dirige le Conseil Du Roy depuis 3 ans, institue un Conseil de la Marine, qui entre-autres gère les prises des corsaires.
Début de la guerre franco-anglaise dans le cadre de la guerre de Trente Ans : les Anglais soutiennent les huguenots français, leur tentative de débarquement à l'île de Ré sera un échec et il n'arriveront pas à faire lever le siège de La Rochelle, un Traité avec la France sera signé en 1629;
1635 : La Compagnie de St Christophe est devenue la Compagnie des Isles d'Amérique.
Début de la guerre franco-espagnole, toujours dans le cadre de la guerre de Trente Ans...
Les corsaires dunkerquois - Dunkerque est alors espagnole - capturent un navire de la Compagnie de retour de St Christophe, chargé de pétun, mais aussi de documents confidentiels : craignant de ce fait une attaque de l'isle, les associés de la Compagnie des Isles d'Amérique décident d'envoyer "au plus tôt ...une barque d'avis " et de l'armement à D'Esnambuc :
" Le dit Berruyer a dit avoir fait avertir messieurs les associés qui sont à présent en cette ville pour leur faire savoir qu’il a eu avis de Dieppe par le sieur Manicher, commis de la dite Compagnie, que le navire commandé par Richer, revenant de Saint-Christophe chargé de pétun, avait été pris par les Dunkerquois, et que par lettres écrites de l’isle Saint-Christophe au dit sieur du Herteley par le sieur Gentil, commis de la Compagnie, on lui donnait avis que le vaisseau dudit Richer apportait à la Compagnie le mémoire au vrai des Français qui étaient à Saint-Christophe, de leur qualité, des armes qu’il y avait, et de l’état des forts et de ce qu’il était nécessaire de leur envoyer pour la défense et conservation de ladite île, que ces mémoires étant vus à Dunkerque, il était à croire qu’on ne manquerait pas d’y donner avis en Espagne, ce qui pourrait faire penser à surprendre ladite isle en sachant les défauts, que cette affaire méritait d’y donner ordre au plus tôt leur donnant avis de se prendre garde et leur envoyant des armes et munitions. L’affaire mise en délibération, a été résolu d’envoyer au plus tôt en l’île Saint-Christophe une barque d’avis pour les avertir de se tenir sur leurs gardes et de leur envoyer par même moyen cent mousquets avec les bandoulières et fourchettes, deux cents piques, vingt-quatre hallebardes, six cents de mèche, un millier de poudre, savoir cinq cents de poudre à canon et cinq cents de poudre à mousquet, mille livres de plomb, savoir cinq cents livres en balle et cinq cents livres en saumon, et quelques moules pour faire les balles."
D'Esnambuc va décéder l'année suivante à 51 ans.
1641 : Le Commandeur de l'Ordre de Malte, Chevalier de Jérusalem, Philippe Blondel de Lonvilliers, seigneur de Poincy, a été choisi en 1638 par la Compagnie des Isles d'Amérique pour succéder à Belain d'Esnambuc comme Capitaine général : il a pris sa charge à St Christophe en 1639, modifiée par Richelieu, en tant que "Gouverneur et Lieutenant Général de sa Majesté pour toutes les Isles de l’Amérique".
De Poincy nomme gouverneur le huguenot (protestant) Le Vasseur, qui avait initié la 1ère implantation française à St Christophe, et l’envoie prendre possession de l'île de la Tortue, déjà occupée par des flibustiers et boucaniers, mais sous occupation anglaise.
Le Vasseur débarque avec 40 autres protestants chez les flibustiers, en recrute 50 majoritairement protestants et chasse les Anglais. De Poincy avait réussi de ce fait à se débarrasser à St Christophe de presque tous les protestants...
La Tortue offrait déjà un port naturel : ingénieur militaire de formation, Le Vasseur va le fortifier en faisant construire le Fort de la Roche.
1643 : Les Espagnols essayent de reprendre la Tortue, se heurtent aux nouvelles fortifications et laissent 200 morts sur le terrain...
1648 : Fin de la guerre de Trente Ans par le Traité de Whesphalie
1652 : A la Tortue, place forte des flibustiers, la gouvernance du huguenot Le Vasseur, avec de lourds impôts et une persécution contre les catholiques, a soulevé beaucoup de monde contre lui : il est victime d’un complot et assassiné par ses lieutenants Martin et Thibault…Timoléon Hotman, seigneur de Fontenay, le remplace en fin d’année avec l’appui de De Poincy.
1653 : Hotman de Fontenay envoie cette année 22 bâtiments armés en course sur les Grandes Antilles, Campêche et le Honduras
1654 : Les Espagnols ne supportent plus les expéditions des flibustiers - piratas - au départ de l'île de la Tortue : la flotte espagnole de Don Gabriel Rozas de Valle Figueroa reprend l’île et en chasse le gouverneur De Fontenay.
1657 : Après avoir échoué à prendre Hispaniola aux Espagnols, l'amiral anglais Blake s'empare de la Jamaique et donne une base aux flibustiers à Port Royal.
1659 : En France, Mazarin crée le Conseil des prises, présidé par l'Amiral de France et de conseillers d'Etat pour gérer les prises des corsaires.
A la Tortue, le nouveau gouverneur Deschamps du Rausset, ancien lieutenant de Le Vasseur, reprend le contrôle de l’île.
Les flibustiers peuvent reprendre leur activité...Sous sa gouvernance, François Nau, dit l’Olonnais, va prendre le commandement d'un navire et devenir l'un des pirates les plus redouté des Caraibes :
1663 : Deschamps du Rausset rentre en France pour raison de santé. Il passe par Londres pour essayer de vendre son île aux Anglais…
1664 : Deschamps du Rausset est emprisonné à la Bastille, il refuse de vendre la Tortue à la nouvelle Compagnie des Indes…
Il n’en sortira que le 15 novembre pour signer l’acte de vente contre 15.000 livres tournois.
1665 : Bertrand d’Ogeron, seigneur de la Bouère, ancien flibustier, est nommé par la Compagnie des Indes gouverneur "de l'isle de la Tortue et Coste Saint Domingue".
L’île de la Tortue va rester le fief principal des flibustiers ou pirates.
Outre la course en mer pour capturer les galions espagnols, ils vont se renforcer et organiser à partir de la Tortue des expéditions contre des villes.
1666 : Le pirate François Nau et son associé Michel le Basque, à la tête de 8 navires au départ de La Tortue, attaquent et pillent la ville de Maracaïbo au Vénézuela.
Après d'autres campagnes de pillage plus ou moins réussies, il s'échouera au Panama et finira 3 ans plus tard mangé en boucan par les indiens...
Dans un mémoire adressé au gouverneur anglais de St Christophe, le gouverneur Houel se plaint des prises faites par les Anglais pendant la guerre de Hollande : "Il demandera justice des incersions que fait la nation angloise tant contre les vaisseaux et barques de messierus de la compagnie que des habittans et sujet du roy très chrétien notamment de la prise du vaisseau la Fortune chargé de pétuns, sucres, passagers et autre choses de la prise d'une barque appartenant au nommé d'Orange habitant de la Martinique comme le pillage faire à celle de la Berlots par deux fois et a deux ou trois au sieur de la compagnie et encore a une conduite par Parisis appartenant à la dite compagnie "
1670 : Les vaisseaux du Roy ont du interdire l’accès de la Guadeloupe aux corsaires hollandais Constant et Marc Pitre.
1671 : Le gouverneur général De Baas écrit au Roy :
" Les flibustiers sont des gens sans ordre et sans discipline et qui ne sont capables d'aucune conduite dans l'exécution d'autant que le désir du gain les transporte à piller, bruler et presque déserter le meilleur des pays des Indiens "
1673 : Le gouverneur général De Baas réclame un contingent de flibustiers pour s'emparer de Corossol (Curacao). Des 500 hommes prévus, 300 embarquent sur l'Écueil ( !) qui s'échoue à Puerto Rico. Les Français tombés entre les mains des Espagnols sont en grande partie massacrés...
1674 : De Baas informe le ministre qu'il a été contraint de prendre dans ses propres fonds pour rembourser les frais d'un transport qu'il avait fait réaliser par un habitant de la Martinique dont la barque a été prise devant Marie-Galante :
" Que j'ay payer au nommé Robillard marchand en cette isle pour le payement d'une barque qui luy apartenoit perdue pour le service de sa majesté et ce service a esté que cette barque estant à Marie-Gallante lorsque 14 vaisseaux parurent au vent de l'isle, monsieur de Temericourt l'envoya en diligence à la Guadeloupe, pour en donner avis à monsieur Du lion et celuy ci sans perdre de temps me l'envoya en diligence croyant que les 14 voilles estoient l'armement de Flessingue (Hollandais) dont monsieur de Bellinzany nous avoit donné l'avis. Au retour que fit la barque à la Martinique à Marie Galante elle fit rencontre d'un capre holandois qui la prit, cette prise ayant esté bien vérifiée, le bourgeois m'en a demandé le payement "
1675 : Le Capitaine Morgan, redoutable pirate ou corsaire selon les époques, a été fait Chevalier par le Roi d’Angleterre Jacques II :
il est nommé gouverneur de la Jamaïque, dont il deviendra un des plus riches planteurs…
Le marquis Charles François d'Angennes devient corsaire à l'âge de 25 ans, après avoir vendu en 1674 son château et son titre à Françoise d'Aubigné, devenue Mme de Maintenon, maîtresse puis épouse de Louis XIV.
En octobre 1675, il quitte Nantes en tant que commandant de La Fontaine d'Or, 24 canons, accompagné du corsaire Bernard Lemoigne.
1676 : A la Tortue et à St Domingue, Jacques Neveu de Pouancey, neveu du gouverneur Bertrand d'Ogeron, devient gouverneur à sa suite, et entreprend dès son arrivée de désarmer les pirates, boucaniers et flibustiers et de favoriser la culture du sucre aux dépens de celle du tabac, deux ans après la création de la ferme du tabac et de la Compagnie du Sénégal.
Il déplacera la capitale de la partie française de St Domingue de la Tortue à Port de Paix dans la grande île l'année suivante.
Charles d'Angennes réunit une flotte de 10 navires et 800 flibustiers pour aller attaquer l'Isla Margerita, Trinidad et Cumana.
Lors de cette opération, le flibustier John Coxon s'est séparé de la flotte du marquis, il pille en juillet 1677 Santa Marta, et rentre avec ses associés à la Jamaïque, où il fait soumission au gouverneur Vaughan, en lui livrant l'évêque de Santa Marta qu'ils avaient fait prisonnier pour obtenir une rançon. En échange, il reçoit une amnistie.
Charles d'Angennes fera en 1678 la chasse aux flibustiers pour plaire au Roi, deviendra habitant sucrier en Martinique et même gouverneur de Marie Galante en 1679...
1679 : Le Gouverneur général De Blénac écrit au Secrétaire d'Estat à la Marine pour lui parler " des precautions qu'ont avoit pris pour les marchands contre les Corsaires " :
" Il a demandé aux vaisseaux marchands de se tennir sur leurs gardes, de saprocher des batteries des forts pour se garantir"...
1683 : Le forban flamand Laurens de Graaf, les français Grammont et Tristan, associés au hollandais Van Horn, partis de la Tortue avec 1200 hommes, attaquent et pillent Vera Cruz.
1685 : Les flibustiers français sont au sommet de leur puissance, avec 1.875 hommes pour 17 navires dont 2 de plus de 50 canons.
1688 : Une charte-partie est signée entre le Capitaine Charpin, associé au forban Laurens de Graaf, et son équipage :
" M. Charpin, commandant la Sainte-Rose, et son équipage qui sont convenus entre eux de lui donner dix lots pour lui, que pour son commandement et pour son navire.
Tous les bâtiments pris en mer ou à l'ancre portant huniers qui ne se donneront point voyage; les bâtiments seront brûlés et les agrès seront pour le bâtiment de guerre.
Tous les bâtiments pris, le capitaine aura le choix; et le non-choix demeurera à l'équipage sans que le capitaine y puisse rien prétendre.
Le capitaine se réserve ses chaudières et son canot de guerre; et les chaudières qui seront prises seront pour l'équipage.
Tous bâtiments pris hors de la portée du canon avec les canots de guerre seront pillage. Tous ballots entamés entre deux ponts ou au fond de cale, pillage.
Or, argent, perle, diamant, musc, ambre, civette et toutes sortes de pierreries, pillage.
Celui qui aura la vue des bâtiments aura 100 pièces de 8 si la prise est de valeur ou double pillage.
Tout homme estropié au service du bâtiment aura 600 pièces de 8 ou 6 nègres a choix s'il s'en prend.
Tout homme convaincu de lâcheté perdra son voyage.
Tout homme faisant faux serment et convaincu de vol perdra son voyage et sera dégradé sur la première caye.
Tout canot de guerre qui sortira en course qui prendra au-dessus de 500 pièces sera pour l'équipage dudit canot.
Tous nègres et autres esclaves qui seront pris par le canot reviendront au pied du mât.
Pour les Espagnols qui ne seront point guéris, étant arrivé en lieu, l'équipage s'oblige de donner une pièce de 8 pour lesdits malades pour le chirurgien par jour l'espace de 3 mois étant arrivé à terre.
M. de La Borderie et M. Jocom se sont obligés de servir l'équipage de tout ce qui leur sera nécessaire pendant le voyage; et l'équipage s'oblige de leur donner 180 pièces de 8 pour leur coffre; et ceux des chirurgiens qui seront pris avec les instruments qui ne seront point garnis d'argent seront pour le chirurgien.
Ladite charte ne pourra se casser ni annuler que nous n'ayons fait voyage tous ensemble.
Fait à l'île à Vache, ancré et affourché le 18 de février 1688.
Ainsi signé : Jean Charpin et Mathurin Desmarestz, quartier-maître de l'équipage."
En décembre, 2 corsaires de " Biscaye " (donc de Bayonne), après avoir attaqué St Christophe, la Grenade et la Dominique, pillent les Saintes.
Le gouverneur Hincelin écrit : " Les Sainctes ont esté pillés huit jours apres mes ordres donnez pour faire bonne garde "
1689 : Le gouverneur de la Guadeloupe Hinselin écrit le 1er janvier : " De la Grenade ces navires sont venus terrir sous Dominique ou ayant pris environ vingt négres de la Martinique des ouvriers françois et deux mulatres créoles de cette isle ils ont obligé ces derniers de les mener dans les Saintes ou avec deux barques qu'ils detacherent ils ont mis soixante hommes à terre une heure devant le jour "
Le gouverneur général, le comte de Blénac écrit : " Sa majesté estant informée que quelques corsaires et capitaines de vaisseaux armez en course qui ont abordé aux isles françoises de l‟Amérique ont embarqué pour renforcer leur equipage plusieurs habitants dont la pluspart estant chargé de dettes se sont servi de cette occasion pour le dispenser de les payer ce qui peut dans la suite causer un préjudice en une diminution considérable aux colonies".
Le Roi prend en réponse une Ordonnance qui "fais deffense à tous Capitaines d'embarquer aucun habitant des Isles sans la permission du Gouverneur"
1683 : Le forban flamand Laurens de Graaf, les français Grammont et Tristan, associés au hollandais Van Horn, partis de la Tortue avec 1200 hommes, attaquent et pillent Vera Cruz.
1685 : Les flibustiers français sont au sommet de leur puissance, avec 1.875 hommes pour 17 navires dont 2 de plus de 50 canons.
1688 : Une charte-partie est signée entre le Capitaine Charpin, associé au forban Laurens de Graaf, et son équipage :
" M. Charpin, commandant la Sainte-Rose, et son équipage qui sont convenus entre eux de lui donner dix lots pour lui, que pour son commandement et pour son navire.
Tous les bâtiments pris en mer ou à l'ancre portant huniers qui ne se donneront point voyage; les bâtiments seront brûlés et les agrès seront pour le bâtiment de guerre.
Tous les bâtiments pris, le capitaine aura le choix; et le non-choix demeurera à l'équipage sans que le capitaine y puisse rien prétendre.
Le capitaine se réserve ses chaudières et son canot de guerre; et les chaudières qui seront prises seront pour l'équipage.
Tous bâtiments pris hors de la portée du canon avec les canots de guerre seront pillage. Tous ballots entamés entre deux ponts ou au fond de cale, pillage.
Or, argent, perle, diamant, musc, ambre, civette et toutes sortes de pierreries, pillage.
Celui qui aura la vue des bâtiments aura 100 pièces de 8 si la prise est de valeur ou double pillage.
Tout homme estropié au service du bâtiment aura 600 pièces de 8 ou 6 nègres a choix s'il s'en prend.
Tout homme convaincu de lâcheté perdra son voyage.
Tout homme faisant faux serment et convaincu de vol perdra son voyage et sera dégradé sur la première caye.
Tout canot de guerre qui sortira en course qui prendra au-dessus de 500 pièces sera pour l'équipage dudit canot.
Tous nègres et autres esclaves qui seront pris par le canot reviendront au pied du mât.
Pour les Espagnols qui ne seront point guéris, étant arrivé en lieu, l'équipage s'oblige de donner une pièce de 8 pour lesdits malades pour le chirurgien par jour l'espace de 3 mois étant arrivé à terre.
M. de La Borderie et M. Jocom se sont obligés de servir l'équipage de tout ce qui leur sera nécessaire pendant le voyage; et l'équipage s'oblige de leur donner 180 pièces de 8 pour leur coffre; et ceux des chirurgiens qui seront pris avec les instruments qui ne seront point garnis d'argent seront pour le chirurgien.
Ladite charte ne pourra se casser ni annuler que nous n'ayons fait voyage tous ensemble.
Fait à l'île à Vache, ancré et affourché le 18 de février 1688.
Ainsi signé : Jean Charpin et Mathurin Desmarestz, quartier-maître de l'équipage."
En décembre, 2 corsaires de " Biscaye " (donc de Bayonne), après avoir attaqué St Christophe, la Grenade et la Dominique, pillent les Saintes.
Le gouverneur Hincelin écrit : " Les Sainctes ont esté pillés huit jours apres mes ordres donnez pour faire bonne garde "
1689 : Le gouverneur de la Guadeloupe Hinselin écrit le 1er janvier : " De la Grenade ces navires sont venus terrir sous Dominique ou ayant pris environ vingt négres de la Martinique des ouvriers françois et deux mulatres créoles de cette isle ils ont obligé ces derniers de les mener dans les Saintes ou avec deux barques qu'ils detacherent ils ont mis soixante hommes à terre une heure devant le jour "
Le gouverneur général, le comte de Blénac écrit : " Sa majesté estant informée que quelques corsaires et capitaines de vaisseaux armez en course qui ont abordé aux isles françoises de l‟Amérique ont embarqué pour renforcer leur equipage plusieurs habitants dont la pluspart estant chargé de dettes se sont servi de cette occasion pour le dispenser de les payer ce qui peut dans la suite causer un préjudice en une diminution considérable aux colonies".
Le Roi prend en réponse une Ordonnance qui "fais deffense à tous Capitaines d'embarquer aucun habitant des Isles sans la permission du Gouverneur"
1690 : L'intendant général Dumaitz écrit : " Monsieur Auger demanda du secours et que je propose d'y convoyer des vaisseaux ainsy ces philibustiers ne couroient aucun risque de perdre leur temps n'y leur armement et auroient fortifié cette isle non seulement par le nombre qu'ils auroient augmenté des combattant mais encore par la prevention que les anglois ont de leur bravoure qui n'est pourtant pas de mieux fondées "
" Celuy qui est à la teste des cent quatre-vingt philibustiers demandé par monsieur de Guitaud nommé Desmaretz estant entièrement dévoué à sieur le comte de Blenac et parmy ce nombre de philibustiers y ayant aussy plus de trente hommes creols de la dite isle de Saint-Christophe qui auroient eté capables dans la veue de secourir leur famille et défendre leur biens "
" Le 8 de may le sieur de Gemosat escrivit a monsieur le comte de Blénac qu'un habitant de la Gardeloupe que les anglois avoient pris à Mariegalante et renvoyé icy avec d'autres de cette isle disoit que dans le temps qu'il estoit prisonnier les anglois luy avoient leu une lettre qu'un nommé de Louvre de la Gardeloupe leur avoit ecrit qu'il n'y avoit que deux milliers de poudre dans la susditte isle. Le sieur de Gémosat luy mandoit encore que le maistre de la barque que Desmaretz philibustier luy avoit envoyé pour luy apporter son dixième des prises qu'ils avoient faittes enlevoit plusieurs habitants"...
Il est probable que le "philibustier" Desmaretz ait été le descendant du Louis Desmaretz recensé en 1666 à Marie-Galante, et donc une branche de la famille ira s'installer à St Martin...
1692 : Du Casse est nommé gouverneur de St Domingue, dont il reprend le contrôle après la défaite face aux espagnols l'année pécédente. Sous sa gouvernance, l'île va passer en 4 ans de 400 habitants portant armes à 1500 plus 1100 flibustiers, dont les capitaines Lesage, Leduc, de Brach, Godefroy, etc...
Profitant du tremblement de terre du 7 juin, les flibustiers prennent 900 noirs sur les côtes de Jamaique...
1693 : Du Casse écrit une lettre au ministre de la Marine Louis Phélypeaux de Pontchartrain : il explique qu'il ne reste plus que 70 flibustiers sur l'île de la Tortue, et qu'ils se fait fort de les sortir de leur fainéantise, pour les installer à Saint-Domingue…
Le port d'attache des flibustiers va se déplacer sur Le Petit Goâve dans la grande île de St Domingue.
Dans une lettre, l'intendant Dumaitz accuse les "philibustiers" de trop grande indépendance, ils ont donc des commissions de course, il s'agit bien de corsaires "françois"...
" Celuy qui est à la teste des cent quatre-vingt philibustiers demandé par monsieur de Guitaud nommé Desmaretz estant entièrement dévoué à sieur le comte de Blenac et parmy ce nombre de philibustiers y ayant aussy plus de trente hommes creols de la dite isle de Saint-Christophe qui auroient eté capables dans la veue de secourir leur famille et défendre leur biens "
" Le 8 de may le sieur de Gemosat escrivit a monsieur le comte de Blénac qu'un habitant de la Gardeloupe que les anglois avoient pris à Mariegalante et renvoyé icy avec d'autres de cette isle disoit que dans le temps qu'il estoit prisonnier les anglois luy avoient leu une lettre qu'un nommé de Louvre de la Gardeloupe leur avoit ecrit qu'il n'y avoit que deux milliers de poudre dans la susditte isle. Le sieur de Gémosat luy mandoit encore que le maistre de la barque que Desmaretz philibustier luy avoit envoyé pour luy apporter son dixième des prises qu'ils avoient faittes enlevoit plusieurs habitants"...
Il est probable que le "philibustier" Desmaretz ait été le descendant du Louis Desmaretz recensé en 1666 à Marie-Galante, et donc une branche de la famille ira s'installer à St Martin...
1692 : Du Casse est nommé gouverneur de St Domingue, dont il reprend le contrôle après la défaite face aux espagnols l'année pécédente. Sous sa gouvernance, l'île va passer en 4 ans de 400 habitants portant armes à 1500 plus 1100 flibustiers, dont les capitaines Lesage, Leduc, de Brach, Godefroy, etc...
Profitant du tremblement de terre du 7 juin, les flibustiers prennent 900 noirs sur les côtes de Jamaique...
1693 : Du Casse écrit une lettre au ministre de la Marine Louis Phélypeaux de Pontchartrain : il explique qu'il ne reste plus que 70 flibustiers sur l'île de la Tortue, et qu'ils se fait fort de les sortir de leur fainéantise, pour les installer à Saint-Domingue…
Le port d'attache des flibustiers va se déplacer sur Le Petit Goâve dans la grande île de St Domingue.
Dans une lettre, l'intendant Dumaitz accuse les "philibustiers" de trop grande indépendance, ils ont donc des commissions de course, il s'agit bien de corsaires "françois"...
Dans une autre lettre, il nous donne le nom de quelques corsaires français opérant aux Antilles : " Fleurisson de Bourdeaux, Guillemet de la Rochelle, Debecq et Rambalde de Nantes, lesquels se sont precaussionnez de commission en guerre pour s'exepter de partir le premier Mars avec les autres bastimens marchands mais leurs équipages estans a peine de quarante, ils ne peuvent aller faire la course qu'à la coste de Carack ou dans le golphe de la Trinité des espagnols pour y surprendre quelques barques ou brigantins qui y négocient du cacao "
1694 : L'année suivante, le même Dumaitz se plaint toujours des corsaires qui s'éloignent du lieu de leur armement, contrairement aux ordres, et sans punition pour leur désobéissance...
1694 : L'année suivante, le même Dumaitz se plaint toujours des corsaires qui s'éloignent du lieu de leur armement, contrairement aux ordres, et sans punition pour leur désobéissance...
Le gouverneur général De Blénac s'oppose à lui : " Je connus que son intention estoit d'establir les classes dans les isles pour avoir droit de former les équipages de ceux qui vont en course, à la pesche et à la chasse. Je lui dis qu‟il feroit comme il voudroit que monsieur Du Maitz par ses mauvais traitements en avoit chassé Desmaraits et Montauban armez de deux cents hommes chacun "
De Blénac nous renseigne aussi sur les corsaires de la Guadeloupe et Marie-Galande : " Cet armement estant découvert la plus grande partie ne passa pas le gros morne de la Guadeloupe quy estoit leur rendez vous car ils avoient changé celuy de Marie-Galande, ceux quy estoient sortis de la Guadeloupe y retournèrent sans aller plus loing, et la Touche, Collard et Mareschal icy, et la corvette et Pinel dans les Vierges et Saint-Thomas "
Le 8 juin, Du Casse quitte Le Petit-Goâve à St Domingue avec 22 vaisseaux et 1 500 hommes, en majorité corsaires, pour attaquer la Jamaique, d'où ils pillent 50 sucreries, ramènent de l'indigo et 3000 esclaves...
1695 : Le même De Blénac est toujours convaincu d'avoir le contrôle sur les corsaires : " Ils consistent en ce que l'usage ou il est de donner des commissions aux corsaires de cette isle qui sont tous flibustiers et les meilleurs sujets qu'il ait pour la deffence de l'isle luy donne occasion de les connoistre de les tenir en bride sous son obeissance et de disposer d'eux pour tous les services où il les croit nécessaires ne leur donnant congez que pour peu de temps comme deux mois et demy afin de les avoir souvent dans l'isle "
De Blénac sera suspecté de contrebande, suite à la saisie de documents compromettants sur un bateau ennemi capturé à St Thomas et pourrait avoir profité des prises des corsaires…Il arrivera à se disculper aux yeux du Roi avant de mourir...
Le R.P. Labat écrira plus tard : " Le jeudi quatrième de mars 1695, j'allais rendre visite à notre voisin M Pinel capitaine de flibustier, commandant une corvette de six canons appelée la Malouine ou la Volante. Il étoit arrivé la veille avec deux vaisseaux anglois qu'il avoit pris au vent de la Barbade, l'un de douze canons et l'autre de dix huit, venant à droiture d'Angleterre très richement chargé. Notre père supérieur m'arrêta pour assister à une grande messe que les flibustiers de M Pinel devoient faire chanter le jour suivant et à laquelle ils devoient communier en execution d'un voeu qu'ils avoient pris ces deux vaisseaux anglois "
1696 : Le 11 mars, dans son Estat de la Guadeloupe, le gouverneur Auger écrit : " Les cayes ou récifs qui reignent de la Grande Terre vers la Guadeloupe forment ce grand cul de sac elles ont des islets en dehors et en dedans couverts de bois où les canots d'Antigues soutenus de barque se cachent pour surprendre les establisements d'où ils enlèvent les négres "
Dans un mémoire du 16 mai, le nouvel intendant général Robert, arrivé pour remplacer Du Maitz avec le nouveau gouverneur général D'Amblimont, écrit : " Il ne sera fait aucun changement dans l'exécution de l'arrest qui establit les droits de monsieur l'amiral dans ces isles ; jusqu'à présent il a esté executé dans tout son contenu et on s'attache a limiter aux corsaires le temps de leur sorties et l'estendue de leurs croisières ; à la vérité feu monsieur de Blénac a voulu se faire payer le dixième des prises faites sous sa commission et amenées icy depuis l'arrivée et l'enregistrement du dit arrest "...
Dans un mémoire au Roi du 12 octobre, le même intendant général propose d’évacuer Marie-Galante, St Barthelemy et St Martin "ne voulant point dans l'etat ou sont les choses a l'egard de Marie-galante, St Barthelemy et St Martin, y laisser les français exposés aux insultes des ennemis, elle désire que le dit Sr d'Amblimont et luy les en fassent retirer incessement et passer aux isles…de la Guadeloupe et la Martinique, sans laisser personne dans les dittes isles, et il faut envoyer visiter de tems en tems pour savoir si les ennemis n'y avoient point quelques desseins, pour en ce cas les en chasser"…
Un "État des prises faites sur les Anglais par les corsaires de la Martinique" montre que les corsaires de la Martinique ont pris 24 navires anglais entre le 11 janvier et le 15 mai, il détaille leur chargement :
De Blénac nous renseigne aussi sur les corsaires de la Guadeloupe et Marie-Galande : " Cet armement estant découvert la plus grande partie ne passa pas le gros morne de la Guadeloupe quy estoit leur rendez vous car ils avoient changé celuy de Marie-Galande, ceux quy estoient sortis de la Guadeloupe y retournèrent sans aller plus loing, et la Touche, Collard et Mareschal icy, et la corvette et Pinel dans les Vierges et Saint-Thomas "
Le 8 juin, Du Casse quitte Le Petit-Goâve à St Domingue avec 22 vaisseaux et 1 500 hommes, en majorité corsaires, pour attaquer la Jamaique, d'où ils pillent 50 sucreries, ramènent de l'indigo et 3000 esclaves...
1695 : Le même De Blénac est toujours convaincu d'avoir le contrôle sur les corsaires : " Ils consistent en ce que l'usage ou il est de donner des commissions aux corsaires de cette isle qui sont tous flibustiers et les meilleurs sujets qu'il ait pour la deffence de l'isle luy donne occasion de les connoistre de les tenir en bride sous son obeissance et de disposer d'eux pour tous les services où il les croit nécessaires ne leur donnant congez que pour peu de temps comme deux mois et demy afin de les avoir souvent dans l'isle "
De Blénac sera suspecté de contrebande, suite à la saisie de documents compromettants sur un bateau ennemi capturé à St Thomas et pourrait avoir profité des prises des corsaires…Il arrivera à se disculper aux yeux du Roi avant de mourir...
Le R.P. Labat écrira plus tard : " Le jeudi quatrième de mars 1695, j'allais rendre visite à notre voisin M Pinel capitaine de flibustier, commandant une corvette de six canons appelée la Malouine ou la Volante. Il étoit arrivé la veille avec deux vaisseaux anglois qu'il avoit pris au vent de la Barbade, l'un de douze canons et l'autre de dix huit, venant à droiture d'Angleterre très richement chargé. Notre père supérieur m'arrêta pour assister à une grande messe que les flibustiers de M Pinel devoient faire chanter le jour suivant et à laquelle ils devoient communier en execution d'un voeu qu'ils avoient pris ces deux vaisseaux anglois "
1696 : Le 11 mars, dans son Estat de la Guadeloupe, le gouverneur Auger écrit : " Les cayes ou récifs qui reignent de la Grande Terre vers la Guadeloupe forment ce grand cul de sac elles ont des islets en dehors et en dedans couverts de bois où les canots d'Antigues soutenus de barque se cachent pour surprendre les establisements d'où ils enlèvent les négres "
Dans un mémoire du 16 mai, le nouvel intendant général Robert, arrivé pour remplacer Du Maitz avec le nouveau gouverneur général D'Amblimont, écrit : " Il ne sera fait aucun changement dans l'exécution de l'arrest qui establit les droits de monsieur l'amiral dans ces isles ; jusqu'à présent il a esté executé dans tout son contenu et on s'attache a limiter aux corsaires le temps de leur sorties et l'estendue de leurs croisières ; à la vérité feu monsieur de Blénac a voulu se faire payer le dixième des prises faites sous sa commission et amenées icy depuis l'arrivée et l'enregistrement du dit arrest "...
Dans un mémoire au Roi du 12 octobre, le même intendant général propose d’évacuer Marie-Galante, St Barthelemy et St Martin "ne voulant point dans l'etat ou sont les choses a l'egard de Marie-galante, St Barthelemy et St Martin, y laisser les français exposés aux insultes des ennemis, elle désire que le dit Sr d'Amblimont et luy les en fassent retirer incessement et passer aux isles…de la Guadeloupe et la Martinique, sans laisser personne dans les dittes isles, et il faut envoyer visiter de tems en tems pour savoir si les ennemis n'y avoient point quelques desseins, pour en ce cas les en chasser"…
Un "État des prises faites sur les Anglais par les corsaires de la Martinique" montre que les corsaires de la Martinique ont pris 24 navires anglais entre le 11 janvier et le 15 mai, il détaille leur chargement :
1697 : Le 1er avril, la flotte menée par Jean Bernard de Pointis quitte le port de Petit Goâve à Saint-Domingue et arrive en vue de Carthagène le 13 avril, avec 1 200 hommes venus de Brest, accompagnée d'environ 650 flibustiers et 400 Noirs affranchis fournis par Du Casse : le pillage de Carthagène durera 1 mois...
En moins de 10 ans, les armateurs de St Malo ont construit 17 navires corsaires, avec en moyenne 1 canon pour 10 tonneaux...
En moins de 10 ans, les armateurs de St Malo ont construit 17 navires corsaires, avec en moyenne 1 canon pour 10 tonneaux...
1698 : Le gouverneur Auger est chargé de proposer l’évacuation de Marie-Galante : il redoute que l’île devienne alors un repaire de corsaires, il préférerait qu’on la repeuple avec des engagés. Il envoie le 16 juin à l’Intendant des Isles d’Amérique, François Roger Robert, un mémoire sur les inconvénients résultant de l'abandon de cette île et les avantages de son repeuplement.
Le Roi Louis XIV réagit en autorisant un retour partiel des Marie-galantais, sous la menace d’un déplacement sur St Christophe à la moindre menace :
" Lorsque sa Majesté a fait degrader les isles de Marie galande, St Barthelemy et St Martin elle y a esté bien moins excitée par les risques que les habitans couroient d'estre enlevez par les petits corsaires ennemis, que par le desir de fortiffier les colonies de la Martinique, et de la Guadeloupe…"
" Désire que les srs. Damblimont et Robert apportent tous leurs soins pour destourner les habitants de St Martin, et de St Barthelemy d'y retourner, voulant bien que ceux de Marie galande s'y restablissent a cause de la proximité de la Guadeloupe, si cependant ils ne peuvent par toutes les considerations qu'ils marquent les en empescher absolument, son intention est qu'ils leurs declarent qu'ils n'y seront point regardez comme des colonies separées de St. Christophe, et qu'au premier evenement de guerre avec quelques unes des nations qui ont des establissements dans l'Amerique, ils en seront enlevez et transportez dans cette isle pour aider a la défendre, et ne pas rester exposez a estre insultez par les moindres corsaires qui oseront l'entreprendre. "
1699 : Un "Mémoire sur la nécessité d'Engager les forbans dans le party de la France" est présenté par le gouverneur général des Isles d'Amérique, le comte d'Amblimont : il propose de recruter les "quatre mil forbans qui tiennent la mer et se retirent dans l'isle de la Providence" (Bahamas) et de leur donner une commission pour faire la guerre aux Anglais au nom de la France...
1701 : Début de la Guerre de Succession d’Espagne : la France a mis le Bourbon Philippe V sur le trône d'Espagne, les Anglais alliés aux Hollandais et aux Autrichiens vont lui déclarer la guerre : ce sera la dernière guerre de Louis XIV.
La guerre va sortir d'Europe et va se développer aussi aux Antilles, en particuliers aux mains des corsaires...
1702 : Les corsaires de Martinique vient en aide à la Guadeloupe assiégée par les Anglais, le gouverneur général par intérim De Gabaret écrit le 22 aôut : " Nous avons de petits corsaires dans cette isle monseigneur qui ont déjà commencé à faire des prises. La première a esté une petite fregatte qui avoit aporté à la Barbade la nouvelle de la déclaration de la guerre et portoit son retournant la prise de la partie françoise de Saint-Christophe. Il y avoit dans cette frégatte environ quarante hommes qu'une de nos barques a enlevé a l'abordage. Il y a eu sept anglois tuez tous officiers et plusieurs blessé. Nos gens n'ont eu qu'un homme tué et quatre blasés. Cette action est toute des plus vigoureuses "
Le 27 septembre, le nouveau gouverneur général Machault de Belmont écrit : " Jusqu'à présent il n'y a point eu de vaisseau destiné pour rester icy ils vont tous à Saint-Domingue et nous avons le chagrin de voir des fregates angloises faire le tour de l'isle et enlever des barques sans pouvoir y remédier "
A Marie-Galante, des corsaires Anglais attaquent début octobre : ils brûlent la sucrerie et les bâtiments des De Boisseret et enlèvent " les habitans et les noirs ".
Sur ordre du gouverneur général, la plupart des habitants restants sont évacués le 15 sur la Grande Terre, avec Bonaventure de Boisfermé muté comme Commandant en Guadeloupe. Ils y resteront 3 ans, constamment menacés par la famine.
Le 25 novembre, le gouverneur Auger demande de nouveau l'établissement d'une Amirauté en Guadeloupe, qui en adjugeant les prises des corsaires de Guadeloupe permettrait d'employer les jeunes gens de l'île à la course et les retiendrait au pays, alors qu'ils partent avec les corsaires de Martinique et ne reviennent plus.
De Gabaret écrit fin novembre : " Nos flibustiers prennent toujours quelque batimants mais non comme de l'autre guerre il faut que les enemis ne navigue pas tamps car nous avons aprezant dix batimants dehors et trois ou quatre qui sortiront cette semenne, en voila un qui arrive qui amene un vesseau de deux cans tonnos venant de Londre pour la Jamaïque "
1703 : Le père Labat parle du corsaire Daniel, devenu pirate à la fin de la guerre de Succession d'Espagne :
" Nous apprimes que la barque qui nous avoit donné chasse à la Beate etoit montée par un de nos capitaines François appelé Daniel qui avoit environ quatre vingt hommes avec lui. Il avoit enlevé depuis trois mois une barque dans laquelle il y avoit quatre de ses negres. On avoit écrit à monsieur Vambel que Daniel avoit donné un de ses negres au père Lucien Carme, curé des Saintes auprés de la Guadeloupe.
Nous connoissons tous Daniel et assurement il ne nous eut fait aucun déplaisir ni à un de ses gens qui étoient de nos flibustiers, qui n'avoient pu se resoudre à se remettre au travail quand le métier de la course ne fut plus permis après la Paix de Riswick.
Cela est ordinaire dans les isles ou pour mieux dire si commun tant chez nous que chez les autres nations qu'il est comme passé en coutume "...
1704 : Le gouverneur général Machault de Bellemont écrit : " J'ay esté détaché dans une barque pour tenir croisière et de garde coste au commencement de cette guerre et escorter et convoyer les colonies de Saint Martin, de Saint Barthèlèmy, de Saint Christophe et de Marie Galante, j'estoit dans l'action qui se passe dans l'isle de la Dominique pendant tout un jour en convoyant monsieur de Boisfermé contre deux corsaires anglois de 12 et 8 canons "
1706 : Le même gouverneur général exprime les craintes des habitants : " Comme depuis le départ de l'escadre de monsieur d'Iberville les ennemis commancent à faire des courses frequentes sur les batimens de sa majesté même avec succez prenant de temps en temps des barques qui naviguent d'une isle à l'autre en sorte que les commercants estant d'autant plus intimidés "
L'intendant Mithon de Senneville, neveu du corsaire Charles d'Angennes, écrit dans un mémoire :
" Ces flibustiers sont au nombre de 1200 à 1300 composé de trois sortes de gens, la première de jeunes gens du pays qui veullent aller eprouver leur valeur et se faire estimer mais ce n'est que la moinde partie de la flibuste, les autres sont de pauvres habitants et artisans du pays libertins et des engagers qui ne veullent point s'assujettir au travail et aiment mieux aller tenter fortune au péril de leur vie, les matelots deserters des vaisseaux marchands font la troisième partie et je crois la plus forte de la flibuste, quelque soin que l'on prenne pour les découvrir et pour les en punir ils se déguisent, changent de nom et nous trompent, il est difficile de remédier a cet acte aucun de ces flibustiers n'étant enregistrez ;
le seul moyen d'y parvenir seroit d'obliger tous les dits flibustiers de venir prendre des bilets du commandant pour faire la course en deffendant aux capitaines d'en prendre aucun sans billet ; on les assujetiroient insensiblement et ne formeroit comme des classes.
Cette discipline seroit très avantageuses aux isles, on viendroit a bout de scavoir ou les prendre quand on en a besoin et il y auroit bien moins de deserteurs ce n'est pourtant pas un grand mal qu'il y ay de ces deserteurs, les isles s'en trouvent fortiffiées mais il en faut empêcher l'excez "...
1708 : Le 20 février, un navire marchand chargé et en partance pour la France est capturé par 2 corsaires anglais.
En effet, les corsaires anglais croisent sous le vent de la Guadeloupe, interdisant en particulier tout commerce avec la Martinique : le gouverneur Cloche de la Malmaison réclame la présence de vaisseaux du Roi pour leur donner la chasse.
A Marie-Galante, nouvelle attaque de l’île par un corsaire anglais avec la complicité d’un habitant, Louis Duval, dans une lettre du 30 mars, Mr de la Malmaison écrit : " Un corsaire anglois fit descente en l'isle de Marie Galante au quartier du Vieux Fort conduit par un fugitif de cette isle qui s'estoit quelque jours avant retiré en l'isle de Montsara ... ils ont pris trois barques marchandes allant et venant et enlevé environ soixante tete de neigre "
1710 : Le gouverneur De Gabaret écrit le 14 octobre : " Un de nos bateaux corsaires nommé le Dangereux commandé par le nommé du Moulin appris le 20° d'aoust dernier un bateau corsaire anglois dans lequel il y avoit 34 hommes et 4 canons et la conduit icy …
Le 10° septembre le Ruby batteau corsaire monté par Du Plessis et le batteau la Mignone monté par Clergeau ont pris un autre batteau corsaire anglois de 24 hommes et 4 canons et l'ont conduit icy pareillement "
Le même écrit dans un mémoire depuis la Martinique le 12 décembre : " Il y a dans la dite isle environ 1000 à 1200 flibustiers qui ne sont point compris dans les recensements et sur lesquels cependant l'on peut compter tant pour le nombre que pour une action étant tous gens aggueris et desquels on peut se servir utilement dans les occasions "
" A l'égard des flibustiers, lorsque l'on s'en sert l'on en forme des compagnies qui sont commandées par les capitaines corsaires si l'on se servait de tous et en corps il faudrait de nécessité un officier major pour les commander et être à leur tête pour les contenir faute de quoi il serait difficile de le tenir dans l'obéissance si cependant on les séparait en quatre corps de 300 chacun supposé qu'ils fussent 1200, l'on s'en servirait merveilleusement bien dans les occasions pour attaquer ou soutenir un choc et surtout étant soutenu par les troupes et milices qui les obligeraient de se rallier s'ils étaient obliger de plier "
" Pendant la guerre une grande partie des marchands et négociants arment des batiments de toute espéce pour faire la course et qui y fait rester nombre de flibustiers et matelots et d'autres ont des barques ou autres batiments qui naviguent dans les autres ports et rades tant de la dite isle que des autres isles françoises et espagnoles "
1711 : Le gouverneur général Phélypeaux du Verger raconte les mésaventures de son arrivée : " La justice veut que je vous dise en passant qu'arrivant icy deux pataches angloises le chassèrent et qu'en nous voyant l'acculèrent dans une de nos ances où ils le combattirent longtenps , Elias s'y comporti avec tant d'habileté et de courage qu'après trois heures de combat les pataches furent obligées de se retirer et de le laisser sans qu'il ne souffre aucun dommage "
1713 : Fin de la guerre de Succession d'Esapgne par le Traité d'Utrecht.
Phélypeaux déplore la fin de la course après le rétablissement de la paix :
"Les marchands et les flibustiers sont très faché de cette paix et je crois que de ces derniers plus de deux milles sont partis d'icy pour aller chercher fortunes, n'emportant pas un sol car se sont des gens qui ne savent que jouer et boire dans les cabarets tout ce qu'ils ont gangé dès qu'ils l'ont reçu. Les marchands sont faché de la paix par un autre principe, race de juifs qui n'ont dattachement pour le bien à l'extrême vexation d'autruit, pendant la guerre achetoit en gros les prises ansy que les cargaisons de France pour mettre tout en magasin fermé jusqu'à l'extrême disette les faisant vendre à prix excessif "
1717 : Le célèbre pirate anglais Edward Teach, plus connu sous le nom de "Barbe-Noire", capture le 28 septembre le négrier nantais La Concorde près de la Martinique : il renomme le navire Queen Anne’s Revenge, quitte l’équipage du forban Benjamin Hornigold, et entame une carrière personnelle de pirate.
Quelques jours plus tard, le 9 décembre, après quelques prises dans les Grenadines, il s’attaque à un navire marchand chargé de sucre, la Ville-de-Nantes, au mouillage près de Vieux-Habitants, en Guadeloupe. L’équipage parvient à se sauver à terre, mais un mousse, resté à bord, est enlevé par les pirates.
Ne s’attardant pas en Guadeloupe, "Barbe-Noire" préfère poursuivre ses attaques plus au nord, dans les Grandes Antilles ou sur la côte nord-américaine.
1718 : Le gouverneur De Feuquières envoie Mr de Buttet avec son escadre croiser contre les navires de commerce interlope.
Le 18 février, alors qu'il rentre de la Dominique, " il remonta au vent et gagna Mariegalande ou...il arresta quatre batteaux anglois qu'il trouva mouillés, dans tous lesquels s'estant trouvé des denrées angloises et françoises "...
La guerre va sortir d'Europe et va se développer aussi aux Antilles, en particuliers aux mains des corsaires...
1702 : Les corsaires de Martinique vient en aide à la Guadeloupe assiégée par les Anglais, le gouverneur général par intérim De Gabaret écrit le 22 aôut : " Nous avons de petits corsaires dans cette isle monseigneur qui ont déjà commencé à faire des prises. La première a esté une petite fregatte qui avoit aporté à la Barbade la nouvelle de la déclaration de la guerre et portoit son retournant la prise de la partie françoise de Saint-Christophe. Il y avoit dans cette frégatte environ quarante hommes qu'une de nos barques a enlevé a l'abordage. Il y a eu sept anglois tuez tous officiers et plusieurs blessé. Nos gens n'ont eu qu'un homme tué et quatre blasés. Cette action est toute des plus vigoureuses "
Le 27 septembre, le nouveau gouverneur général Machault de Belmont écrit : " Jusqu'à présent il n'y a point eu de vaisseau destiné pour rester icy ils vont tous à Saint-Domingue et nous avons le chagrin de voir des fregates angloises faire le tour de l'isle et enlever des barques sans pouvoir y remédier "
A Marie-Galante, des corsaires Anglais attaquent début octobre : ils brûlent la sucrerie et les bâtiments des De Boisseret et enlèvent " les habitans et les noirs ".
Sur ordre du gouverneur général, la plupart des habitants restants sont évacués le 15 sur la Grande Terre, avec Bonaventure de Boisfermé muté comme Commandant en Guadeloupe. Ils y resteront 3 ans, constamment menacés par la famine.
Le 25 novembre, le gouverneur Auger demande de nouveau l'établissement d'une Amirauté en Guadeloupe, qui en adjugeant les prises des corsaires de Guadeloupe permettrait d'employer les jeunes gens de l'île à la course et les retiendrait au pays, alors qu'ils partent avec les corsaires de Martinique et ne reviennent plus.
De Gabaret écrit fin novembre : " Nos flibustiers prennent toujours quelque batimants mais non comme de l'autre guerre il faut que les enemis ne navigue pas tamps car nous avons aprezant dix batimants dehors et trois ou quatre qui sortiront cette semenne, en voila un qui arrive qui amene un vesseau de deux cans tonnos venant de Londre pour la Jamaïque "
1703 : Le père Labat parle du corsaire Daniel, devenu pirate à la fin de la guerre de Succession d'Espagne :
" Nous apprimes que la barque qui nous avoit donné chasse à la Beate etoit montée par un de nos capitaines François appelé Daniel qui avoit environ quatre vingt hommes avec lui. Il avoit enlevé depuis trois mois une barque dans laquelle il y avoit quatre de ses negres. On avoit écrit à monsieur Vambel que Daniel avoit donné un de ses negres au père Lucien Carme, curé des Saintes auprés de la Guadeloupe.
Nous connoissons tous Daniel et assurement il ne nous eut fait aucun déplaisir ni à un de ses gens qui étoient de nos flibustiers, qui n'avoient pu se resoudre à se remettre au travail quand le métier de la course ne fut plus permis après la Paix de Riswick.
Cela est ordinaire dans les isles ou pour mieux dire si commun tant chez nous que chez les autres nations qu'il est comme passé en coutume "...
1704 : Le gouverneur général Machault de Bellemont écrit : " J'ay esté détaché dans une barque pour tenir croisière et de garde coste au commencement de cette guerre et escorter et convoyer les colonies de Saint Martin, de Saint Barthèlèmy, de Saint Christophe et de Marie Galante, j'estoit dans l'action qui se passe dans l'isle de la Dominique pendant tout un jour en convoyant monsieur de Boisfermé contre deux corsaires anglois de 12 et 8 canons "
1706 : Le même gouverneur général exprime les craintes des habitants : " Comme depuis le départ de l'escadre de monsieur d'Iberville les ennemis commancent à faire des courses frequentes sur les batimens de sa majesté même avec succez prenant de temps en temps des barques qui naviguent d'une isle à l'autre en sorte que les commercants estant d'autant plus intimidés "
L'intendant Mithon de Senneville, neveu du corsaire Charles d'Angennes, écrit dans un mémoire :
" Ces flibustiers sont au nombre de 1200 à 1300 composé de trois sortes de gens, la première de jeunes gens du pays qui veullent aller eprouver leur valeur et se faire estimer mais ce n'est que la moinde partie de la flibuste, les autres sont de pauvres habitants et artisans du pays libertins et des engagers qui ne veullent point s'assujettir au travail et aiment mieux aller tenter fortune au péril de leur vie, les matelots deserters des vaisseaux marchands font la troisième partie et je crois la plus forte de la flibuste, quelque soin que l'on prenne pour les découvrir et pour les en punir ils se déguisent, changent de nom et nous trompent, il est difficile de remédier a cet acte aucun de ces flibustiers n'étant enregistrez ;
le seul moyen d'y parvenir seroit d'obliger tous les dits flibustiers de venir prendre des bilets du commandant pour faire la course en deffendant aux capitaines d'en prendre aucun sans billet ; on les assujetiroient insensiblement et ne formeroit comme des classes.
Cette discipline seroit très avantageuses aux isles, on viendroit a bout de scavoir ou les prendre quand on en a besoin et il y auroit bien moins de deserteurs ce n'est pourtant pas un grand mal qu'il y ay de ces deserteurs, les isles s'en trouvent fortiffiées mais il en faut empêcher l'excez "...
1708 : Le 20 février, un navire marchand chargé et en partance pour la France est capturé par 2 corsaires anglais.
En effet, les corsaires anglais croisent sous le vent de la Guadeloupe, interdisant en particulier tout commerce avec la Martinique : le gouverneur Cloche de la Malmaison réclame la présence de vaisseaux du Roi pour leur donner la chasse.
A Marie-Galante, nouvelle attaque de l’île par un corsaire anglais avec la complicité d’un habitant, Louis Duval, dans une lettre du 30 mars, Mr de la Malmaison écrit : " Un corsaire anglois fit descente en l'isle de Marie Galante au quartier du Vieux Fort conduit par un fugitif de cette isle qui s'estoit quelque jours avant retiré en l'isle de Montsara ... ils ont pris trois barques marchandes allant et venant et enlevé environ soixante tete de neigre "
1710 : Le gouverneur De Gabaret écrit le 14 octobre : " Un de nos bateaux corsaires nommé le Dangereux commandé par le nommé du Moulin appris le 20° d'aoust dernier un bateau corsaire anglois dans lequel il y avoit 34 hommes et 4 canons et la conduit icy …
Le 10° septembre le Ruby batteau corsaire monté par Du Plessis et le batteau la Mignone monté par Clergeau ont pris un autre batteau corsaire anglois de 24 hommes et 4 canons et l'ont conduit icy pareillement "
Le même écrit dans un mémoire depuis la Martinique le 12 décembre : " Il y a dans la dite isle environ 1000 à 1200 flibustiers qui ne sont point compris dans les recensements et sur lesquels cependant l'on peut compter tant pour le nombre que pour une action étant tous gens aggueris et desquels on peut se servir utilement dans les occasions "
" A l'égard des flibustiers, lorsque l'on s'en sert l'on en forme des compagnies qui sont commandées par les capitaines corsaires si l'on se servait de tous et en corps il faudrait de nécessité un officier major pour les commander et être à leur tête pour les contenir faute de quoi il serait difficile de le tenir dans l'obéissance si cependant on les séparait en quatre corps de 300 chacun supposé qu'ils fussent 1200, l'on s'en servirait merveilleusement bien dans les occasions pour attaquer ou soutenir un choc et surtout étant soutenu par les troupes et milices qui les obligeraient de se rallier s'ils étaient obliger de plier "
" Pendant la guerre une grande partie des marchands et négociants arment des batiments de toute espéce pour faire la course et qui y fait rester nombre de flibustiers et matelots et d'autres ont des barques ou autres batiments qui naviguent dans les autres ports et rades tant de la dite isle que des autres isles françoises et espagnoles "
1711 : Le gouverneur général Phélypeaux du Verger raconte les mésaventures de son arrivée : " La justice veut que je vous dise en passant qu'arrivant icy deux pataches angloises le chassèrent et qu'en nous voyant l'acculèrent dans une de nos ances où ils le combattirent longtenps , Elias s'y comporti avec tant d'habileté et de courage qu'après trois heures de combat les pataches furent obligées de se retirer et de le laisser sans qu'il ne souffre aucun dommage "
1713 : Fin de la guerre de Succession d'Esapgne par le Traité d'Utrecht.
Phélypeaux déplore la fin de la course après le rétablissement de la paix :
"Les marchands et les flibustiers sont très faché de cette paix et je crois que de ces derniers plus de deux milles sont partis d'icy pour aller chercher fortunes, n'emportant pas un sol car se sont des gens qui ne savent que jouer et boire dans les cabarets tout ce qu'ils ont gangé dès qu'ils l'ont reçu. Les marchands sont faché de la paix par un autre principe, race de juifs qui n'ont dattachement pour le bien à l'extrême vexation d'autruit, pendant la guerre achetoit en gros les prises ansy que les cargaisons de France pour mettre tout en magasin fermé jusqu'à l'extrême disette les faisant vendre à prix excessif "
1717 : Le célèbre pirate anglais Edward Teach, plus connu sous le nom de "Barbe-Noire", capture le 28 septembre le négrier nantais La Concorde près de la Martinique : il renomme le navire Queen Anne’s Revenge, quitte l’équipage du forban Benjamin Hornigold, et entame une carrière personnelle de pirate.
Quelques jours plus tard, le 9 décembre, après quelques prises dans les Grenadines, il s’attaque à un navire marchand chargé de sucre, la Ville-de-Nantes, au mouillage près de Vieux-Habitants, en Guadeloupe. L’équipage parvient à se sauver à terre, mais un mousse, resté à bord, est enlevé par les pirates.
Ne s’attardant pas en Guadeloupe, "Barbe-Noire" préfère poursuivre ses attaques plus au nord, dans les Grandes Antilles ou sur la côte nord-américaine.
1718 : Le gouverneur De Feuquières envoie Mr de Buttet avec son escadre croiser contre les navires de commerce interlope.
Le 18 février, alors qu'il rentre de la Dominique, " il remonta au vent et gagna Mariegalande ou...il arresta quatre batteaux anglois qu'il trouva mouillés, dans tous lesquels s'estant trouvé des denrées angloises et françoises "...
1719 : Les forbans sévissent aussi sur les navires négriers pendant leur traite, tel Le Victorieux, capitaine Guillaume Hays.
Parti de Nantes le 31 décembre 1718, il arrive sur les côtes africaines le 22 mars.
A Juda, le 22 juin, le navire est attaqué par des forbans, qui ont déjà pris 3 Portugais, 1 Anglais, 1 Français de La Rochelle ; le navire s’échappe, puis revient. Une nouvelle alerte lui fait battre " la mer pendant 5 jours " puis il revient encore.
L’équipage est malade, " attaqué de fièvre et de scorbut ". A l’île du Prince, le gouverneur accepte de fournir un équipage en complément, s’ils acceptent d’aller au Brésil.
Le navire part avec un navire portugais. Le 7 octobre 1719, il est pris par les forbans en mer, près d’Annabon ; ceux-ci donnent l'Héroïne et 90 Noirs " qui restaient encore à bord du Victorieux, venant de sa traite " ; 30 ou 40 autres Noirs sont " repris à terre, exténués ". Les forbans ont remis 141 Noirs de la cargaison à un Anglais, mais celui-ci en rend 35.
Le bâtiment anglais Bristol, avec 200 Noirs, est également pris par les forbans près d’Annabon, puis la Reine Indienne, de Londres, capitaine Hill, à Angole.
Les forbans déposent au Cap de Lopes 400 ou 500 nègres captifs, qui sont " ramassés et enlevés par les nègres du pays " et en donnent 141 au capitaine Hill.
Au Surinam, le capitaine Hays en est réduit à affrèter un navire anglais, le Christian, de Boston pour aller porter 60 Noirs à la Martinique. Le navire y arrive le 12 mars 1720 avec seulement 52 esclaves...
Sur un équipage de 99 hommes pour ce navire de 250 tonneaux, 57 sont morts pendant ces 13 mois de commerce triangulaire perturbé par les forbans...
En Martinique, le gouverneur général de Feuquières envoie le 30 avril un Mémoire au Conseil de Marine :
" pour asseurer la navigation des costes des isles du Vent contre les corsaires forbans et les fraudeurs " , il réclame une frégate de 20 à 24 canons pour surveillance et intervention...
Parti de Nantes le 31 décembre 1718, il arrive sur les côtes africaines le 22 mars.
A Juda, le 22 juin, le navire est attaqué par des forbans, qui ont déjà pris 3 Portugais, 1 Anglais, 1 Français de La Rochelle ; le navire s’échappe, puis revient. Une nouvelle alerte lui fait battre " la mer pendant 5 jours " puis il revient encore.
L’équipage est malade, " attaqué de fièvre et de scorbut ". A l’île du Prince, le gouverneur accepte de fournir un équipage en complément, s’ils acceptent d’aller au Brésil.
Le navire part avec un navire portugais. Le 7 octobre 1719, il est pris par les forbans en mer, près d’Annabon ; ceux-ci donnent l'Héroïne et 90 Noirs " qui restaient encore à bord du Victorieux, venant de sa traite " ; 30 ou 40 autres Noirs sont " repris à terre, exténués ". Les forbans ont remis 141 Noirs de la cargaison à un Anglais, mais celui-ci en rend 35.
Le bâtiment anglais Bristol, avec 200 Noirs, est également pris par les forbans près d’Annabon, puis la Reine Indienne, de Londres, capitaine Hill, à Angole.
Les forbans déposent au Cap de Lopes 400 ou 500 nègres captifs, qui sont " ramassés et enlevés par les nègres du pays " et en donnent 141 au capitaine Hill.
Au Surinam, le capitaine Hays en est réduit à affrèter un navire anglais, le Christian, de Boston pour aller porter 60 Noirs à la Martinique. Le navire y arrive le 12 mars 1720 avec seulement 52 esclaves...
Sur un équipage de 99 hommes pour ce navire de 250 tonneaux, 57 sont morts pendant ces 13 mois de commerce triangulaire perturbé par les forbans...
En Martinique, le gouverneur général de Feuquières envoie le 30 avril un Mémoire au Conseil de Marine :
" pour asseurer la navigation des costes des isles du Vent contre les corsaires forbans et les fraudeurs " , il réclame une frégate de 20 à 24 canons pour surveillance et intervention...
1720 : Le 5 mars, le pirate Bartholomew Roberts pille le naivre Bon-Pasteur, qui vient de quitter Sainte-Anne en Guadeloupe et enlève le chirurgien du bord.
Roberts va provoquer aussi de l’insécurité aux alentours de Marie-Galante :
Entre le 4 et le 12 octobre, il prend ainsi "un petit vaisseau et deux bateaux... ils ont même exercé leurs cruautés à l’égard du maître d’un de ces bateaux auquel ils ont coupé une oreille...qu’ils ont attaché au mât de leur vaisseau".
Le 12 octobre, Roberts prend de l’assurance : "le bateau du Roy...chassé au vent de Marie-Galante par le bateau forban qui ont caréné dans l’île de Cariacou".
Le gouverneur général De Feuquières et l'intendant Bénard doivent ainsi renoncer à leur tournée à Marie-Galante et rentrent en Martinique.
Le 18 octobre, le même Roberts parvient à capturer un vaisseau marseillais à l’est de la Désirade.
Cette prise se révèle profitable pour les pirates avec une cargaison d’une valeur de "plus de 300 000 livres".
Les forbans ne sont toutefois pas intéressés par 400 barriques de sucre blancs qu’ils jettent à la mer.
Le navire "très joli, ayant une galerie à poupe, étant percé pour environ 36 canons, que l’on dit très bon voilier" séduit aussi Roberts qui le garde pour son usage et le renomme Royal Fortune.
Cette attaque se caractérise enfin par les violences exercées contre les passagers : "ils ont entre autres pendu ledit sieur Talma (directeur général du Domaine) qui a été fort près d’être étranglé... le nègre domestique dudit Talma se jeta aux pieds de ce capitaine et lui demanda en grâce... Ce capitaine brutal avait un pistolet à la main, qu’il lui tira au travers du corps. N’étant pas mort, il continua à lui demander la même grâce. Sur quoi, ce coquin de commandant continua sa brutalité, l’écharpa de cinq à six coups de sabre... Ledit sieur Talma, ayant eu le bonheur d’échapper au supplice a redemandé à ce capitaine son nègre, quoique blessé à mort, mais il ne l’a pas voulu rendre"...
1721 : Bartholomew Roberts revient dans les parages de la Guadeloupe en janvier 1721, à la tête de deux frégates et de plusieurs bateaux. Après la prise de douze navires interlopes en Dominique, les 27 et 28 janvier, il est signalé dans le canal des Saintes au matin du 31 janvier.
Par des tirs d’alarme, le gouverneur de la Guadeloupe fait rassembler la milice et la cavalerie en moins d’une heure.
Il ordonne également aux navires ancrés à Basse-Terre de se rapprocher du littoral pour se mettre sous la protection du fort Saint-Charles.
Les pirates dépassent la pointe de Vieux-Fort et longent la côte en esquivant les tirs des batteries de la Rivière du Galion, des Carmes et de la Ravine à Billaud.
Au niveau de Baillif, Roberts s’attaque à un navire isolé, la Princesse de La Rochelle, que le capitaine refuse d’échouer sur la côte pour échapper aux forbans.
Hors de portée des tirs venus de la terre, Roberts pille le navire sous le regard impuissant du lieutenant du roi et de la cavalerie, qui essuient même des coups de canon de la part des pirates.
Le 16 juillet, le gouverneur de Guadeloupe ordonne ainsi desrecherches sur les " vagabonds et gens sans aveu qui y sont répandus et pourraient être soupçonnés de correspondances avec les forbans, avec injonction à tous les officiers de les arrêter "
Le 18 juillet, des Saintois découvrent un " canot en dérive où il y avait 200 livres de balles, de la poudre, quelques fusils et sabres " qui viennent des magasins du fort Louis, l’ensemble étant peut-être destiné à des forbans ou à des déserteurs souhaitant se faire pirates...
Un an après avoir été torturé par Bartholomew Roberts, le directeur général du Domaine, Talma, reconnaît parmi les marins de la flûte du Roy le Dromadaire "le forban qui lui mit la corde au col"... Dénoncé, l’ancien pirate est pendu en Guadeloupe le 3 septembre.
A Marie-Galante, le 9 octobre, Charles Brunier, marquis de Larnage, lieutenant de Roy, réclame au Conseil Supérieur : " il seroit cependant necessaire d'y establir quelques petites batteries et canons qui serviroient à rendre cette coste un peu plus respectable aux pavillons étrangers et à protèger aussy les Batiments françois contre les forbans ".
Roberts va provoquer aussi de l’insécurité aux alentours de Marie-Galante :
Entre le 4 et le 12 octobre, il prend ainsi "un petit vaisseau et deux bateaux... ils ont même exercé leurs cruautés à l’égard du maître d’un de ces bateaux auquel ils ont coupé une oreille...qu’ils ont attaché au mât de leur vaisseau".
Le 12 octobre, Roberts prend de l’assurance : "le bateau du Roy...chassé au vent de Marie-Galante par le bateau forban qui ont caréné dans l’île de Cariacou".
Le gouverneur général De Feuquières et l'intendant Bénard doivent ainsi renoncer à leur tournée à Marie-Galante et rentrent en Martinique.
Le 18 octobre, le même Roberts parvient à capturer un vaisseau marseillais à l’est de la Désirade.
Cette prise se révèle profitable pour les pirates avec une cargaison d’une valeur de "plus de 300 000 livres".
Les forbans ne sont toutefois pas intéressés par 400 barriques de sucre blancs qu’ils jettent à la mer.
Le navire "très joli, ayant une galerie à poupe, étant percé pour environ 36 canons, que l’on dit très bon voilier" séduit aussi Roberts qui le garde pour son usage et le renomme Royal Fortune.
Cette attaque se caractérise enfin par les violences exercées contre les passagers : "ils ont entre autres pendu ledit sieur Talma (directeur général du Domaine) qui a été fort près d’être étranglé... le nègre domestique dudit Talma se jeta aux pieds de ce capitaine et lui demanda en grâce... Ce capitaine brutal avait un pistolet à la main, qu’il lui tira au travers du corps. N’étant pas mort, il continua à lui demander la même grâce. Sur quoi, ce coquin de commandant continua sa brutalité, l’écharpa de cinq à six coups de sabre... Ledit sieur Talma, ayant eu le bonheur d’échapper au supplice a redemandé à ce capitaine son nègre, quoique blessé à mort, mais il ne l’a pas voulu rendre"...
1721 : Bartholomew Roberts revient dans les parages de la Guadeloupe en janvier 1721, à la tête de deux frégates et de plusieurs bateaux. Après la prise de douze navires interlopes en Dominique, les 27 et 28 janvier, il est signalé dans le canal des Saintes au matin du 31 janvier.
Par des tirs d’alarme, le gouverneur de la Guadeloupe fait rassembler la milice et la cavalerie en moins d’une heure.
Il ordonne également aux navires ancrés à Basse-Terre de se rapprocher du littoral pour se mettre sous la protection du fort Saint-Charles.
Les pirates dépassent la pointe de Vieux-Fort et longent la côte en esquivant les tirs des batteries de la Rivière du Galion, des Carmes et de la Ravine à Billaud.
Au niveau de Baillif, Roberts s’attaque à un navire isolé, la Princesse de La Rochelle, que le capitaine refuse d’échouer sur la côte pour échapper aux forbans.
Hors de portée des tirs venus de la terre, Roberts pille le navire sous le regard impuissant du lieutenant du roi et de la cavalerie, qui essuient même des coups de canon de la part des pirates.
Le 16 juillet, le gouverneur de Guadeloupe ordonne ainsi desrecherches sur les " vagabonds et gens sans aveu qui y sont répandus et pourraient être soupçonnés de correspondances avec les forbans, avec injonction à tous les officiers de les arrêter "
Le 18 juillet, des Saintois découvrent un " canot en dérive où il y avait 200 livres de balles, de la poudre, quelques fusils et sabres " qui viennent des magasins du fort Louis, l’ensemble étant peut-être destiné à des forbans ou à des déserteurs souhaitant se faire pirates...
Un an après avoir été torturé par Bartholomew Roberts, le directeur général du Domaine, Talma, reconnaît parmi les marins de la flûte du Roy le Dromadaire "le forban qui lui mit la corde au col"... Dénoncé, l’ancien pirate est pendu en Guadeloupe le 3 septembre.
A Marie-Galante, le 9 octobre, Charles Brunier, marquis de Larnage, lieutenant de Roy, réclame au Conseil Supérieur : " il seroit cependant necessaire d'y establir quelques petites batteries et canons qui serviroient à rendre cette coste un peu plus respectable aux pavillons étrangers et à protèger aussy les Batiments françois contre les forbans ".
Le 19 octobre, le pirate malouin Chemineau tente de prendre un petit navire marchand entre Baillif et Vieux-Habitants, mais une frégate de 14 canons, la Vénus, vient à son secours.
Après un échange de coups de canons et de fusils, les pirates parviennent à s’échapper mais, quelques heures plus tard, ils sont rattrapés par le Griffon, un vaisseau de 44 canons.
Après un nouvel échange de tirs, le vent tombe et immobilise les deux navires : à la faveur de la nuit, Chemineau, qui dispose d’avirons, parvient à s’enfuir en direction de la Dominique...
Révélant son impuissance, le capitaine du Griffon reconnait " avec chagrin l’extrême supériorité de voile qu’ont les bateaux sur des vaisseaux vieux carénés ; je crois même devoir dire au Conseil que les meilleurs vaisseaux sont peu propres à cette guerre"...
Le 23 octobre, Chemineau capture et coule près de la Dominique un navire saintois qui se rendait en Guadeloupe "avec des sommes considérables ".
Début novembre, il pille un autre navire de Guadeloupe. En inspectant sa prise, "comme la coutume de ces forbans est de voir toutes les lettres qui leur tombent en main pour savoir ce qui se passe ", le pirate trouve un courrier envoyé par un garde-magasin de Guadeloupe à l’intendant des Îles du Vent, dans lequel est abordé le combat contre la Vénus et le Griffon.
Dans une démarche impertinente, Chemineau écrit alors à son tour une lettre à l’intendant afin de lui annoncer qu’il aurait capturé la Vénus si le Griffon n’était pas venu à son secours !
On décide d'armer une frégate de St Domingue, Le Chasseur, commandée par le sieur Buttet pour leur faire la chasse.
Le 20 novembre, le gouverneur de Guadeloupe décide de participer à la poursuite de Chemineau en accompagnant Le Chasseur, qui pourchasse déjà le pirate depuis plusieurs semaines.
Un navire est armé en moins d’une journée avec une quinzaine de soldats et une cinquantaine d’habitants, difficilement rassemblés. Le gouverneur précise à ce sujet : " j’ai été obligé de donner jusqu’à mon maître d’hôtel, c’est une pitié que de commander de la milice "...
On envoie contre ces navires forbans un autre navire de Sète, Les Estats du Languedoc, capitaine Borde, puis 2 bateaux de 50 tonneaux armés à St Pierre de la Martinique, commandés par les capitaines Sinson et La Chassagne...
Malgré tout, en 18 mois, les forbans, en particulier Durand, Laubé et Chemineau, "ont pris, bruslés, coulé à fond ou pillé plus de cinquante vaisseaux ou autres batimens"..."ces voleurs des mer ayant fait aux habitans de ces Colonies ou aux negociants francois pour plus de trois millions de tort"...
Ils se servent de la Dominique comme base arrière, avec la complicité de Français installés dans l'île.
Après un échange de coups de canons et de fusils, les pirates parviennent à s’échapper mais, quelques heures plus tard, ils sont rattrapés par le Griffon, un vaisseau de 44 canons.
Après un nouvel échange de tirs, le vent tombe et immobilise les deux navires : à la faveur de la nuit, Chemineau, qui dispose d’avirons, parvient à s’enfuir en direction de la Dominique...
Révélant son impuissance, le capitaine du Griffon reconnait " avec chagrin l’extrême supériorité de voile qu’ont les bateaux sur des vaisseaux vieux carénés ; je crois même devoir dire au Conseil que les meilleurs vaisseaux sont peu propres à cette guerre"...
Le 23 octobre, Chemineau capture et coule près de la Dominique un navire saintois qui se rendait en Guadeloupe "avec des sommes considérables ".
Début novembre, il pille un autre navire de Guadeloupe. En inspectant sa prise, "comme la coutume de ces forbans est de voir toutes les lettres qui leur tombent en main pour savoir ce qui se passe ", le pirate trouve un courrier envoyé par un garde-magasin de Guadeloupe à l’intendant des Îles du Vent, dans lequel est abordé le combat contre la Vénus et le Griffon.
Dans une démarche impertinente, Chemineau écrit alors à son tour une lettre à l’intendant afin de lui annoncer qu’il aurait capturé la Vénus si le Griffon n’était pas venu à son secours !
On décide d'armer une frégate de St Domingue, Le Chasseur, commandée par le sieur Buttet pour leur faire la chasse.
Le 20 novembre, le gouverneur de Guadeloupe décide de participer à la poursuite de Chemineau en accompagnant Le Chasseur, qui pourchasse déjà le pirate depuis plusieurs semaines.
Un navire est armé en moins d’une journée avec une quinzaine de soldats et une cinquantaine d’habitants, difficilement rassemblés. Le gouverneur précise à ce sujet : " j’ai été obligé de donner jusqu’à mon maître d’hôtel, c’est une pitié que de commander de la milice "...
On envoie contre ces navires forbans un autre navire de Sète, Les Estats du Languedoc, capitaine Borde, puis 2 bateaux de 50 tonneaux armés à St Pierre de la Martinique, commandés par les capitaines Sinson et La Chassagne...
Malgré tout, en 18 mois, les forbans, en particulier Durand, Laubé et Chemineau, "ont pris, bruslés, coulé à fond ou pillé plus de cinquante vaisseaux ou autres batimens"..."ces voleurs des mer ayant fait aux habitans de ces Colonies ou aux negociants francois pour plus de trois millions de tort"...
Ils se servent de la Dominique comme base arrière, avec la complicité de Français installés dans l'île.
Le Conseil Supérieur condamne à mort le pirate Vraye, de l'équipage de Roberts, qui est pendu en Guadeloupe.
Le 30 décembre, l’intendant des Îles du Vent se plaint des vagabonds « qui rôdent perpétuellement dans ces îles, y naviguant comme bon leur semble, sans permission...les forbans y ont des correspondances et y font des recrues ; et l’on instruit actuellement le procès d’un soldat déserteur quiconvient d’avoir correspondu avec le nommé Chemineau d’en avoir reçu une somme assez considérable... et de les avoir avertis des armements que nous faisions ici contre eux. Il y en a nombre d’autres mais il n’est pas aisé de les connaître "
1722 : A la demande du gouverneur général de Feuquières, le Conseil de Marine suspend en janvier l’envoi de galériens dans les îles : " Beaucoup de scélérats et de fripons n’étant point accoutumés au travail prennent le parti de se faire forbans, ce qui leur est fort facile, y ayant toujours des navires forbans sur les costes de nos isles "
A Marie-Galante, fin février, le gouverneur général Feuquières et l’intendant Bénard font enfin leur tournée avec le marquis de Champigny, devenu gouverneur de la Martinique. Ils font le 4 mars un rapport sur l’état de l’île :
"Ils ont visité le fort, le Bourg et 3 lieues de la plus belle coste du monde qui s’étend depuis le dit Bourg jusqu’à St Louis ou est l’habitation de M. de Champigny"
"C’est de ce costé seul que cette isle est insultée, car tout le reste du contour est deffendu par des cayes"
"Cette Isle ne devroit pas être abandonnée comme elle l’est. La terre y est très bonne, y ayant vu de fort belles cannes, les bestiaux y viennent bien et si elle n’est guère peuplée d’habitants, c’est l’aprehension continuelle qu’ils ont d’estre pillés par les forbans ou par les ennemis en temps de guerre"...
En mai, le gouverneur général et l'intendant informent le Conseil de Marine de l'envoi de 2 navires contre les forbans : "le St André est party avec la Victoire pour Tabac (Tobago) ou les forbans vont ordinairement carenner."
1722 : A la demande du gouverneur général de Feuquières, le Conseil de Marine suspend en janvier l’envoi de galériens dans les îles : " Beaucoup de scélérats et de fripons n’étant point accoutumés au travail prennent le parti de se faire forbans, ce qui leur est fort facile, y ayant toujours des navires forbans sur les costes de nos isles "
A Marie-Galante, fin février, le gouverneur général Feuquières et l’intendant Bénard font enfin leur tournée avec le marquis de Champigny, devenu gouverneur de la Martinique. Ils font le 4 mars un rapport sur l’état de l’île :
"Ils ont visité le fort, le Bourg et 3 lieues de la plus belle coste du monde qui s’étend depuis le dit Bourg jusqu’à St Louis ou est l’habitation de M. de Champigny"
"C’est de ce costé seul que cette isle est insultée, car tout le reste du contour est deffendu par des cayes"
"Cette Isle ne devroit pas être abandonnée comme elle l’est. La terre y est très bonne, y ayant vu de fort belles cannes, les bestiaux y viennent bien et si elle n’est guère peuplée d’habitants, c’est l’aprehension continuelle qu’ils ont d’estre pillés par les forbans ou par les ennemis en temps de guerre"...
En mai, le gouverneur général et l'intendant informent le Conseil de Marine de l'envoi de 2 navires contre les forbans : "le St André est party avec la Victoire pour Tabac (Tobago) ou les forbans vont ordinairement carenner."
A Marie Galante, fin septembre, le gouverneur général, le marquis de Feuquières, exauce les demandes faites lors de la visite de l’intendant général : il demande 6 canons de 8 pour la batterie du Bourg " mettant le port du dit bourg et les troupes à couvert de toute surprise, empescheront aussi la désertion et le commerce estranger qui pourroit s’y faire ".
La demande sera validée par le Conseil de Marine " avec des munitions et ustenciles pour tirer 100 coups de canon par pièce ". Ils arriveront effectivement en juillet suivant avec leurs munitions...
Le 24 décembre, les autorités découvrent qu’un habitant des Saintes, nommé Tite, commerce avec des pirates en Dominique, il est arrêté et pendu en Guadeloupe.
Aux Antilles, au moins 1.000 pirates et flibustiers ont été en activité entre 1715 et 1726, il semble que 25 à 30 % d’entre eux étaient noirs. Ni la race, ni la nationalité ne sont mentionnées dans la charte d’aucun équipage. Les hommes noirs reçoivent leur part du butin et jouissent des mêmes avantages que les autres membres d’équipage, y compris du droit de vote. Récompenses et encouragements sont distribués selon les capacités de l’individu à fonctionner efficacement au sein de la communauté pirate plutôt que selon la couleur de sa peau. Il semble que le pont des navires pirates ait été le premier lieu de liberté des Noirs au sein du monde blanc du XVIIIème siècle...
La demande sera validée par le Conseil de Marine " avec des munitions et ustenciles pour tirer 100 coups de canon par pièce ". Ils arriveront effectivement en juillet suivant avec leurs munitions...
Le 24 décembre, les autorités découvrent qu’un habitant des Saintes, nommé Tite, commerce avec des pirates en Dominique, il est arrêté et pendu en Guadeloupe.
Aux Antilles, au moins 1.000 pirates et flibustiers ont été en activité entre 1715 et 1726, il semble que 25 à 30 % d’entre eux étaient noirs. Ni la race, ni la nationalité ne sont mentionnées dans la charte d’aucun équipage. Les hommes noirs reçoivent leur part du butin et jouissent des mêmes avantages que les autres membres d’équipage, y compris du droit de vote. Récompenses et encouragements sont distribués selon les capacités de l’individu à fonctionner efficacement au sein de la communauté pirate plutôt que selon la couleur de sa peau. Il semble que le pont des navires pirates ait été le premier lieu de liberté des Noirs au sein du monde blanc du XVIIIème siècle...
1724 : Un "Estat général de la consommation de poudre faitte dans touttes les îles françoises du Vent de l'Amérique pendant l'année 1724 suivant les estats en détail remis par chacun des gardes magasins particuliers en chacune isle" nous renseigne sur les activités festives mais aussi sur de défense de l'île : hormis les fêtes du St Sacrement, de la St Jean et de la St Louis, 13 coups de canons pour l'enterrement du lieutenant de Roy De Ravary et 9 coups de canon de 6 "tirés en différents temps sur des batteaux crus forbans ou commercants estrangers".
Le 16 juin, le gouverneur Vaultier de Moyencourt se plaint que " depuis que je suis gouverneur de la Guadeloupe, ([les pirates) m’ont volé plus de 6.000 francs en plusieurs occasions, en farine, vins et autres Nchoses nécessaires pour ma maison"...
1726 : Ordonnance du roi qui concerne "les mesures à prendre pour le développement de différents armements dans les îles du Vent en vue de la course contre les forbans" et "portant règlement sur les armements à faire aux îles du Vent afin d'équiper la course contre les forbans"
1727 : Arrivent de France, armées à St Pierre de la Martinique, 3 frégates "contre les forbans et les interlopes" : la Thétis, commandant La Jonquière, la Vénus, commandant Duquesnel et la Cupidon, commandant La Pommerel.
1728 : Thomas Dulain, parti de Bretagne comme officier de marine marchande avec son frère, a déserté en Martinique et est devenu corsaire pour les Espagnols; à la suite du meurtre de son frère, il démarre à 24 ans sa carrière de pirate sur son navire, rebaptisé le Sans Pitié, avec 120 pirates "tant blancs que noirs".
Avec sa base arrière en Dominique, en 1 an, il va faire 19 prises, dont 2 autour de la Guadeloupe, le reste autour de la Dominique, de Ste Lucie, mais aussi de Curacao et Bonaire...
Le matin du 7 septembre, au nord de la Dominique, Dulain sur son navire surprend un petit navire, l’Expédition, qui apporte du sucre de Guadeloupe à un autre navire, la Fidélité, ancré en Martinique.
Profitant d’un courant et d’un vent favorable, le Sans-Pitié rattrape rapidement sa cible et, "à une demie portée de canon", Dulain fait tirer deux coups de semonce tout en hissant son pavillon noir.
L’Expédition se rend sans résistance et amène ses voiles. Immédiatement, un officier de Dulain se rend en chaloupe à bord du navire capturé. L’équipage est maltraité à coups de sabre, sans doute pour le forcer à révéler la présence de marchandises. Le navire est ensuite pillé en l’espace de deux heures, les pirates mettant la main sur les voiles, les agrées, les apparaux, une barrique de sucre blanc, les vêtements des marins, les vivres, et surtout sur plus de 7000 livres et 1200 francs en or et en argent.
Afin que l’alarme ne soit pas donnée trop tôt, Dulain ordonne enfin au capitaine de l’Expédition de naviguer vent arrière durant deux heures, vers l’ouest, sous peine d’être coulé : effectivement, le navire sinistré est obligé de faire face au vent pour revenir en Guadeloupe et l’attaque ne sera déclarée à Basse-Terre que le lendemain...
Fin décembre, Dulain capture aussi Le Sept Frères au large de la Désirade.
1729 : Le pirate Dulain, poursuivi, se réfugie en janvier sur l'île de Tortuga (Venezuela) et écrit au gouverneur des Isles du Vent pour demander une amnistie, ci dessous sa demande de "Pardon" : "je ne suis pas né pour faire le mestier de Piratte"...
1726 : Ordonnance du roi qui concerne "les mesures à prendre pour le développement de différents armements dans les îles du Vent en vue de la course contre les forbans" et "portant règlement sur les armements à faire aux îles du Vent afin d'équiper la course contre les forbans"
1727 : Arrivent de France, armées à St Pierre de la Martinique, 3 frégates "contre les forbans et les interlopes" : la Thétis, commandant La Jonquière, la Vénus, commandant Duquesnel et la Cupidon, commandant La Pommerel.
1728 : Thomas Dulain, parti de Bretagne comme officier de marine marchande avec son frère, a déserté en Martinique et est devenu corsaire pour les Espagnols; à la suite du meurtre de son frère, il démarre à 24 ans sa carrière de pirate sur son navire, rebaptisé le Sans Pitié, avec 120 pirates "tant blancs que noirs".
Avec sa base arrière en Dominique, en 1 an, il va faire 19 prises, dont 2 autour de la Guadeloupe, le reste autour de la Dominique, de Ste Lucie, mais aussi de Curacao et Bonaire...
Le matin du 7 septembre, au nord de la Dominique, Dulain sur son navire surprend un petit navire, l’Expédition, qui apporte du sucre de Guadeloupe à un autre navire, la Fidélité, ancré en Martinique.
Profitant d’un courant et d’un vent favorable, le Sans-Pitié rattrape rapidement sa cible et, "à une demie portée de canon", Dulain fait tirer deux coups de semonce tout en hissant son pavillon noir.
L’Expédition se rend sans résistance et amène ses voiles. Immédiatement, un officier de Dulain se rend en chaloupe à bord du navire capturé. L’équipage est maltraité à coups de sabre, sans doute pour le forcer à révéler la présence de marchandises. Le navire est ensuite pillé en l’espace de deux heures, les pirates mettant la main sur les voiles, les agrées, les apparaux, une barrique de sucre blanc, les vêtements des marins, les vivres, et surtout sur plus de 7000 livres et 1200 francs en or et en argent.
Afin que l’alarme ne soit pas donnée trop tôt, Dulain ordonne enfin au capitaine de l’Expédition de naviguer vent arrière durant deux heures, vers l’ouest, sous peine d’être coulé : effectivement, le navire sinistré est obligé de faire face au vent pour revenir en Guadeloupe et l’attaque ne sera déclarée à Basse-Terre que le lendemain...
Fin décembre, Dulain capture aussi Le Sept Frères au large de la Désirade.
1729 : Le pirate Dulain, poursuivi, se réfugie en janvier sur l'île de Tortuga (Venezuela) et écrit au gouverneur des Isles du Vent pour demander une amnistie, ci dessous sa demande de "Pardon" : "je ne suis pas né pour faire le mestier de Piratte"...
Dulain, devant l'absence de réponse du gouverneur, décide de rentrer en France en abandonnant la plus grande partie de son équipage sur Tortuga, ne gardant que ses fidèles et son butin. Arrivé au Pouliguen, sa mère interviendra auprès des autorités de Nantes et obtiendra son amnistie en mars, son butin ne sera jamais retrouvé...Quelques jours plus tard, suite à un duel, il sera relégué en résidence surveillée à Pouancé et ne fera plus jamais parler de lui...
L’ingénieur Vincent Houel est missionné par le gouverneur général pour étudier et renforcer la défense de Marie-Galante Il note les emplacements des corps de garde et des batteries, en ajoutant 4 canons de 12, qui "mettroit cette isle a l’abry de l’insulte des corsaires et des forbans".
Il propose de renforcer le fort de 6.000 pieux de bois "incorruptible" de 4 pieds de long selon ses plans.
Il prévoit aussi une caserne, les hommes de troupe étant logés en divers endroits, éloignés les uns des autres, ce qui rend difficile une défense rapide en cas d’attaque.
De Poincy estime que ces travaux ne coûteront que 800 livres, "les habitans faisant le reste par mes soins et avec plaisir"...
1730 : Le gouverneur de Guadeloupe décide d’abandonner l’idée des frégates et écrit le 28 novembre : " vu les dépenses que causeraient ces armements, j’ai l’honneur... de vous proposer de faire construire ici, sans qu’il n’en coûte rien au Roi, ni pour la construction, ni pour l’entretien, deux garde-côtes faits en galères... Ces deux bâtiments feront plus d’effets que quatre vaisseaux qui ne peuvent s’approcher des côtes, ces bâtiments, en temps de paix, assureront la côte contre les incursions des pirates et, comme ils seront toujours armés, il ne sera pas difficile ... de jeter du monde dedans pour les mettre en état d’enlever les forbans "
1735 : Le 21 février, jour de Mardi-Gras, le gouverneur Robert Philippe Lonvilliers de Poincy est dérangé dans sa sieste vers 4 heures de l’après-midi par un garde du fort qui lui signale un navire de 200 tonneaux, 16 canons, longeant la caye au niveau de la Pointe des Basses.
Suivi à la longue-vue, il fait mine de rentrer dans la passe de la rade de Grand-Bourg, où se trouvait ancré un négrier de Dunkerque, le Fortune.
Accosté par un canot de ce dernier, le navire hisse ses couleurs anglaises, et demande du secours, prétextant n’avoir plus ni pain, ni eau.
Il accueille le marin avec un vin de Madère et lui emprunte son canot pour aller à terre faire sa demande au gouverneur.
Arrive devant De Poincy un jeune homme richement vêtu, qui dit aller en Virginie avec son chargement de fûts de Madère et réclame eau et pain, en expliquant s’être perdu en route du fait de son pilote et il demande un homme pour l’aider à rentrer dans la passe, vu sa méconnaissance des récifs et des courants. Le sieur Antoine Ferrère l’accompagne à bord.
Le lendemain 22, l’Anglais revient pour demander des volailles pour son épouse. De Poincy le satisfait et rajoute du lait, du vin et un mouton…
Au moment du départ, Mr du Jarrier de la Chassaigne, major de l’île l’invite à diner le soir avec son épouse et Mr et Mme Dunot de Saint Maclou, tandis que son équipage va dans une auberge de l’île.
Le lendemain 23, nouvelle invitation du gouverneur, cette fois à déjeuner avec une partie des notables, l’Anglais arrive avec des cadeaux et en fin de repas invite le gouverneur et ses hôtes à venir à son bord prendre une collation.
Le rendez vous est accepté, il désire retourner à bord pour préparer cette réception, l’interprète qui l’accompagne a le temps de glisser à De Poincy un billet : c’est un navire forban…
De Poincy arrive à faire passer le message au major et au capitaine du négrier, leur demandant de réunir des forces.
Entre-temps, il invite l’Anglais qui attendait son canot, à venir patienter à l’ombre avec un café, il est aussitôt arrêté par De Poincy, De la Chassaigne, ils arrêtent à l’arrivée du canot le lieutenant du pirate et 4 autres marins.
Reste à arraisonner le navire pirate sans qu’il s’enfuie : Mr De Poincy menace de pendaison immédiate le capitaine pirate et arrive ainsi à savoir qu’il ne reste que 9 pirates à bord.
II organise un stratagème : Ferrère rejoint le navire mouillé à la pointe Trianon, en expliquant que trop de monde veut venir à bord et qu’il faut un bateau plus grand.
Mr de Saint Maclou se présente sur le voilier Le Dauphin Mouillé avec une vingtaine d"habitans", ils montent à bord et neutralisent les 9 pirates.
Les 15 pirates et la fausse épouse sont amenés au fort et mis aux fers…
Il s’agissait d’un navire Anglais, le Sea Horse, venant de Londres, qui avait chargé à Madère et dont le contremaître avait pris le contrôle en plein Atlantique avec quelques complices, en assassinant à coups de hache le capitaine, le pilote et tous ceux qui résistaient. La fausse épouse était une passagère et l’interprète un passager pris en otage…
Le 24, le gouverneur De Poincy fait célébrer un Te Deum à l’Eglise de Notre Dame de la Conception à Grand-Bourg.
Le 26, les pirates sont transférés à St Pierre de la Martinique pour être jugés. Ils seront condamnés à mort, le passager et la passagère graciés seront envoyés à la Barbade.
L’ingénieur Vincent Houel est missionné par le gouverneur général pour étudier et renforcer la défense de Marie-Galante Il note les emplacements des corps de garde et des batteries, en ajoutant 4 canons de 12, qui "mettroit cette isle a l’abry de l’insulte des corsaires et des forbans".
Il propose de renforcer le fort de 6.000 pieux de bois "incorruptible" de 4 pieds de long selon ses plans.
Il prévoit aussi une caserne, les hommes de troupe étant logés en divers endroits, éloignés les uns des autres, ce qui rend difficile une défense rapide en cas d’attaque.
De Poincy estime que ces travaux ne coûteront que 800 livres, "les habitans faisant le reste par mes soins et avec plaisir"...
1730 : Le gouverneur de Guadeloupe décide d’abandonner l’idée des frégates et écrit le 28 novembre : " vu les dépenses que causeraient ces armements, j’ai l’honneur... de vous proposer de faire construire ici, sans qu’il n’en coûte rien au Roi, ni pour la construction, ni pour l’entretien, deux garde-côtes faits en galères... Ces deux bâtiments feront plus d’effets que quatre vaisseaux qui ne peuvent s’approcher des côtes, ces bâtiments, en temps de paix, assureront la côte contre les incursions des pirates et, comme ils seront toujours armés, il ne sera pas difficile ... de jeter du monde dedans pour les mettre en état d’enlever les forbans "
1735 : Le 21 février, jour de Mardi-Gras, le gouverneur Robert Philippe Lonvilliers de Poincy est dérangé dans sa sieste vers 4 heures de l’après-midi par un garde du fort qui lui signale un navire de 200 tonneaux, 16 canons, longeant la caye au niveau de la Pointe des Basses.
Suivi à la longue-vue, il fait mine de rentrer dans la passe de la rade de Grand-Bourg, où se trouvait ancré un négrier de Dunkerque, le Fortune.
Accosté par un canot de ce dernier, le navire hisse ses couleurs anglaises, et demande du secours, prétextant n’avoir plus ni pain, ni eau.
Il accueille le marin avec un vin de Madère et lui emprunte son canot pour aller à terre faire sa demande au gouverneur.
Arrive devant De Poincy un jeune homme richement vêtu, qui dit aller en Virginie avec son chargement de fûts de Madère et réclame eau et pain, en expliquant s’être perdu en route du fait de son pilote et il demande un homme pour l’aider à rentrer dans la passe, vu sa méconnaissance des récifs et des courants. Le sieur Antoine Ferrère l’accompagne à bord.
Le lendemain 22, l’Anglais revient pour demander des volailles pour son épouse. De Poincy le satisfait et rajoute du lait, du vin et un mouton…
Au moment du départ, Mr du Jarrier de la Chassaigne, major de l’île l’invite à diner le soir avec son épouse et Mr et Mme Dunot de Saint Maclou, tandis que son équipage va dans une auberge de l’île.
Le lendemain 23, nouvelle invitation du gouverneur, cette fois à déjeuner avec une partie des notables, l’Anglais arrive avec des cadeaux et en fin de repas invite le gouverneur et ses hôtes à venir à son bord prendre une collation.
Le rendez vous est accepté, il désire retourner à bord pour préparer cette réception, l’interprète qui l’accompagne a le temps de glisser à De Poincy un billet : c’est un navire forban…
De Poincy arrive à faire passer le message au major et au capitaine du négrier, leur demandant de réunir des forces.
Entre-temps, il invite l’Anglais qui attendait son canot, à venir patienter à l’ombre avec un café, il est aussitôt arrêté par De Poincy, De la Chassaigne, ils arrêtent à l’arrivée du canot le lieutenant du pirate et 4 autres marins.
Reste à arraisonner le navire pirate sans qu’il s’enfuie : Mr De Poincy menace de pendaison immédiate le capitaine pirate et arrive ainsi à savoir qu’il ne reste que 9 pirates à bord.
II organise un stratagème : Ferrère rejoint le navire mouillé à la pointe Trianon, en expliquant que trop de monde veut venir à bord et qu’il faut un bateau plus grand.
Mr de Saint Maclou se présente sur le voilier Le Dauphin Mouillé avec une vingtaine d"habitans", ils montent à bord et neutralisent les 9 pirates.
Les 15 pirates et la fausse épouse sont amenés au fort et mis aux fers…
Il s’agissait d’un navire Anglais, le Sea Horse, venant de Londres, qui avait chargé à Madère et dont le contremaître avait pris le contrôle en plein Atlantique avec quelques complices, en assassinant à coups de hache le capitaine, le pilote et tous ceux qui résistaient. La fausse épouse était une passagère et l’interprète un passager pris en otage…
Le 24, le gouverneur De Poincy fait célébrer un Te Deum à l’Eglise de Notre Dame de la Conception à Grand-Bourg.
Le 26, les pirates sont transférés à St Pierre de la Martinique pour être jugés. Ils seront condamnés à mort, le passager et la passagère graciés seront envoyés à la Barbade.
Le 10 juin, De Poincy demande au gouverneur général et à l’intendant une récompense pécuniaire pour Ferrère et les soldats qui ont participé à l’interception du navire forban, ainsi que pour le quartier du Vieux Fort et son église...
1738 : La corvette La Fée, commandée par le lieutenant de vaisseau De Rambures, arrive pour "détruire le commerce étranger et pour prendre les pirates espagnols" qui ont enlevé 11 navires en 3 ans...
1738 : La corvette La Fée, commandée par le lieutenant de vaisseau De Rambures, arrive pour "détruire le commerce étranger et pour prendre les pirates espagnols" qui ont enlevé 11 navires en 3 ans...
1740 : Début de la Guerre de Succession d’Autriche : La France de Louis XV, alliée à la Bavière et à la Prusse entre en guerre contre l'Autriche, alliée à l'Angleterre et aux Provinces Unies (Hollande) : la guerre en Europe va s'exporter aux Antilles et relancer la guerre de course pour tous les belligérants...
1741 : Le gouverneur général Champigny de Noroy se plaint des attaques de pirates armés par les Espagnols : 3 navires de commerce français viennent d'être pris, dont celui appartenant à Mme Le Bègue, fille de l'ancien gouverneur de Marie Galante, il négocie leur restitution avec les autorités espagnoles...
1741 : Le gouverneur général Champigny de Noroy se plaint des attaques de pirates armés par les Espagnols : 3 navires de commerce français viennent d'être pris, dont celui appartenant à Mme Le Bègue, fille de l'ancien gouverneur de Marie Galante, il négocie leur restitution avec les autorités espagnoles...
1744 : Les corsaires anglais établissent un blocus autour de la Martinique, les vivres commencent à manquer…
En parallèle, un "Etat des Batimens Anglois pris et amenés à la Martinique par les Batimens François armés en Course" montre que les corsaires français ont capturé 69 navires anglais en 1 an.
La Parfaite, capitaine Balanqué, a fait à elle-seule 10 prises et La Reale, capitaine Dailhencq, 8.
En parallèle, un "Etat des Batimens Anglois pris et amenés à la Martinique par les Batimens François armés en Course" montre que les corsaires français ont capturé 69 navires anglais en 1 an.
La Parfaite, capitaine Balanqué, a fait à elle-seule 10 prises et La Reale, capitaine Dailhencq, 8.
1745 : Le nouveau gouverneur général, Charles de Thubières de Levy de Pestel de Grimoard, marquis de Caylus, qui a pris le commandement le 9 mai, envoie une note au ministre sur la défense des Isles du Vent. Concernant Marie Galande, il écrit :
"Comme cette Isle est peu considérable par elle-même, on n’a jamais pensé à y faire des fortications. En temps de paix, on y tient un Etat Major avec une Compagnie françoise de 50 hommes, afin d’y soutenir l’établissement. Mais à l’exemple de ce qui s’étoit pratiqué dans les précédentes guerres, on a pris le parti en 1743 d’en retirer la garnison pour fortifier celle de la Grenade… Au moyen de quelques batteries et retranchements, on a mis les habitants qui composent 250 hommes de bonnes milices, en état de se deffendre contre les corsaires ennemis."
1746 : En décembre, le gouverneur général de Caylus fait rétablir la garnison que Champigny avait fait enlever, car
"il est vray que les habitans de Marie Galante etoient dans la consternation" en maintenant en place Jarrier de la Chassaigne. Il fait livrer de la poudre et des boulets et demande 6000 fusils pour les milices.
" J’ay tout lieu d’être satisfait de ceux de Mariegalante, ils se portent très bravement a la deffense de nos bateaux caboteurs dont ils ont sauvé quelque uns et je regarde cette isle comme hors d’insulte de la part d’un ou plusieurs corsaires "...
1746 : En décembre, le gouverneur général de Caylus fait rétablir la garnison que Champigny avait fait enlever, car
"il est vray que les habitans de Marie Galante etoient dans la consternation" en maintenant en place Jarrier de la Chassaigne. Il fait livrer de la poudre et des boulets et demande 6000 fusils pour les milices.
" J’ay tout lieu d’être satisfait de ceux de Mariegalante, ils se portent très bravement a la deffense de nos bateaux caboteurs dont ils ont sauvé quelque uns et je regarde cette isle comme hors d’insulte de la part d’un ou plusieurs corsaires "...
Un "État général des prises faites sur les ennemis de l'État par les corsaires de la Martinique" retrouve pour l'année 145 prises.
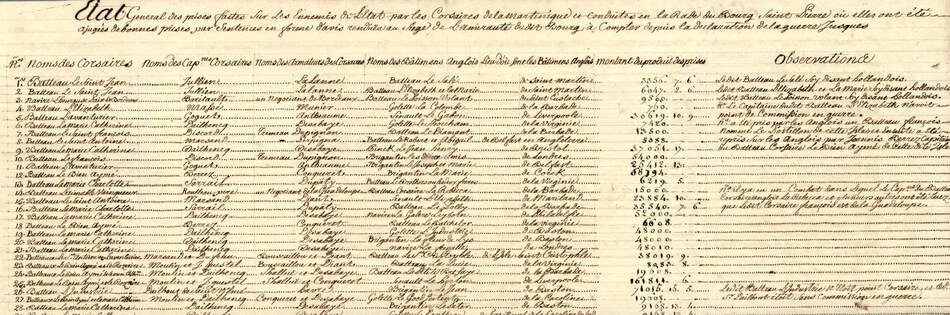
1747 : Plus aucun convoi n’arrive aux Antilles pendant l’année : la disette s’installe…
Le gouverneur général autorise des navires neutres, en particulier hollandais, à apporter des vivres.
Finalement, fin décembre, un convoi arrive à passer : 73 navires marchands atteignent la Guadeloupe ou la Martinique, 20 ont été capturés et conduits à la Barbade par les navires de guerre ou les corsaires anglais.
En parallèle, nos corsaires développent leurs activités de course aux Antilles à partir de Saint-Domingue mais surtout de la Martinique.
Entre 1744 à 1747, entre 20 et 50 corsaires martiniquais auront saisi plus de 350 navires, dont 99 prises rien qu’en 1747, gênant considérablement le commerce colonial anglais. La correspondance des gouverneurs anglais des West Indies fait part des plaintes incessantes des planteurs anglais contre les corsaires français.
Une prise un peu spéciale le 12 juillet : un navire anglais transportant 160 prisonniers écossais, accusés d’avoir pris les armes en faveur de prétendant à la Couronne Edouard et destinés à être vendus comme esclaves dans les West Indies : ils seront libérés, et 10 d’entre-eux dont 2 capitaines seront à leur demande envoyés en France.
1748 : Un "Etat des Corsaires de la Martinique actuellement existans" nous donne une liste de 28 noms de capitaines avec leur bâtiment et leur armement :
Le gouverneur général autorise des navires neutres, en particulier hollandais, à apporter des vivres.
Finalement, fin décembre, un convoi arrive à passer : 73 navires marchands atteignent la Guadeloupe ou la Martinique, 20 ont été capturés et conduits à la Barbade par les navires de guerre ou les corsaires anglais.
En parallèle, nos corsaires développent leurs activités de course aux Antilles à partir de Saint-Domingue mais surtout de la Martinique.
Entre 1744 à 1747, entre 20 et 50 corsaires martiniquais auront saisi plus de 350 navires, dont 99 prises rien qu’en 1747, gênant considérablement le commerce colonial anglais. La correspondance des gouverneurs anglais des West Indies fait part des plaintes incessantes des planteurs anglais contre les corsaires français.
Une prise un peu spéciale le 12 juillet : un navire anglais transportant 160 prisonniers écossais, accusés d’avoir pris les armes en faveur de prétendant à la Couronne Edouard et destinés à être vendus comme esclaves dans les West Indies : ils seront libérés, et 10 d’entre-eux dont 2 capitaines seront à leur demande envoyés en France.
1748 : Un "Etat des Corsaires de la Martinique actuellement existans" nous donne une liste de 28 noms de capitaines avec leur bâtiment et leur armement :
La frégate La Diane arrive de France fin mars, pour essayer de lutter contre les corsaires anglais qui ont renforcé leur blocus. Elle repartira sans avoir pu forcer le blocus...
En juillet arrive la frégate La Favorite, qui apporte la nouvelle de la suspension d’armes avec les Anglais.
Elle sera suivie de frégate La Junon, et les 2 frégates seront désormais chargées de lutter contre les forbans et le commerce interlope.
En 4 ans, les ports français ont disposé de 388 navires corsaires et ont armé en course plus de 580 expéditions, en tête Dunkerque avec 130 expéditions pour 80 navires, suivi de Bayonne avec 103 expéditions, St Malo 88, Boulogne 60, Calais 53...
Fin de la guerre de Succession d'Autriche avec le Traité d'Aix la Chapelle. La guerre de course est supposée à l'arrêt...
1756 : Début de la Guerre de Sept Ans : les Anglais se sont emparé de 300 navires marchands français avec 6000 matelots, le refus de les restituer fait rentrer la France en guerre contre l'Angleterre. La France est alliée à l'Autriche et à l'Espagne, l'Angleterre est alliée à la Prusse et à la Russie.
Encore une fois, le théatre des opérations sortira d'Europe pour se prolonger aux Antilles...
La Marine Royale française dispose de moitié moins de navires que la Royal Navy, la guerre de course va donc être privilégiée : 13 ports français vont fournir en 6 ans 750 armements en course, dont 220 pour Bayonne et 145 pour Dunkerque. L'éloignement de l'Angleterre favorise les Basques, qui échappent au blocus anglais...
L'armement en course reprend en Martinique et en Guadeloupe : 20 en Martinique et aussi 8 en Guadeloupe
En juillet arrive la frégate La Favorite, qui apporte la nouvelle de la suspension d’armes avec les Anglais.
Elle sera suivie de frégate La Junon, et les 2 frégates seront désormais chargées de lutter contre les forbans et le commerce interlope.
En 4 ans, les ports français ont disposé de 388 navires corsaires et ont armé en course plus de 580 expéditions, en tête Dunkerque avec 130 expéditions pour 80 navires, suivi de Bayonne avec 103 expéditions, St Malo 88, Boulogne 60, Calais 53...
Fin de la guerre de Succession d'Autriche avec le Traité d'Aix la Chapelle. La guerre de course est supposée à l'arrêt...
1756 : Début de la Guerre de Sept Ans : les Anglais se sont emparé de 300 navires marchands français avec 6000 matelots, le refus de les restituer fait rentrer la France en guerre contre l'Angleterre. La France est alliée à l'Autriche et à l'Espagne, l'Angleterre est alliée à la Prusse et à la Russie.
Encore une fois, le théatre des opérations sortira d'Europe pour se prolonger aux Antilles...
La Marine Royale française dispose de moitié moins de navires que la Royal Navy, la guerre de course va donc être privilégiée : 13 ports français vont fournir en 6 ans 750 armements en course, dont 220 pour Bayonne et 145 pour Dunkerque. L'éloignement de l'Angleterre favorise les Basques, qui échappent au blocus anglais...
L'armement en course reprend en Martinique et en Guadeloupe : 20 en Martinique et aussi 8 en Guadeloupe
Les corsaires Anglais capturent 350 navires marchands français autour des isles…
Les communications sont presque coupées entre les Antilles et la métropole.
Elles vont devoir tirer leur ravitaillement des îles hollandaises et espagnoles voisines.
1757 : " Le corsaire La Fripone de la Guadeloupe commandée par Saint-Sauveur partit le premier avril dernier et établit sa croisiere au vent de l'isle angloise d'Antigue. Ayant pris le 12 avril prés de l isle Saint-Barthélemy une goelette angloise, Saint-Sauveur capitaine du corsaire a donné ordre au S. Jean Lestage son second de la conduire a l'isle Saint-Thomas.
Le 14. du même mois le capitaine du corsaire y etant arrivé croyant trouver la prise dans la rade, a été fort estoné d'aprendre qu'elle avait été enlevée deux heures aprés par un brigantin corsaire anglois de St christophe capitaine Bruchmore.
Saint-Sauveur est allé tout de suite chéz le gouverneur de St Thomas demander justice d'un enlevement fait contre le droit d'azile dans un port neutre et louer son canon. Le gouverneur lui a proposé de remettre a la voile pour tacher de decouvrir ou la prise avoit eté conduitte, et le capne Saint-Sauveur ayant suivi ce conseil, l'a retrouvé a la mer ; mais elle etoit conduite par un corsaire anglois dont la superiorité a obligé Saint-Sauveur a rentrer a St Thomas.
De retour dans ce port il a renouvellé sur représentation au gouverneur de cette isle qui d abord lui a promis de lui faire remettre en represailles une prise francoise qui etoit a St Thomas dans le cas ou les Anglois ne voudraient pas rendre la sienne ; qu'en consequence il alloit expedier un battiment pour le cas ou la prise avoit eté conduitte.
Quoique ce batteau soit revenu sans la prise, le gouverneur n'a pas jugé a propos de faire delivrer celle qu il avoit promise en represaille parceque dit il, le capitaine Bruchmore avoit fait serment qu il n'avoit eu aucune connoissance de l'enlevement et qu il n etoit pas juste de lui faire suporter des pertes pour son equipage et quoique le gouverneur de St Thomas soit convenu qu il etoit persuadé que la declaration du capitaine. Bruchmore etoit fausse, il n'a pas fait rendre justice au capitaine du corsaire François."
Un "Arrest du Conseil d’État du Roy portant Règlement pour les Marchandises des Prises faites en mer sur les Ennemis de l’État" essaie de réglementer les activités des corsaires.
Les communications sont presque coupées entre les Antilles et la métropole.
Elles vont devoir tirer leur ravitaillement des îles hollandaises et espagnoles voisines.
1757 : " Le corsaire La Fripone de la Guadeloupe commandée par Saint-Sauveur partit le premier avril dernier et établit sa croisiere au vent de l'isle angloise d'Antigue. Ayant pris le 12 avril prés de l isle Saint-Barthélemy une goelette angloise, Saint-Sauveur capitaine du corsaire a donné ordre au S. Jean Lestage son second de la conduire a l'isle Saint-Thomas.
Le 14. du même mois le capitaine du corsaire y etant arrivé croyant trouver la prise dans la rade, a été fort estoné d'aprendre qu'elle avait été enlevée deux heures aprés par un brigantin corsaire anglois de St christophe capitaine Bruchmore.
Saint-Sauveur est allé tout de suite chéz le gouverneur de St Thomas demander justice d'un enlevement fait contre le droit d'azile dans un port neutre et louer son canon. Le gouverneur lui a proposé de remettre a la voile pour tacher de decouvrir ou la prise avoit eté conduitte, et le capne Saint-Sauveur ayant suivi ce conseil, l'a retrouvé a la mer ; mais elle etoit conduite par un corsaire anglois dont la superiorité a obligé Saint-Sauveur a rentrer a St Thomas.
De retour dans ce port il a renouvellé sur représentation au gouverneur de cette isle qui d abord lui a promis de lui faire remettre en represailles une prise francoise qui etoit a St Thomas dans le cas ou les Anglois ne voudraient pas rendre la sienne ; qu'en consequence il alloit expedier un battiment pour le cas ou la prise avoit eté conduitte.
Quoique ce batteau soit revenu sans la prise, le gouverneur n'a pas jugé a propos de faire delivrer celle qu il avoit promise en represaille parceque dit il, le capitaine Bruchmore avoit fait serment qu il n'avoit eu aucune connoissance de l'enlevement et qu il n etoit pas juste de lui faire suporter des pertes pour son equipage et quoique le gouverneur de St Thomas soit convenu qu il etoit persuadé que la declaration du capitaine. Bruchmore etoit fausse, il n'a pas fait rendre justice au capitaine du corsaire François."
Un "Arrest du Conseil d’État du Roy portant Règlement pour les Marchandises des Prises faites en mer sur les Ennemis de l’État" essaie de réglementer les activités des corsaires.
1758 : Le commerce triangulaire était dominant dans les ports négriers de Bordeaux, Nantes et La Rochelle, villes qui s’étaient tenues presque totalement à l’écart de la course lors du précédent conflit.
Certains armateurs, qui n’osent plus armer au commerce triangulaire devenu trop risqué, vont tenter leur chance en course.
Bordeaux va armer 54 corsaires qui feront 63 prises. Seule la course passe commande aux chantiers navals.
La vente des prises remplace en partie les importations en grande difficulté…
1763 : Le traité de Paris met fin à la guerre de Sept Ans, la France de Louis XV perd le Canada, une partie de ses îles : St Vincent, la Dominique, Grenade et Tobago.
Elle garde un comptoir de traite, Gorée, et cède St Louis du Sénégal.
1777 : La "Liste des Batimens anglais pris et conduits dans les ports français des Isles du Vent par des Corsaires amériquains" montre que nos alliés américains nous rendent service : leurs captures ont été conduites en majorité en Martinique, mais aussi 3 fois à Ste Lucie et une fois en Guadeloupe :
Certains armateurs, qui n’osent plus armer au commerce triangulaire devenu trop risqué, vont tenter leur chance en course.
Bordeaux va armer 54 corsaires qui feront 63 prises. Seule la course passe commande aux chantiers navals.
La vente des prises remplace en partie les importations en grande difficulté…
1763 : Le traité de Paris met fin à la guerre de Sept Ans, la France de Louis XV perd le Canada, une partie de ses îles : St Vincent, la Dominique, Grenade et Tobago.
Elle garde un comptoir de traite, Gorée, et cède St Louis du Sénégal.
1777 : La "Liste des Batimens anglais pris et conduits dans les ports français des Isles du Vent par des Corsaires amériquains" montre que nos alliés américains nous rendent service : leurs captures ont été conduites en majorité en Martinique, mais aussi 3 fois à Ste Lucie et une fois en Guadeloupe :
Au total entre février et juin, sur les 30 bâtiments pris, seul 1 à été conduit en Amérique du Nord, les 29 autres dans des ports des Isles du Vent. Dans leur cargaison, 2.214 esclaves et un total estimé à plus de 2 millions de livres de biens saisis...
1778 : Le Traité du 20 mars avec Benjamin Franklin nous engage à donner " assistance, faveur et protection aux Américains ".
Le 24 juin, le Roi Louis XVI fait publier une " Déclaration concernant la Course sur les Ennemis de l'Etat " qui rend solidaire les corsaires français et américains contre les Anglais :
1778 : Le Traité du 20 mars avec Benjamin Franklin nous engage à donner " assistance, faveur et protection aux Américains ".
Le 24 juin, le Roi Louis XVI fait publier une " Déclaration concernant la Course sur les Ennemis de l'Etat " qui rend solidaire les corsaires français et américains contre les Anglais :
Le 10 juillet, devant les attaques anglaises sur la flotte Royale, le Roi demande à l'Amiral son cousin de "délivrer des Commissions en Course"
En complément, le 27 septembre le Roi fait publier un "Règlement concernant les prises que des Corsaires François conduiront dans las Ports des Etats-Unis de l'Amérique et celles que les Corsaires Américains amèneront dans les Ports de France"
1779 : Le blocus de la Martinique et de la Guadeloupe par les corsaires anglais est quasi complet pendant la guerre d'Indépendance Américaine : seuls des convois protégés par une escadre arrivent à passer, c'est le cas en juillet pour 58 navires protégés par l'escadre de l'amiral Charles d'Estaing.
1780 : Nouvelle "Ordonnance du Roi concernant la Course et les Armements des Corsaires" :
1783 : A la fin de la guerre d'Indépendance des Etats Unis d'Amérique, en 5 ans de participation, les ports français ont armé 294 bateaux en course, bien moins que pendant les guerres précédentes, Dunkerque restant en tête avec 198 corsaires à lui seul...
Selon le bilan fait par le Secrétariat d'Etat à la Marine, 720 prises ont été faites, 730 rançons ont été versées, pour un total de plus de 34 millions de livres.
1794 : Victor Hugues a repris la Guadeloupe et Marie Galante aux Anglais après 6 mois de combat, les Anglais sont partis le 10 décembre.
1795 : Avec le blocus anglais, Le ravitaillement de la Guadeloupe devient problématique, Hugues et ses partisans décident d’armer des corsaires pour réintroduire des marchandises…
1796 : La Convention a démissionné, le Directoire nouvellement constitué n’a pas le temps d’envoyer de nouveaux commissaires pour la Guadeloupe : par arrêté du 26 janvier, Hugues et Lebas sont renommés Agents du Directoire pour 18 mois. Hugues,Lebas et Boudet deviennent armateurs de navires corsaires, pour nuire au commerce anglais et récupérer des marchandises qui sont revendues par leurs agences.
1797 : Par arrêté du 11 février, Hugues et Lebas prennent un arrêté qui encadre leurs activités de corsaires et autorise à attaquer aussi des bâtiments neutres.
Selon le bilan fait par le Secrétariat d'Etat à la Marine, 720 prises ont été faites, 730 rançons ont été versées, pour un total de plus de 34 millions de livres.
1794 : Victor Hugues a repris la Guadeloupe et Marie Galante aux Anglais après 6 mois de combat, les Anglais sont partis le 10 décembre.
1795 : Avec le blocus anglais, Le ravitaillement de la Guadeloupe devient problématique, Hugues et ses partisans décident d’armer des corsaires pour réintroduire des marchandises…
1796 : La Convention a démissionné, le Directoire nouvellement constitué n’a pas le temps d’envoyer de nouveaux commissaires pour la Guadeloupe : par arrêté du 26 janvier, Hugues et Lebas sont renommés Agents du Directoire pour 18 mois. Hugues,Lebas et Boudet deviennent armateurs de navires corsaires, pour nuire au commerce anglais et récupérer des marchandises qui sont revendues par leurs agences.
1797 : Par arrêté du 11 février, Hugues et Lebas prennent un arrêté qui encadre leurs activités de corsaires et autorise à attaquer aussi des bâtiments neutres.
Un tribunal dit de commerce a été créé pour statuer sur la validité des prises, tenu par 2 juges membres du Comité de surveillance révolutionnaire, Saint-Gassies et Pénicaut. Les juges ayant tendance à relâcher quelques prises, ils seront destitués et remplacés à plusieurs reprises…
1798 : Avec ses 2 beaux-frères, le genéral Paris et le genéral Boudet, Hugues a créé une Agence qui gère l’Administration des Finances, la Régie des Biens des Émigrés et l’Armement des Corsaires, profitant bien plus à lui qu’à la République…
Les Américains ne tolèrent plus les corsaires qui perturbent leur commerce et les Anglais ne supportent plus la capture de leurs vaisseaux, plus de 150 ont été pris : les nègres pris à bord sont ramenés en Guadeloupe et les denrées confisquées expédiées en France.
Ils vont à leur tour armer des corsaires qui vont s’emparer d’une bonne partie des nôtres, le ravitaillement de l’île va en souffrir…
Les plaintes contre Hugues, la suspicion de détournement de biens nationaux et la mésentente qu’il a provoquée avec les Américains finissent par se retourner contre lui : il est finalement destitué le 5 juin par le Directoire et remplacé par le Général Edmée Borne-Desfourneaux, qui s’est illustré à St Domingue, comme agent particulier du Directoire.
Avant l’arrivée de ce dernier, le Directoire prend un arrêté très clair pour empêcher les détournements à la façon de Hugues :
" Tout agent, ou tout autre délégué dans les possessions neutres pour y juger la validité des prises faites par les corsaires français, et qui serait soupçonné d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les armements en course ou en guerre et marchandises, sera immédiatement rappelé."
Victor Hugues est renoyé de force en France le 6 décembre…
En survolant simplement les chiffres, on comprend l'investissement d'Hugues dans la course :
9 corsaires guadeloupéens en 1795, 47 en 1796, 262 en 1797 et 378 en 1798...
Sainte Croix de la Roncière nous donne la liste d'une partie de ces nombreux navires corsaires :
La Révolution, La Marie, Le Vengeur, Le Sans Pareil, La Tyrannicide, La Bande Joyeuse, Le Terroriste, La Légère, Laméline, Le Poignard, Le Tom, La Guillotine, La Guadeloupéenne, L' Italie, La Conquise, La Thérèse, La Betsi, Le Midi, La Dorade, La Revanche, Le Furet, Le Flibustier, Le Prend Tout, La Carmagnole, Le Grand Décidé, Le Barcello, Le Sans Culotte, L'Arlésienne, Le Poisson Volant, Les Deux amis, La Confiance, L'Espoir, La Conquête d'Egypte, Le Mars, La Résolue, Le Bijou, La Bagareuse, L'Amour de la Patrie, L'Africaine, Le Général Masséna, L'Unique, La Sans Jupe, La Courageuse, La Friponne, Le Flambeau, La Réunion, L'Union, Le Diomède, L'Harmonie, Le Patriote, Le Ça ira, Le Napoléon, La Fraternité, Le Tigre, Le Ronflant, L'Etoile, La Jeune Adèle, La Mouche, Le Général Ernouf, La Basilic, L'Austerlitz, La Jeune Gabrielle, La Vigilante...
" Parmi les capitaines les plus connus, ceux qui ont laissé un souvenir de leurs exploits, citons : Langlois dit Jambe de Bois, Vidal, Gassin, Giraud-Lapointe, Facio, Vilac, Pierre Gros, Augustin Pillet, Ballon, Mathieu Goy, Joseph Murphy, Lamarque, Laffîte, Dubas, Christophe Chollet, Perendeaux, Petrea, le mulâtre Modeste et Antoine Fuet qui fut surnommé Capitaine Moëde , à la suite d'un combat que nous allons relater :
Il revenait d'une croisière sur son bateau La Thérèse, croisière qui avait été très fructueuse, ayant enlevé à l'ennemi, entre autres captures, une certaine quantité de petits barils pleins d'or, parmi lesquels figuraient notamment des barils de moëdes, pièce d'or portugaise.
Sur les atterrages de la Guadeloupe, un brick anglais lui barra la route. Fuet ne résistait jamais au plaisir de se mesurer avec l'Anglais, quelle que fût sa force. Malgré son infériorité, il accepte le combat.
Connaissant bien les Anglais, il savait qu'ils se cachent pendant qu'on leur tire dessus et réapparaissent dans le temps qu'on recharge les pièces. Fuet fait tirer sabord après sabord, avec un maître d'équipage allant de canon en canon pour faire le pointage.
De cette manière, les Anglais recevaient tous les boulets qui faisaient bien du vacarme et du dégât.
Trente cinq hommes à la mousqueterie avaient devant eux des piles de fusils tout chargés et faisaient un feu continu, tuant autant de monde qu'ils pouvaient. La Thérèse crachait comme une soufrière.
Vingt-cinq nègres étaient occupés à monter les boulets du magasin et à les entasser dans les caissons.
Fuet, à la barre, dirigeait la manoeuvre et c'était merveille de voir obéir le navire et éviter les bordées.
Durant sept heures, la lutte fut infernale, les deux navires étaient littéralement troués comme une écumoire, lorsque son maître canonnier vint lui dire que les boulets allaient bientôt manquer.
L'avertissement était grave. L'ennemi était là, désemparé, les voiles en pantenne, plusieurs vergues brisées.
Ce n'était pas le moment d'arrêter le combat.
Résolu à vaincre, il releva fièrement la tête et commanda : " Qu'on défonce les barils et qu'on charge les canons avec les pièces d'or et, sous cette mitraille dorée, courons à l'abordage ".
Ce qui fut fait. Jamais, depuis que la flibuste portait sous les tropiques le drapeau noir bordé d'argent, à la tête de mort, on n'avait vu un pareil combat doré.
Les nègres apportaient près de chaque sabord les barils de moëdes et les ouvraient sur le pont. A pleines pelles, les canonniers puisaient dans le tas et bourraient leurs pièces de ces écus tout reluisants qu'ils envoyaient avec des cris de joie à l'ennemi.
Les moëdes crevaient la coque du navire ennemi, décimaient les Anglais étonnés de cette pluie d'or qui emportait bras et jambes, tandis que riaient les gens de la Thérèse.
Un ordre bref et les hommes montent dans les haubans pour s'apprêter à l'abordage, les grappins accrochent l'ennemi et la lutte suprême a lieu. Tous les Anglais sont tués.
Les vainqueurs poussent alors un même cri : " Vive le capitaine Moëde! "
Antoine Fuet entra triomphalement dans la rade de la Pointe-à-Pitre, traînant à la remorque le brick de guerre anglais.
De la coque du brick capturé, on tira mille huit cent treize écus de bon aloi et les chirurgiens parvinrent à retrouver dans le corps des Anglais morts plus de trois cents autres pièces à l'effigie du roi de Portugal.
Antoine Fuet a été le premier des Corsaires sous la période de Victor Hugues et resta toujours le premier sous le Consulat et l'Empire.
Napoléon Bonaparte, dès qu'il institua, le 19 mai 1802, la Légion d'Honneur, envoya la croix de Chevalier à Antoine Fuet, le premier décoré de la Guadeloupe. "
1800 : Le 30 septembre, Napoléon signe avec les Américains le Traité de Mortefontaine pour mettre fin à la " Quasi-guerre " aux Antilles : l’activité des corsaires va être considérablement réduite…
1802 : La paix d'Amiens est signé le 27 mars avec les Anglais qui nous restitue la Martinique, Ste Lucie et Tobago. Elle sera rompue par les Anglais 13 mois plus tard...
1803 : Ernouf arrive en Guadeloupe comme gouverneur, il trouve l'île dans un état désastreux. Pour essayer de relancer l'économie, Il ordonne aux corsaires d'obliger les navires neutres à venir commercer en Guadeloupe et non pas dans les colonies voisines.
1804 : Napoléon s'est proclamé Empereur, la guerre avec les Anglais et la 3ème coalition a repris et la course aussi...
Les corsaires Français, en particulier Lamarque, Lapointe, Vidal, Grassin, etc…, redoublent d’activité contre les Anglais.
Leur base principale est Deshaies.
En 1 an, 92 navires anglais sont capturés, rapportant 2.704.000 francs ; jusqu’en 1810, 342 seront pris…
1798 : Avec ses 2 beaux-frères, le genéral Paris et le genéral Boudet, Hugues a créé une Agence qui gère l’Administration des Finances, la Régie des Biens des Émigrés et l’Armement des Corsaires, profitant bien plus à lui qu’à la République…
Les Américains ne tolèrent plus les corsaires qui perturbent leur commerce et les Anglais ne supportent plus la capture de leurs vaisseaux, plus de 150 ont été pris : les nègres pris à bord sont ramenés en Guadeloupe et les denrées confisquées expédiées en France.
Ils vont à leur tour armer des corsaires qui vont s’emparer d’une bonne partie des nôtres, le ravitaillement de l’île va en souffrir…
Les plaintes contre Hugues, la suspicion de détournement de biens nationaux et la mésentente qu’il a provoquée avec les Américains finissent par se retourner contre lui : il est finalement destitué le 5 juin par le Directoire et remplacé par le Général Edmée Borne-Desfourneaux, qui s’est illustré à St Domingue, comme agent particulier du Directoire.
Avant l’arrivée de ce dernier, le Directoire prend un arrêté très clair pour empêcher les détournements à la façon de Hugues :
" Tout agent, ou tout autre délégué dans les possessions neutres pour y juger la validité des prises faites par les corsaires français, et qui serait soupçonné d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les armements en course ou en guerre et marchandises, sera immédiatement rappelé."
Victor Hugues est renoyé de force en France le 6 décembre…
En survolant simplement les chiffres, on comprend l'investissement d'Hugues dans la course :
9 corsaires guadeloupéens en 1795, 47 en 1796, 262 en 1797 et 378 en 1798...
Sainte Croix de la Roncière nous donne la liste d'une partie de ces nombreux navires corsaires :
La Révolution, La Marie, Le Vengeur, Le Sans Pareil, La Tyrannicide, La Bande Joyeuse, Le Terroriste, La Légère, Laméline, Le Poignard, Le Tom, La Guillotine, La Guadeloupéenne, L' Italie, La Conquise, La Thérèse, La Betsi, Le Midi, La Dorade, La Revanche, Le Furet, Le Flibustier, Le Prend Tout, La Carmagnole, Le Grand Décidé, Le Barcello, Le Sans Culotte, L'Arlésienne, Le Poisson Volant, Les Deux amis, La Confiance, L'Espoir, La Conquête d'Egypte, Le Mars, La Résolue, Le Bijou, La Bagareuse, L'Amour de la Patrie, L'Africaine, Le Général Masséna, L'Unique, La Sans Jupe, La Courageuse, La Friponne, Le Flambeau, La Réunion, L'Union, Le Diomède, L'Harmonie, Le Patriote, Le Ça ira, Le Napoléon, La Fraternité, Le Tigre, Le Ronflant, L'Etoile, La Jeune Adèle, La Mouche, Le Général Ernouf, La Basilic, L'Austerlitz, La Jeune Gabrielle, La Vigilante...
" Parmi les capitaines les plus connus, ceux qui ont laissé un souvenir de leurs exploits, citons : Langlois dit Jambe de Bois, Vidal, Gassin, Giraud-Lapointe, Facio, Vilac, Pierre Gros, Augustin Pillet, Ballon, Mathieu Goy, Joseph Murphy, Lamarque, Laffîte, Dubas, Christophe Chollet, Perendeaux, Petrea, le mulâtre Modeste et Antoine Fuet qui fut surnommé Capitaine Moëde , à la suite d'un combat que nous allons relater :
Il revenait d'une croisière sur son bateau La Thérèse, croisière qui avait été très fructueuse, ayant enlevé à l'ennemi, entre autres captures, une certaine quantité de petits barils pleins d'or, parmi lesquels figuraient notamment des barils de moëdes, pièce d'or portugaise.
Sur les atterrages de la Guadeloupe, un brick anglais lui barra la route. Fuet ne résistait jamais au plaisir de se mesurer avec l'Anglais, quelle que fût sa force. Malgré son infériorité, il accepte le combat.
Connaissant bien les Anglais, il savait qu'ils se cachent pendant qu'on leur tire dessus et réapparaissent dans le temps qu'on recharge les pièces. Fuet fait tirer sabord après sabord, avec un maître d'équipage allant de canon en canon pour faire le pointage.
De cette manière, les Anglais recevaient tous les boulets qui faisaient bien du vacarme et du dégât.
Trente cinq hommes à la mousqueterie avaient devant eux des piles de fusils tout chargés et faisaient un feu continu, tuant autant de monde qu'ils pouvaient. La Thérèse crachait comme une soufrière.
Vingt-cinq nègres étaient occupés à monter les boulets du magasin et à les entasser dans les caissons.
Fuet, à la barre, dirigeait la manoeuvre et c'était merveille de voir obéir le navire et éviter les bordées.
Durant sept heures, la lutte fut infernale, les deux navires étaient littéralement troués comme une écumoire, lorsque son maître canonnier vint lui dire que les boulets allaient bientôt manquer.
L'avertissement était grave. L'ennemi était là, désemparé, les voiles en pantenne, plusieurs vergues brisées.
Ce n'était pas le moment d'arrêter le combat.
Résolu à vaincre, il releva fièrement la tête et commanda : " Qu'on défonce les barils et qu'on charge les canons avec les pièces d'or et, sous cette mitraille dorée, courons à l'abordage ".
Ce qui fut fait. Jamais, depuis que la flibuste portait sous les tropiques le drapeau noir bordé d'argent, à la tête de mort, on n'avait vu un pareil combat doré.
Les nègres apportaient près de chaque sabord les barils de moëdes et les ouvraient sur le pont. A pleines pelles, les canonniers puisaient dans le tas et bourraient leurs pièces de ces écus tout reluisants qu'ils envoyaient avec des cris de joie à l'ennemi.
Les moëdes crevaient la coque du navire ennemi, décimaient les Anglais étonnés de cette pluie d'or qui emportait bras et jambes, tandis que riaient les gens de la Thérèse.
Un ordre bref et les hommes montent dans les haubans pour s'apprêter à l'abordage, les grappins accrochent l'ennemi et la lutte suprême a lieu. Tous les Anglais sont tués.
Les vainqueurs poussent alors un même cri : " Vive le capitaine Moëde! "
Antoine Fuet entra triomphalement dans la rade de la Pointe-à-Pitre, traînant à la remorque le brick de guerre anglais.
De la coque du brick capturé, on tira mille huit cent treize écus de bon aloi et les chirurgiens parvinrent à retrouver dans le corps des Anglais morts plus de trois cents autres pièces à l'effigie du roi de Portugal.
Antoine Fuet a été le premier des Corsaires sous la période de Victor Hugues et resta toujours le premier sous le Consulat et l'Empire.
Napoléon Bonaparte, dès qu'il institua, le 19 mai 1802, la Légion d'Honneur, envoya la croix de Chevalier à Antoine Fuet, le premier décoré de la Guadeloupe. "
1800 : Le 30 septembre, Napoléon signe avec les Américains le Traité de Mortefontaine pour mettre fin à la " Quasi-guerre " aux Antilles : l’activité des corsaires va être considérablement réduite…
1802 : La paix d'Amiens est signé le 27 mars avec les Anglais qui nous restitue la Martinique, Ste Lucie et Tobago. Elle sera rompue par les Anglais 13 mois plus tard...
1803 : Ernouf arrive en Guadeloupe comme gouverneur, il trouve l'île dans un état désastreux. Pour essayer de relancer l'économie, Il ordonne aux corsaires d'obliger les navires neutres à venir commercer en Guadeloupe et non pas dans les colonies voisines.
1804 : Napoléon s'est proclamé Empereur, la guerre avec les Anglais et la 3ème coalition a repris et la course aussi...
Les corsaires Français, en particulier Lamarque, Lapointe, Vidal, Grassin, etc…, redoublent d’activité contre les Anglais.
Leur base principale est Deshaies.
En 1 an, 92 navires anglais sont capturés, rapportant 2.704.000 francs ; jusqu’en 1810, 342 seront pris…
1812 : Le 18 juin, les Etats Unis déclarent la guerre à l'Angleterre : ne disposant que d'une flotte de 17 navires, le recours aux armements corsaires apparaît indispensable, le Congrès des États-Unis les autorise par un acte du 26 juin 1812.
Les corsaires américains vont écumer les eaux du Canada et des Antilles anglaises, capturant 450 navires marchands en 6 mois...
1813 : Les corsaires américains obligent les navires marchands anglais à ne se déplacer qu'en convoi protégé par des navires de guerre. Du fait de la diminution de ce trafic marchand, ils vont s'enhardir et traverser l'Atlantique pour aller attaquer les navires anglais en mer d'Irlande, mer du Nord et même dans la Manche.
Avant la signature du traité de Gand qui mettra fin à cette guerre en décembre suivant, les corsaires américains auront capturé 1300 navires marchands anglais...
1814 : Le pirate français Jean Lafitte, installé à Barataria en Louisiane et spécialisé dans la traite illicite, se met au service des Américains avec ses 500 hommes, en échanche de l'abandon des charges contre eux : ils participeront à la défense de la Nouvelle Orléans en 1815 et seront amnistiés...
Napoléon est vaincu à Leipzig par la 6ème coalition et est exilé à l'île d'Elbe.
De 1803 à 1814, les ports français de l'Atlantique auront fourni 381 corsaires, Boulogne a elle seule 151, St Malo 126, Dunkerque a perdu son rang avec seulement 27... mais la dernière année de course aura été catastrophique avec la perte de 450 bateaux...
Le corsaire malouin Robert Surcouf a mené ses activités de corsaire dans l'Océan Indien de 1796 à 1809, avec près de 50 prises à son actif, essentiellement de navires anglais. Un officier Britannique avait contesté sa noblesse avec ces mots :
" Vous, Français, vous vous battez pour l'argent. Tandis que nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur ! "
Surcouf lui aurait répliqué : " Chacun se bat pour ce qui lui manque " !...
De 1810 à 1817, l'empire espagnol en Amérique du Sud s'est effondré progressivement pour laisser place à des régimes insurgés, au Venezuela, en Argentine, en Colombie, au Mexique, au Chili...
Ces insurgés vont donner des lettres de marque à de nombreux corsaires "insurgés" pour faire face sur mer au restant des forces navales espagnoles et intercepter la flotte marchande.
Recrutés initialement parmi les pirates de Barataria en Louisiane, la plupart de ces corsaires ne seront pas espagnols, mais français, italiens, américains voire anglais...
Les îles neutres de la Caraibe, en particulier St Barthélémy, leur serviront de base arrière, le corsaire américain José Almeyda va devenir membre du conseil de gouvernement de St Barthélémy...
En 1815, lors du siège de Carthagène par les Espagnols, le pirate puis corsaire français Louis Aury va aider les insurgés en emmenant sur 13 navires 2.000 insurgés aux Cayes d'Haiti, Aubry va se mettre au service de Bolivar au Venezuela.
En 1816, le même corsaire Aury ainsi que le corsaire français Lafitte vont s'installer à Galveston au Texas qui vient de déclarer son indépendance, et où va s'installer un tribunal de prise.
Aury va ensuite se mettre au service de l'Argentine et s'installer dans l'archipel de Providencia.
D'autres places deviennent des ports corsaires, en tête Baltimore aux Etats Unis et l'île de Margarita en face du Venezuela.
La guerre de course en Amérique Latine va quasiment s'arrêter avec la fin des guerres d'indépendance en 1824...
La "guerre de course" sera abolie en mars 1856 par le Congrès ou Traité de Paris entre la France, l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie, qui met fin à la guerre de Crimée :
" ... dûment autorisés, les susdits Plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur le moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la Déclaration solennelle ci-après :
1° La course est et demeure abolie ;
2° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ;
3° La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi ..."
Ce traité sera signé par presque toutes les grandes puissances de l'époque, soit 52 États, à l'exception de l'Espagne et des États-Unis. Ceux-ci souhaitaient obtenir une exemption complète de prise en mer pour la propriété privée mais, leur amendement n'ayant pas été accepté par toutes les puissances, ils ont retiré leur adhésion formelle...
Les corsaires américains vont écumer les eaux du Canada et des Antilles anglaises, capturant 450 navires marchands en 6 mois...
1813 : Les corsaires américains obligent les navires marchands anglais à ne se déplacer qu'en convoi protégé par des navires de guerre. Du fait de la diminution de ce trafic marchand, ils vont s'enhardir et traverser l'Atlantique pour aller attaquer les navires anglais en mer d'Irlande, mer du Nord et même dans la Manche.
Avant la signature du traité de Gand qui mettra fin à cette guerre en décembre suivant, les corsaires américains auront capturé 1300 navires marchands anglais...
1814 : Le pirate français Jean Lafitte, installé à Barataria en Louisiane et spécialisé dans la traite illicite, se met au service des Américains avec ses 500 hommes, en échanche de l'abandon des charges contre eux : ils participeront à la défense de la Nouvelle Orléans en 1815 et seront amnistiés...
Napoléon est vaincu à Leipzig par la 6ème coalition et est exilé à l'île d'Elbe.
De 1803 à 1814, les ports français de l'Atlantique auront fourni 381 corsaires, Boulogne a elle seule 151, St Malo 126, Dunkerque a perdu son rang avec seulement 27... mais la dernière année de course aura été catastrophique avec la perte de 450 bateaux...
Le corsaire malouin Robert Surcouf a mené ses activités de corsaire dans l'Océan Indien de 1796 à 1809, avec près de 50 prises à son actif, essentiellement de navires anglais. Un officier Britannique avait contesté sa noblesse avec ces mots :
" Vous, Français, vous vous battez pour l'argent. Tandis que nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur ! "
Surcouf lui aurait répliqué : " Chacun se bat pour ce qui lui manque " !...
De 1810 à 1817, l'empire espagnol en Amérique du Sud s'est effondré progressivement pour laisser place à des régimes insurgés, au Venezuela, en Argentine, en Colombie, au Mexique, au Chili...
Ces insurgés vont donner des lettres de marque à de nombreux corsaires "insurgés" pour faire face sur mer au restant des forces navales espagnoles et intercepter la flotte marchande.
Recrutés initialement parmi les pirates de Barataria en Louisiane, la plupart de ces corsaires ne seront pas espagnols, mais français, italiens, américains voire anglais...
Les îles neutres de la Caraibe, en particulier St Barthélémy, leur serviront de base arrière, le corsaire américain José Almeyda va devenir membre du conseil de gouvernement de St Barthélémy...
En 1815, lors du siège de Carthagène par les Espagnols, le pirate puis corsaire français Louis Aury va aider les insurgés en emmenant sur 13 navires 2.000 insurgés aux Cayes d'Haiti, Aubry va se mettre au service de Bolivar au Venezuela.
En 1816, le même corsaire Aury ainsi que le corsaire français Lafitte vont s'installer à Galveston au Texas qui vient de déclarer son indépendance, et où va s'installer un tribunal de prise.
Aury va ensuite se mettre au service de l'Argentine et s'installer dans l'archipel de Providencia.
D'autres places deviennent des ports corsaires, en tête Baltimore aux Etats Unis et l'île de Margarita en face du Venezuela.
La guerre de course en Amérique Latine va quasiment s'arrêter avec la fin des guerres d'indépendance en 1824...
La "guerre de course" sera abolie en mars 1856 par le Congrès ou Traité de Paris entre la France, l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie, qui met fin à la guerre de Crimée :
" ... dûment autorisés, les susdits Plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur le moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la Déclaration solennelle ci-après :
1° La course est et demeure abolie ;
2° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ;
3° La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi ..."
Ce traité sera signé par presque toutes les grandes puissances de l'époque, soit 52 États, à l'exception de l'Espagne et des États-Unis. Ceux-ci souhaitaient obtenir une exemption complète de prise en mer pour la propriété privée mais, leur amendement n'ayant pas été accepté par toutes les puissances, ils ont retiré leur adhésion formelle...